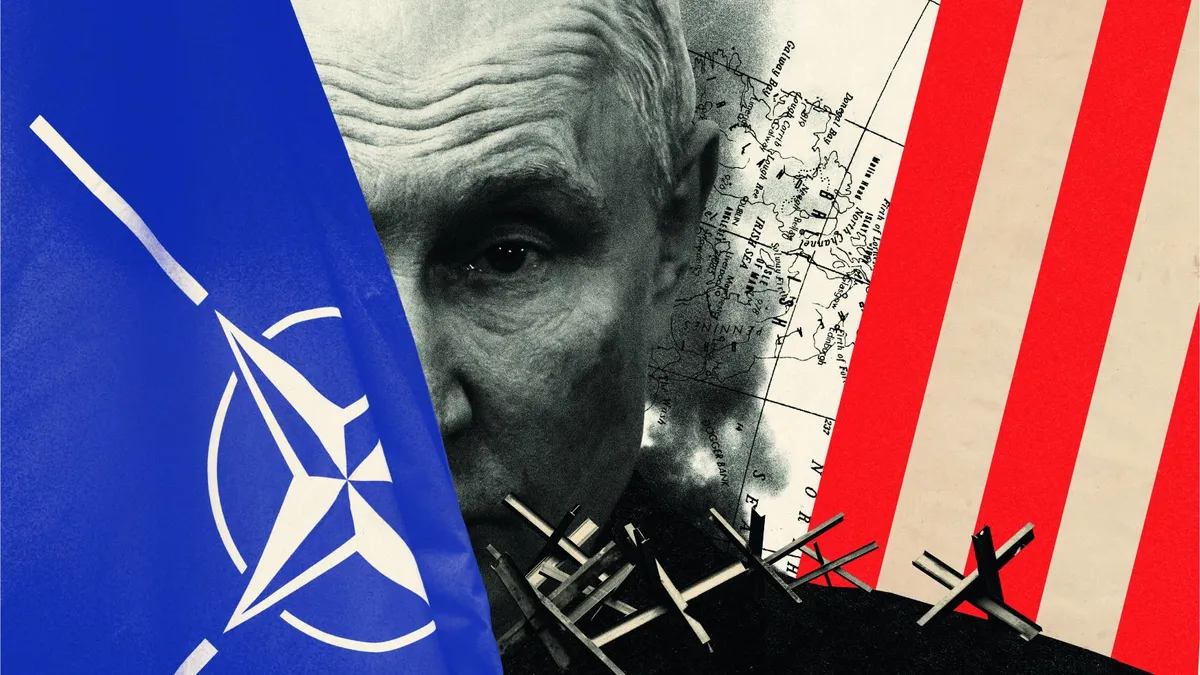Dans les mois qui suivront l’investiture de Trump le 20 janvier, les gouvernements européens chercheront à limiter les dégâts. Ils tenteront de convaincre le président et ses conseillers de réaffirmer l’engagement des Etats-Unis dans l’Otan, de poursuivre leur soutien à l’Ukraine et de veiller à ce que tout accord de paix ne condamne pas Kiev à une subordination permanente. Mark Rutte, le secrétaire général de l’Otan, en appellera à la vanité de Trump en soulignant qu’il a réussi à lui seul à impulser le réarmement européen et que les Européens sont des partenaires vitaux dans les efforts américains pour contenir la puissance chinoise.
L’attentisme européen
Mais les gouvernements européens savent qu’il leur faudra surmonter de gros obstacles. Ces discussions se dérouleront probablement au beau milieu d’une guerre commerciale mondiale féroce, avec notamment l’instauration de droits de douane sur les exportations européennes vers les Etats-Unis. Et même si Trump ne quitte pas officiellement l’Otan, il pourrait vider de son sens l’article 5, sa clause de défense mutuelle, par quelques petites phrases désinvoltes.
La politique ukrainienne de Trump dépendra des conseillers qu’il aura nommés. Le président pourrait se prononcer en faveur d’une version de l’accord proposé par le vice-président élu J. D. Vance : geler les lignes de front et exiger que l’Ukraine reste neutre. Il pourrait demander aux Européens de déployer des troupes sur place.
Comment réagirait l’Europe ? Elle pourrait se contenter de laisser les choses se dérouler à leur rythme. Peut-être que la Russie finira par s’essouffler en Ukraine. Peut-être que Poutine respectera les termes d’un cessez-le-feu. Peut-être qu’un président pro-européen intégrera la Maison Blanche en 2028. Ce genre d’attentisme est depuis longtemps le chemin par défaut que suit l’Europe. Mais ce second mandat Trump convaincra peut-être les puissances européennes que les priorités et les politiques des Etats-Unis ont définitivement changé. La perspective d’une défaite ukrainienne pourrait les pousser à prendre des mesures plus décisives.
Renoncer à accorder la priorité à l’Otan
Le premier et principal problème est celui des ressources : seulement les deux tiers des trente membres européens de l’Otan consacrent plus de 2 % de leur PIB à la défense. Sans les Etats-Unis, ils devront dépenser peut-être deux fois plus. Ce qui voudra dire accroître l’endettement, augmenter les impôts ou tailler dans les dépenses de santé et les prestations sociales.
Les Européens doivent aussi décider s’ils repensent ou non la base de leur défense collective. A l’heure actuelle, les forces armées européennes donnent priorité à l’Otan tout en veillant à élargir leurs capacités de défense et de sécurité au travers d’autres institutions, comme l’Union européenne, et des blocs militaires régionaux comme la Force expéditionnaire conjointe sous direction britannique. Du fait que l’Otan opère par consensus, Trump pourrait paralyser l’alliance dans une guerre, empêchant les Européens de mettre en œuvre ses plans de défense.
Mais renoncer à accorder la priorité à l’Otan soulèverait des questions délicates. Se fonder exclusivement sur l’UE risquerait de se couper du Royaume-Uni, premier pays européen en termes de dépenses militaires, ainsi que de la Turquie, qui possède l’une des plus grosses armées du continent.
Le rôle crucial de la France
La victoire de Trump relance aussi le débat sur le rôle dissuasif des armes nucléaires françaises et britanniques en cas d’éventuelles attaques ailleurs en Europe. Les gouvernants des « Etats de la ligne de front » s’opposeront à toute tentative américaine d’imposer un mauvais accord en Ukraine. Leurs dépenses militaires déjà importantes augmenteront encore. Mais ils n’ont pas à eux seuls les ressources ni les capacités industrielles leur permettant de poursuivre le soutien à Kiev, ni de se substituer à la puissance militaire américaine en Europe. Le rôle des Britanniques, des Français et des Allemands sera crucial.
Le Royaume-Uni est étroitement lié aux Etats-Unis pour tout ce qui touche aux renseignements et au nucléaire. C’est lui qui aurait le plus à perdre en cas de rupture avec l’administration Trump. La France se montrerait plus hardie et presserait l’UE de prendre des mesures plus radicales en matière de défense collective, comme l’émission de dette commune pour financer les dépenses militaires. En Allemagne, l’extrême droite prorusse gagne du terrain à la veille des élections fédérales de février, mais les deux principaux partis pourraient considérer le second mandat Trump comme le genre d’urgence qui pourrait justifier de creuser le déficit pour financer la défense.
Dans les trois cas de figure, nul ne sait comment l’Europe réagirait à une proposition de paix avancée par le président américain. S’y opposer impliquerait d’augmenter fortement les dépenses militaires. L’approuver serait accorder à la Russie une victoire partielle, lui donner du temps pour reconstituer ses forces et vivre avec un nouveau rideau de fer – ou dans l’ombre d’une nouvelle guerre.
Par Shashank Joshi Defence editor, The Economist