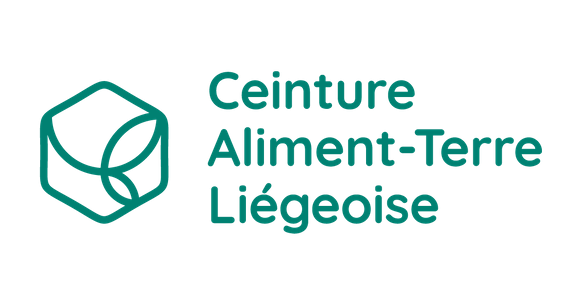Disons-le d’emblée, dix années n’ont pas suffi à produire une révolution. La situation économique de nombreux acteurs des filières alimentaires reste précaire et préoccupante. Du côté des citoyen·nes, le niveau de précarité alimentaire (et de précarité en général) reste indécent pour un pays riche comme le nôtre. La part de marché de l’alimentation locale et durable en circuits courts reste inférieure à 5 %, la population continuant de manière très majoritaire à s’approvisionner dans la grande et moyenne distribution dont les pratiques restent problématiques : greenwashing sur l’origine des produits, ou encore prise de marges beaucoup plus importantes sur les aliments bio que sur les produits conventionnels.
Face à ces problèmes qui persistent, le pari de la CATL et de ses pairs est de créer des « systèmes alimentaires territorialisés », soit des ensembles de filières alimentaires produisant et valorisant localement des denrées alimentaires dans une logique de proximité, par opposition aux filières longues de la mondialisation
Mondialisation
(voir aussi Globalisation)
(extrait de F. Chesnais, 1997a)
Jusqu’à une date récente, il paraissait possible d’aborder l’analyse de la mondialisation en considérant celle-ci comme une étape nouvelle du processus d’internationalisation du capital, dont le grand groupe industriel transnational a été à la fois l’expression et l’un des agents les plus actifs.
Aujourd’hui, il n’est manifestement plus possible de s’en tenir là. La « mondialisation de l’économie » (Adda, 1996) ou, plus précisément la « mondialisation du capital » (Chesnais, 1994), doit être comprise comme étant plus – ou même tout autre chose – qu’une phase supplémentaire dans le processus d’internationalisation du capital engagé depuis plus d’un siècle. C’est à un mode de fonctionnement spécifique – et à plusieurs égards important, nouveau – du capitalisme mondial que nous avons affaire, dont il faudrait chercher à comprendre les ressorts et l’orientation, de façon à en faire la caractérisation.
Les points d’inflexion par rapport aux évolutions des principales économies, internes ou externes à l’OCDE, exigent d’être abordés comme un tout, en partant de l’hypothèse que vraisemblablement, ils font « système ». Pour ma part, j’estime qu’ils traduisent le fait qu’il y a eu – en se référant à la théorie de l’impérialisme qui fut élaborée au sein de l’aile gauche de la Deuxième Internationale voici bientôt un siècle -, passage dans le cadre du stade impérialiste à une phase différant fortement de celle qui a prédominé entre la fin de Seconde Guerre mondiale et le début des années 80. Je désigne celui-ci pour l’instant (avec l’espoir qu’on m’aidera à en trouver un meilleur au travers de la discussion et au besoin de la polémique) du nom un peu compliqué de « régime d’accumulation mondial à dominante financière ».
La différenciation et la hiérarchisation de l’économie-monde contemporaine de dimension planétaire résultent tant des opérations du capital concentré que des rapports de domination et de dépendance politiques entre États, dont le rôle ne s’est nullement réduit, même si la configuration et les mécanismes de cette domination se sont modifiés. La genèse du régime d’accumulation mondialisé à dominante financière relève autant de la politique que de l’économie. Ce n’est que dans la vulgate néo-libérale que l’État est « extérieur » au « marché ». Le triomphe actuel du « marché » n’aurait pu se faire sans les interventions politiques répétées des instances politiques des États capitalistes les plus puissants (en premier lieu, les membres du G7). Cette liberté que le capital industriel et plus encore le capital financier se valorisant sous la forme argent, ont retrouvée pour se déployer mondialement comme ils n’avaient pu le faire depuis 1914, tient bien sûr aussi de la force qu’il a recouvrée grâce à la longue période d’accumulation ininterrompue des « trente glorieuses » (l’une sinon la plus longue de toute l’histoire du capitalisme). Mais le capital n’aurait pas pu parvenir à ses fins sans le succès de la « révolution conservatrice » de la fin de la décennie 1970.
agroalimentaire. Cette reterritorialisation de notre alimentation, outre le fait qu’elle se justifie d’un point de vue énergétique, permet d’augmenter la résilience du système alimentaire, c’est-à-dire sa capacité à s’adapter, à se rétablir face aux chocs, aux perturbations qui le rendent vulnérable. Or la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont replacé cette vulnérabilité du système alimentaire en haut de l’agenda.
Aller vers des chaines alimentaires plus courtes, c’est aussi réduire le nombre d‘intermédiaires, et si possible les choisir plus éthiques. Des intermédiaires qui favorisent une alimentation saine et durable, et qui garantissent un commerce plus équitable, respectueux de tous les acteurs et les actrices des chaines alimentaires. Dans le secteur alimentaire, il existe des entreprises dont la finalité n’est pas de maximiser les profits, mais de rendre une alimentation saine accessible au plus grand nombre tout en respectant les producteurs et les productrices. Il s’agit des coopératives alimentaires. En région liégeoise, on en a vu se développer une trentaine au cours des 10 dernières années. En quoi leurs pratiques sont-elles différentes ? Elles s’engagent vis-à-vis des producteur·ices avec des pratiques équitables et ont généralement plus de transparence par rapport à l’origine et à la composition des produits, ainsi que sur leurs pratiques commerciales. Dans une de ces coopératives de magasins actives à Liège, 70 % du prix de vente va directement dans la poche du producteur. Les prix de vente des produits bio qui y sont commercialisés y sont néanmoins inférieurs de 5 à 10 % au prix des produits équivalents vendus en grande surface.
Une leçon que nous tirons de ces 10 années d’actions
Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
est que les consommateur·ices isolé·es ne sauraient, à eux seuls, faire évoluer le système qui les nourrit
L’engouement créé par le lancement de la CATL, ainsi que la création d’un nombre croissant d’emplois dans les coopératives alimentaires, a contribué à persuader les autorités politiques du sérieux et de l’importance de la dynamique. Le succès du Festival Nourrir Liège, lancé en 2017 avec des partenaires du monde culturel et universitaire, qui touche plusieurs milliers de citoyen·nes chaque année, a également renforcé la crédibilité et la légitimité du mouvement. C’est à cette même époque que sont nées les deux premières cousines de la CATL : la Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole et le Réseau Aliment-Terre de l’Arrondissement de Verviers.
Nous avons, à cette époque, fait le constat d’un changement de paradigme dans la relation avec les pouvoirs publics, qui se sont inscrits de manière de plus en plus délibérée dans une logique de partenariat. À Liège, citons le projet CREaFARM, qui consiste à mettre des terres agricoles communales à la disposition de porteurs de projets agricoles, ou encore l’engagement de la Ville de Liège et de l’intercommunale ISoSL, à proposer des repas 100 % durables, c’est-à-dire aussi biologiques, locaux et de saison que possible, pour les crèches et écoles de leurs réseaux (environ 3 500 quotidiennement) à l’horizon fin 2024.
Au niveau régional, les choses ont énormément évolué également. En 2018, le gouvernement wallon adoptait pour la première fois une stratégie alimentation durable, intitulée « Manger demain », avec à la clé un référentiel commun intitulé « Vers un système alimentaire durable en Wallonie », et des budgets croissants dédiés à la cause. Bref, les autorités publiques, tant communales que régionales, semblent avoir pris la mesure de l’importance de la thématique alimentaire du point de vue de l’intérêt général, ainsi que des nombreux leviers dont elles disposent en la matière.
Alors que se renforçaient les partenariats avec les pouvoirs publics, les ceintures alimentaires se sont progressivement structurées autour de CCREALIM : le Collectif de Ceintures et Réseaux Alimentaires. Les précurseurs liégeois, carolo et verviétois ont été rejoints depuis par des initiatives similaires issues des régions de Namur, du Tournaisis et de la province du Luxembourg.
Seules les trois premières sont actuellement financées par la Wallonie pour la réalisation de leurs missions de base, qui sont les suivantes :
– Structuration et animation des filières (avec notamment le développement d’infrastructures de logistique et de transformation alimentaires, tels que le Pôle circuit court à Liège) ;
– Sensibilisation, avec en particulier les festivals « Nourrir », dont le premier du genre est né à Liège en 2017 ;
– Information et orientation des entrepreneur·euses et entreprises dans le domaine de l’alimentation durable, pour leur permettre d’accéder aux ressources, formations et accompagnements nécessaires à leur développement ;
– Capitalisation des expertises et expériences réalisées sur chaque territoire, pour ne pas chaque fois réinventer la roue ;
– Animation territoriale, pour impliquer toutes les parties prenantes du territoire dans le projet de transition du système alimentaire, et coordonner leurs efforts dans un esprit démocratique, via en particulier les Conseils de Politique Alimentaires
Les prémices d’une démocratie alimentaire sont en effet en train de voir le jour en Wallonie. Cela s’est initialement matérialisé par la création, en 2020, du CwAD, le Collège wallon de l’alimentation durable, une structure de gouvernance collaborative rassemblant des acteurs du territoire wallon (dont la CATL) en vue d’y soutenir une dynamique de transition vers un système alimentaire durable. De telles structures sont en train d’éclore partout en Wallonie, au niveau pluricommunal, avec des objectifs similaires. Ainsi, le Conseil de Politique Alimentaire de Liège Métropole, porté conjointement par la CATL, l’ASBL Liège Métropole (conférence des bourgmestres de l’Arrondissement) et l’Université de Liège, créé en 2022, réunit 120 membres représentatifs des parties prenantes du système alimentaire du territoire. Des projets s’y développent concrètement sur des sujets essentiels tels que l’action des pouvoirs publics locaux en matière de marchés publics alimentaires ou de foncier agricole, l’amélioration des pratiques dans les cuisines de collectivités, la formation des acteurs de l’alimentation durable, le soutien aux producteurs, ou encore l’accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité.
Les différents projets initiés par les ceintures alimentaires restent des paris ambitieux, dans un contexte de crise qui touche durement les filières courtes et le secteur de l’alimentation de qualité différentiée. En toute vraisemblance et sur base des tendances actuelles, l’objectif fixé il y a dix ans, de transformation complète du système alimentaire, ne semble pas pouvoir être atteint à l’horizon d’une génération, à ce rythme du moins. Une leçon que nous tirons de ces 10 années d’actions est que les consommateur·ices isolé·es ne sauraient, à eux seuls, faire évoluer le système qui les nourrit. Il est nécessaire d’actionner des leviers plus importants. En France, une loi intitulée EGalim, a notamment pour but de permettre aux agriculteur·ices d’avoir un revenu digne en renforçant leur pouvoir de négociation vis-à-vis de la grande distribution. Cette loi française impose également à tous les établissements de restauration collective, qu’ils soient publics ou privés, de servir des repas composés au minimum de 50 % de produits « durables et de qualité » dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Peut-être nos autorités publiques pourraient-elles s’inspirer de telles législations, même si l’on sait que leur mise en œuvre est compliquée. Dans l’équation qui permettra, ou pas, de transformer en profondeur le système alimentaire qui nous nourrit, chacun a un rôle à jouer : citoyen·ne, acteur·ice économique, décideur·euse politique, notamment, mais chacun·e ne dispose bien sûr pas du même poids ou du même pouvoir, ni de la même responsabilité.