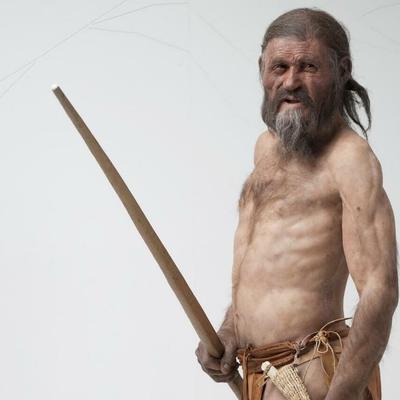Des centaines d’études ont déjà été réalisées sur Ötzi et il y en a bien davantage en cours. Maintenant que les chercheurs de l’Institut d’étude des momies ont séquencé le génome d’Ötzi, ils peuvent analyser les gènes de son microbiote intestinal. « Nous aimerions comprendre tout l’ensemble de bactéries qui vivait dans son estomac et dans ses intestins », explique Albert Zink.
La diversité de notre flore intestinale semble avoir un impact sur notre santé. Pour cette raison, les chercheurs ont envie de connaître la composition de celle d’Ötzi. Une étude en cours, qui intéresse 6 500 personnes vivantes en plus d’Ötzi, et qui est réalisée par l’Université de Trento, a d’ores et déjà permis de découvrir que l’homme d’Hauslabjoch était porteur de trois des quatre souches de la bactérie Prevotella copri. Les populations autochtones du monde entier sont porteuses à divers degrés de souches de cette bactérie. Mais elle n’est présente que sous une seule forme chez les 30 % d’occidentaux qui en sont porteurs (cela signifie que cette souche tend à prendre le dessus et donc à réduire la diversité).
Autre découverte remarquable, l’estomac d’Ötzi était porteur d’Helicobacter pylori, bactérie présente aujourd’hui chez la moitié de la population mondiale, qui peut avoir des effets mortels chez 10 % d’entre nous. De nos jours, la souche dominante de H. pylori en Europe est en fait un hybride de souches asiatique et africaine. La souche présente chez Ötzi est presque uniquement asiatique, ce qui tend à montrer que la souche africaine est arrivée en Europe après sa mort. Cela apporte des éléments de réponse à la question de savoir si H. pylori fait naturellement partie de notre microbiote intestinal ou s’il faut traiter la bactérie avec un antibiotique dès qu’on l’identifie.
Une autre étude du microbiote intestinal d’Ötzi a révélé qu’il était porteur d’une souche pathogène ancestrale de Clostridium perfringens, responsable aujourd’hui de nombreuses intoxications alimentaires.
La ville de Bolzano prévoit la construction d’un nouveau musée d’archéologie au cours des années à venir afin d’accueillir davantage d’artefacts tyroliens en plus d’Ötzi. Elle aimerait aussi améliorer l’efficacité énergétique du système de la chambre froide qui abrite sa dépouille depuis vingt-deux ans. (Une chambre de secours est prête au cas où celle-ci viendrait à dysfonctionner).
Pour mieux comprendre les processus naturels qui ont permis la conservation d’Ötzi pendant cinq millénaires (et notamment l’effet de certains éléments et l’action des microbes), les chercheurs de l’Institut d’étude des momies analysent en ce moment les restes d’un chamois conservé naturellement et découvert en 2020 au même endroit qu’Ötzi. Bien qu’il ne soit âgé que de 400 ans, son état de conservation est semblable à celui de l’homme des glaces, et les chercheurs font varier l’humidité et la température à laquelle ils gardent sa dépouille pour mieux comprendre comment ces paramètres permettent de la préserver. Ils étudient aussi son microbiote, interne comme externe. « Nous savons que certaines bactéries et certaines moisissures peuvent survivre aux basses températures, donc peut-être que si on modifie un paramètre elles se mettront à grandir à nouveau », analyse Albert Zink.
Les progrès technologiques seront cruciaux si on veut découvrir tous les secrets d’Ötzi (et nous les découvrirons). Son génome vieux de 5 000 ans a été séquencé en 2012, soit à la période où le séquençage de nouvelle génération se démocratisait et devenait abordable. Mais même à ce moment-là, Albert Zink n’aurait jamais imaginé que les chercheurs soient un jour capables de reconstituer le microbiote de l’homme des glaces. « Ces méthodes se sont développées si vite, et aujourd’hui on a bien plus de données », s’émerveille-t-il.
À l’avenir, les recherches pourraient se concentrer sur le fonctionnement du corps d’Ötzi, sur les protéines, les lipides et les enzymes présents dans ses tissus qui nous révéleront peut-être des informations sur son système immunitaire. Mais pour le moment, l’analyse protéinique d’échantillons préhistoriques demeure un processus complexe.
En attendant, les gardiens d’Ötzi doivent trouver un compromis : la momie doit être à la disposition de la science mais la recherche ne peut être ni trop invasive ni trop soutenue. Le musée reçoit dix à quinze requêtes par an pour étudier Ötzi. Chaque demande est évaluée par un comité d’experts provenant de différentes universités et du musée. Environ une fois par an, ils effectuent un prélèvement à la surface du corps pour en surveiller la microbiologie. Il est rare qu’ils le décongèlent. La dernière fois que cela a eu lieu, c’était en 2019.
« Nous ne pouvons pas connaître les méthodes qui seront à la disposition des chercheurs de 2050, concède Oliver Peschel. Il est donc logique de conserver Ötzi dans les meilleures conditions pour que la recherche soit possible dans vingt ou trente ans. »