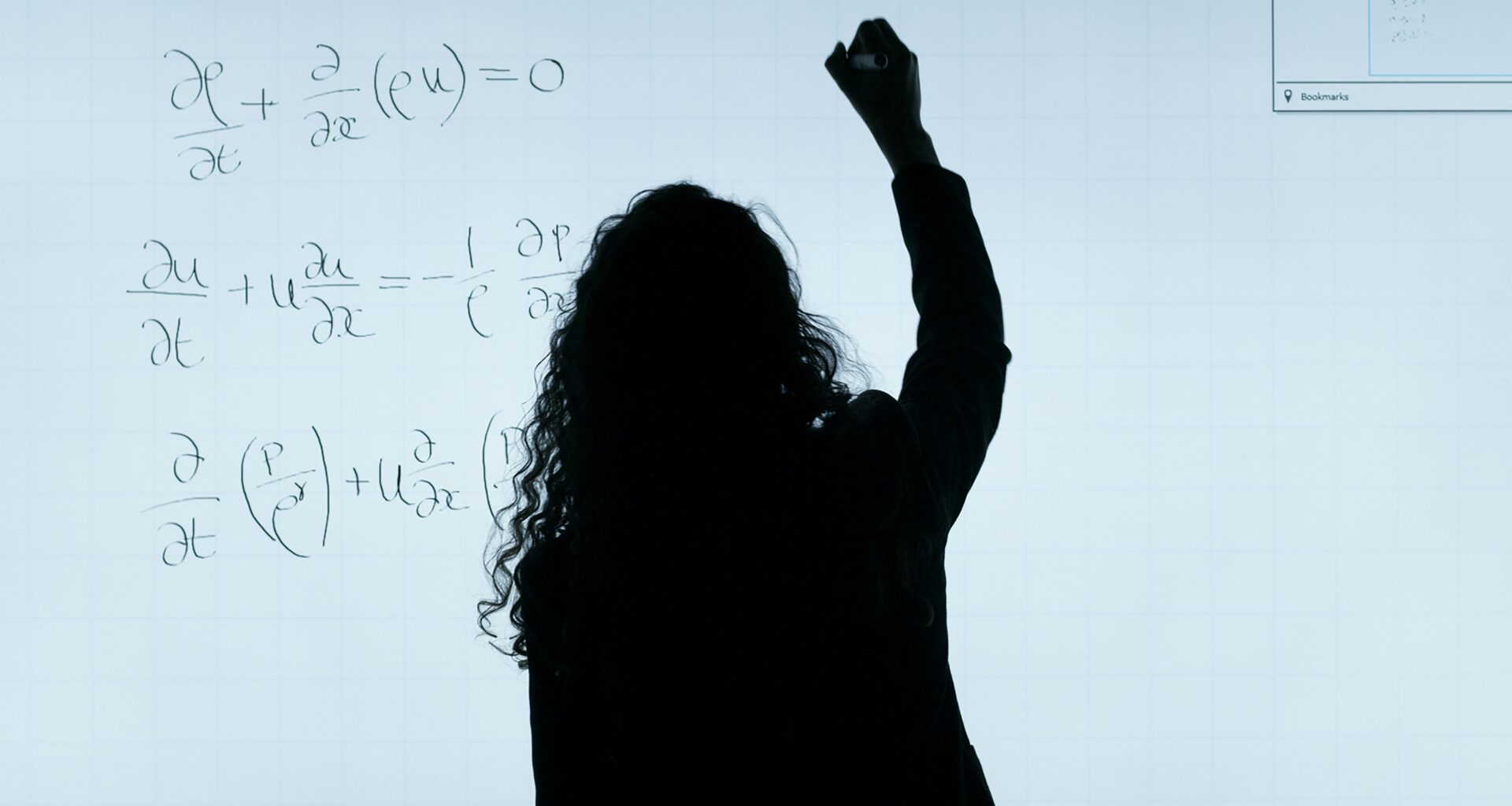Sous la pression des coupes budgétaires massives aux États-Unis, des laboratoires ferment, des postes s’évaporent et des carrières basculent. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence, de nombreux scientifiques américains prennent le chemin de l’exil. En Europe, la France s’impose comme l’une des principales terres d’accueil. Derrière les annonces officielles, une réalité plus complexe se dessine, où l’arrivée de chercheurs américains en France réinterroge les équilibres déjà fragiles du monde académique.
Ce geste fort s’est accompagné d’un discours prononcé à la Sorbonne, où le président a affirmé que l’Europe devait devenir un refuge pour les scientifiques. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a appuyé cette volonté avec une enveloppe de 500 millions d’euros à l’échelle du continent. Mais derrière ces chiffres, les modalités concrètes restent floues. Le Pr. Didier Samuel, président de l’Inserm, a rappelé dans L’Express que les financements annoncés restaient symboliques face aux 18 milliards de dollars supprimés du budget du National Institute of Health.

Accueillir des chercheurs américains en France sans affaiblir la recherche locale
À Toulouse, la Communauté d’universités et établissements a pris les devants. Elle a lancé un programme d’accueil doté de six millions d’euros, avec l’objectif d’atteindre dix millions grâce au soutien des collectivités. Elle prévoit d’ouvrir une dizaine de postes. Les premières candidatures doivent arriver dès ce mois de juin. L’établissement vise en priorité des postdoctorants « de forte qualité », dont les financements ont été interrompus aux États-Unis, comme l’a indiqué Michael Toplis à France 3 Occitanie.
Pourtant, ce programme ne fait pas l’unanimité. Les syndicats de l’enseignement supérieur dénoncent l’ironie d’un financement dédié à l’accueil international, alors que les universités françaises affrontent des réductions drastiques. En février, 400 millions d’euros ont été retirés du budget de la recherche par décret, après une première coupe d’un milliard votée début 2025. D’après une enquête relayée par BFM TV, 60 universités sur 75 fonctionnent désormais en déficit.
Cette dichotomie entre solidarité internationale et austérité nationale fait grincer des dents. À Paris, des manifestants ont brandi en avril des pancartes « La fac en miettes », tandis que le rectorat a placé la Sorbonne sous tutelle et lui a imposé 13 millions d’euros d’économies. Un doctorant en sciences politiques, interrogé par Radio France, s’interrogeait : comment loger, accompagner, et payer correctement ces chercheurs étrangers quand « il ne reste que 1 000 euros pour 100 doctorants » dans certaines écoles doctorales françaises ?
Un système à bout de souffle face à une ambition européenne
Au-delà de l’hostilité ambiante envers les mesures trumpiennes, la question de l’équité entre les chercheurs s’invite dans le débat. Les conditions d’accueil annoncées pour les scientifiques américains – pouvant aller jusqu’à 800 000 euros sur trois ans dans certains établissements comme Aix-Marseille – contrastent fortement avec les salaires moyens des enseignants-chercheurs français, estimés à 63 000 euros brut annuels. Ce déséquilibre alimente un sentiment de mise en compétition délétère.
Les opposants à cette politique redoutent aussi un effet vitrine, déconnecté de la réalité que vivent les laboratoires. Julie Gervais, maître de conférences à l’université Paris 1, a rappelé que le programme PAUSE, censé accueillir les chercheurs venus de pays en guerre, rencontre de grandes difficultés de financement. Cette différence de traitement entre les publics pose une question éthique : pourquoi accompagner certains chercheurs menacés mieux que d’autres ?
Malgré les critiques, certains scientifiques voient dans cette crise une chance pour la France de repositionner son système de recherche à l’échelle internationale. À Toulouse, James Hammitt, économiste et chercheur américain à la TSE, estime que le niveau des établissements français reste attractif. Pour lui, ce sont avant tout la liberté académique et la collaboration qui motivent les départs, bien plus que les salaires.
Mais encore faut-il que cette politique d’accueil soit viable. À ce jour, seuls quelques postes sont réellement ouverts. Les financements promis devront être mobilisés dans un contexte d’incertitudes budgétaires croissantes. Pour espérer tenir cette promesse d’hospitalité, la France devra donc convaincre qu’elle peut soutenir à la fois ses chercheurs nationaux et ceux qui arrivent.