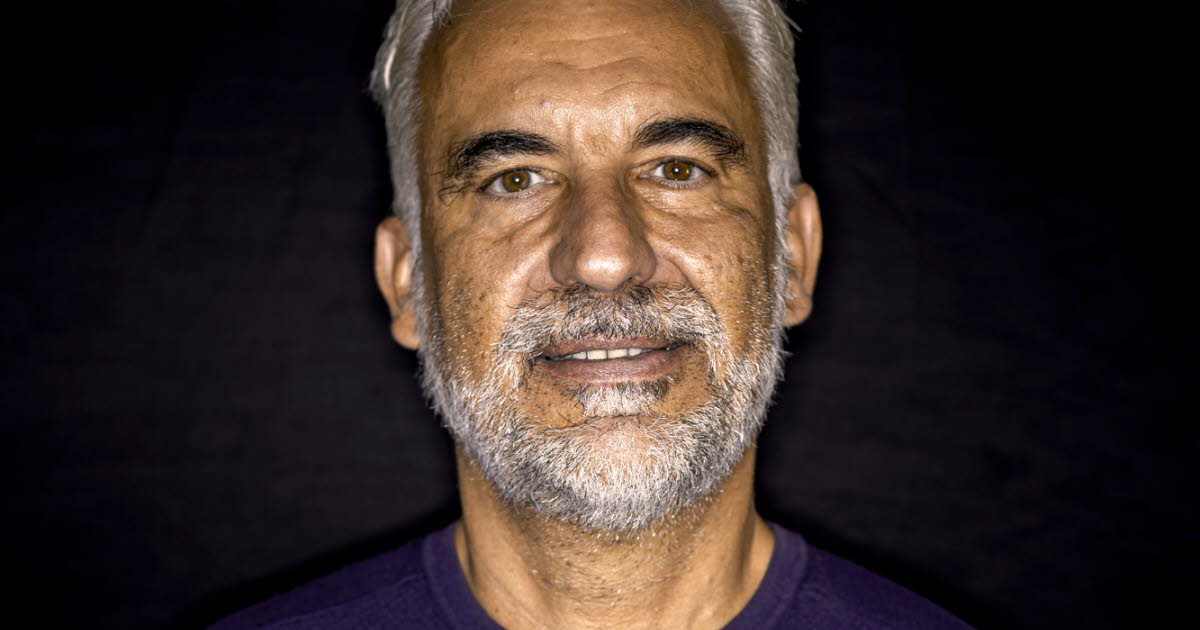Et dire qu’elle représente la Liberté éclairant le monde, elle doit l’avoir mauvaise ces temps-ci.
Il y a 140 ans, le 17 juin 1885, elle entrait triomphalement dans le port de New York, entièrement démontée à bord de l’Isère – ça ne s’invente pas – une puissante frégate de transport.
Offerte par le peuple français en signe d’amitié, elle fut dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886 pour le centenaire de la Déclaration d’indépendance américaine. Et depuis, elle séduit les badauds sur son éperon rocheux au sud de Manhattan, à l’embouchure du fleuve Hudson.
Elle fut pendant des décennies la première vision des Etats-Unis pour des millions d’immigrants en quête d’un nouveau départ, après une longue traversée de l’Atlantique. Elle est aujourd’hui le monument le plus célèbre de l’Amérique, symbole universel de la liberté et de la démocratie.
Objet iconique dans le monde entier, elle a inspiré de nombreux artistes issus de la pop culture. Souvent copiée, elle a été longtemps porteuse d’espoir pour tous ceux qui voulaient y croire.
Mais que peut faire une vieille dame fatiguée du haut de son piédestal face à ce monde qui gronde et qui s’agite ? Les figures allégoriques n’ont plus la même influence qu’autrefois, lessivées par le temps qui passe à l’image de sa robe en cuivre patiné de vert-de-gris qui n’a plus le même éclat.
On aimerait qu’elle demeure le porte-drapeau de l’émancipation des peuples vis à vis de l’oppression. Mais au Moyen-Orient comme en Ukraine, ça fait longtemps qu’on n’y croit plus.
La Statue de la Liberté – puisque c’est elle dont on parle – n’est plus qu’un lointain souvenir vidé de ses valeurs cardinales. Raphaël Glucksmann, le député européen, a même réclamé son retour en France, déplorant le désengagement de Donald Trump, accélérateur d’un désordre mondial qui n’a que faire des belles histoires.