Les ours polaires ont
longtemps été considérés comme les principaux prédateurs de la
péninsule arctique. Cependant, si l’on prend en compte les fonds
marins, il semblerait que certaines étoiles de mer puissent
également se placer au sommet du réseau trophique local. Les
détails de l’étude sont publiés dans la revue Ecology.
Un réseau trophique représente
l’ensemble des relations alimentaires entre espèces au sein d’un
écosystème. À la base d’un tel réseau, les producteurs primaires
(qui tirent leur énergie du soleil ou du recyclage de matières
organiques mortes) soutiennent les niveaux trophiques inférieurs,
qui transfèrent à leur tour l’énergie jusqu’aux prédateurs
supérieurs, et ainsi de suite. Tout en haut se trouvent les
super-prédateurs, ou prédateurs apex.
Dans les réseaux trophiques marins,
les chercheurs se concentrent souvent sur le compartiment
pélagique (en eau libre). Dans le milieu arctique, nous
pourrions ainsi démarrer la chaîne à partir des minuscules planctons de surface pour fini
jusqu’aux ours polaires (Ursus maritimus). À l’inverse, le
compartiment benthique (fond de l’eau) est
sous-étudié, car généralement perçu comme constitué uniquement
d’une chaîne alimentaire tronquée avec des espèces de niveau
trophique inférieur.
En réalité, il s’avère que la
composante benthique du réseau trophique de la région arctique a
été largement sous-estimée.
Deux sous-réseaux distincts, mais interconnectés
Dans le cadre de ces travaux, des
chercheurs de l’Université Laval ont analysé 881 échantillons
d’invertébrés benthiques appartenant à 97 taxons et neuf
embranchements ainsi que 699 échantillons de faune pélagique
(invertébrés, poissons démersaux et pélagiques, oiseaux marins et
poissons marins, mammifères) appartenant à 53 espèces de douze
groupes taxonomiques dans les eaux marines arctiques autour de
l’île Southampton (Nunavut, Canada). Cet environnement est situé à
l’embouchure de la baie d’Hudson, dans le territoire canadien du
Nunavut.
Après analyses, les chercheurs ont
alors découvert que les composants benthiques et pélagiques avaient
en réalité chacun un nombre similaire d’étapes, ou
de niveaux trophiques, dans leurs chaînes alimentaires
respectives.
« C’est un changement dans
notre vision du fonctionnement du réseau trophique marin côtier de
l’Arctique« , a déclaré Rémi Amiraux, principal auteur de
l’étude. « Nous avons prouvé que la faune qui habite l’eau
de mer et celle qui habite les sédiments forment deux
sous-réseaux distincts, mais
interconnectés.«
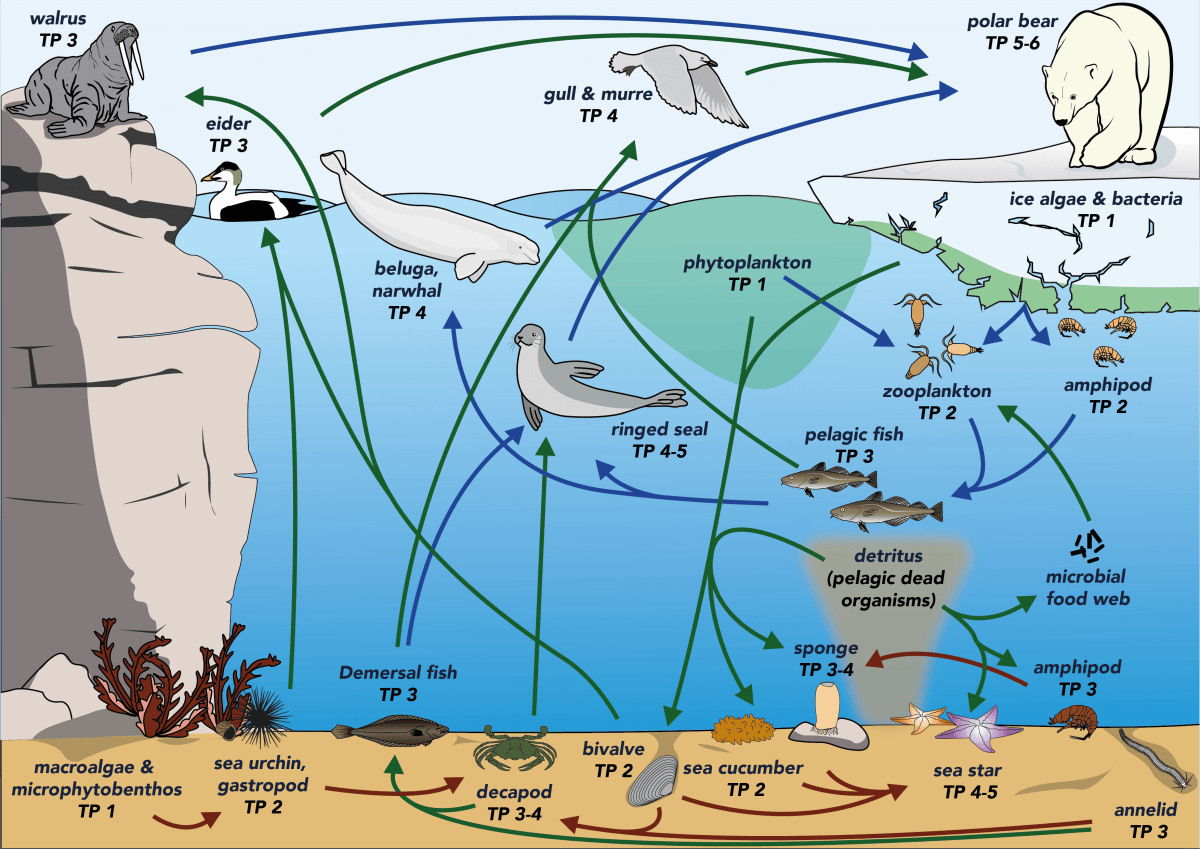
Interactions pélagiques, les flèches brunes illustrent les
interactions benthiques et les flèches vertes montrent les
interactions entre les chaînes alimentaires pélagiques et
benthiques. Crédits : /Université du ManitobaLes étoiles de mer tout en haut
Il ressort également que les
étoiles de mer, en particulier, constituent un élément clé de ce
réseau benthique, occupant divers niveaux trophiques. Certaines
d’entre elles, appartenant à la famille des
Pterasteridae, étaient d’ailleurs systématiquement au
sommet de la plupart des chaînes alimentaires individuelles, se
nourrissant souvent de prédateurs secondaires tels que des
bivalves, des concombres de mer et des éponges. Autrement dit, cela
signifie que les étoiles de mer Pterastidae chassent à une
échelle équivalente à celle des ours polaires. La seule
différence entre les deux est la taille de leurs proies.
Autre point commun : tout comme les
ours polaires peuvent se nourrir de baleines mortes si une occasion
se présente, leur permettant de tenir plusieurs semaines, ces
étoiles de mer se nourrissent également de manière opportuniste
d’organismes pélagiques morts qui coulent au fond de la mer, ce qui
leur permet de chasser moins souvent.

Une étoile de mer de la famille des Pterasteridae. Crédits :
National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA)
Ces travaux soulignent donc
l’importance de prendre en considération l’importance des chaînes
alimentaires benthiques. Il est également utile de rappeler que les
étoiles de mer de la famille des Pterasteridae évoluent dans
quasiment tous les écosystèmes marins. Si ces organismes ont le
même comportement dans d’autres environnements, nous pourrions
ainsi les considérer comme quelques-uns des prédateurs les plus
performants du milieu océanique.
