La découverte récente de
vingt-deux nouveaux virus chez des chauves-souris dans la province
du Yunnan, en Chine, soulève une alerte sérieuse chez les
chercheurs en santé publique et virologie. Parmi ces virus, deux se
rapprochent génétiquement des dangereux henipavirus, responsables
par le passé d’épidémies humaines meurtrières. Cette étude souligne
l’urgence de mieux surveiller ces réservoirs naturels de maladies
potentiellement transmissibles à l’homme et au bétail.
Des virus inédits à haut
risque
Une équipe internationale de
chercheurs a mené une analyse approfondie des tissus rénaux de 142
chauves-souris collectées entre
2017 et 2021 dans le Yunnan, région connue pour sa biodiversité
riche et ses interactions fréquentes entre faune sauvage et
populations humaines. Le séquençage génétique a permis d’identifier
22 virus jusqu’ici inconnus. Parmi eux, deux ont été baptisés «
henipavirus 1 » et « henipavirus 2 » de la chauve-souris du Yunnan,
et présentent une similitude génétique de 52 à 57 % avec des virus
du même groupe déjà responsables d’épidémies dévastatrices, comme
Hendra et Nipah.
Ces henipavirus sont
particulièrement préoccupants car ils ont été détectés dans les
reins des chauves-souris, un organe associé à la production
d’urine. Cette localisation suggère une voie possible de
transmission via les fluides corporels, notamment l’urine, qui
pourrait contaminer l’environnement, les fruits ou l’eau consommés
par les humains ou les animaux domestiques. Cette découverte
augmente le risque d’émergence d’une nouvelle maladie zoonotique,
c’est-à-dire une maladie transmissible de l’animal à l’homme.
Une région à risque élevé
d’émergence
Le Yunnan, grâce à son climat
et son environnement, ressemble à d’autres régions du monde où des
virus dangereux ont déjà émergé, notamment en Malaisie, foyer
historique des épidémies à Nipah. Cette similitude climatique et
écologique fait du Yunnan un véritable « point chaud » pour la
surveillance des agents pathogènes zoonotiques.
Le professeur Vinod
Balasubramaniam, virologue moléculaire à l’Université Monash en
Australie, insiste sur la nécessité de
renforcer la surveillance et les mesures préventives dans cette
région : « Ces virus sont particulièrement préoccupants car ils
pourraient contaminer les humains via des fruits ou de l’eau
souillés par l’urine des chauves-souris. La vigilance est
indispensable pour éviter une nouvelle crise sanitaire. »
Au-delà des virus : des
bactéries et un parasite inconnus
La recherche ne s’est pas
limitée aux seuls virus. Elle a également permis d’identifier deux
nouvelles espèces bactériennes, dont une baptisée Flavobacterium yunnanensis, ainsi qu’un
parasite unicellulaire jusqu’ici inconnu, nommé Klossiella yunnanensis. Ces découvertes
élargissent notre compréhension de la biodiversité microbienne
hébergée par les chauves-souris et des menaces potentielles qu’elle
représente.
Ce focus sur les organes
internes, en particulier les reins, est une approche nouvelle dans
l’étude des maladies émergentes. Jusqu’ici, la majorité des
recherches se concentraient sur les excréments ou la salive des
chauves-souris, négligeant les tissus qui pourraient receler
d’autres agents pathogènes. Cette étude suggère donc que les tissus
internes sous-étudiés pourraient être des réservoirs importants
pour des micro-organismes infectieux encore inconnus.
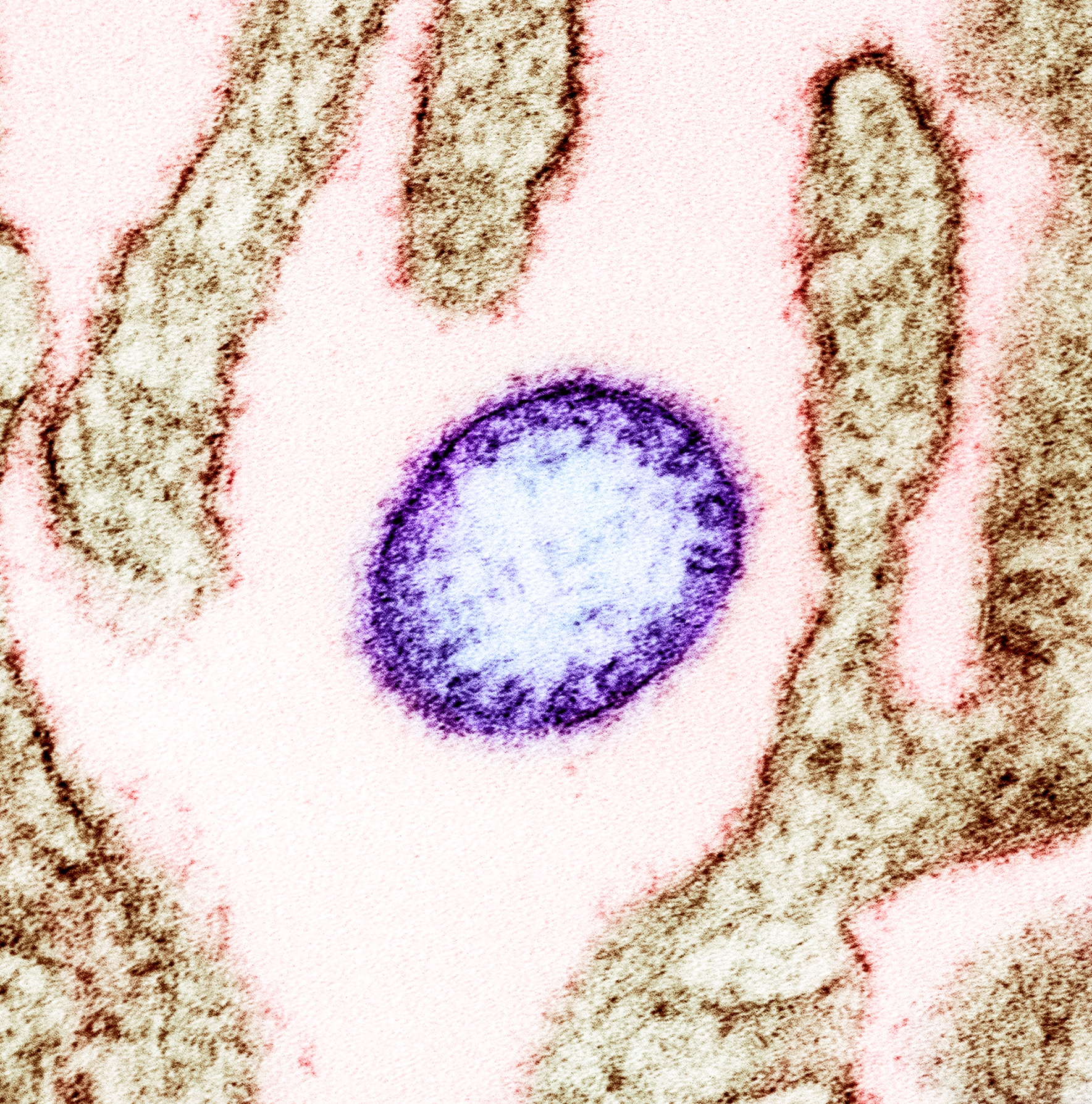
Micrographie électronique à transmission colorisée d’une particule
extracellulaire mature du virus Nipah (violet) près de la
périphérie d’une cellule VERO infectée (marron). Image prise et
retouchée au Centre de recherche intégrée du NIAID à Fort Detrick.
Crédits : NIAIDPourquoi s’inquiéter des
virus de chauves-souris ?
Les chauves-souris sont des
hôtes naturels pour de nombreux virus dangereux. Elles ont été
impliquées dans l’émergence de plusieurs maladies virales majeures
affectant l’homme, telles que le virus Ebola, le virus Marburg, le
SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), le MERS (Syndrome
Respiratoire du Moyen-Orient), et plus récemment la COVID-19. La
particularité de ces animaux est qu’ils peuvent héberger ces virus
sans en être malades, leur système immunitaire étant
particulièrement adapté.
Le risque vient de la
transmission de ces virus à d’autres animaux, puis éventuellement
aux humains, souvent via des contacts directs ou indirects
(aliments, eau contaminés). Cette « transmission zoonotique » est à
l’origine de nombreuses pandémies. Mieux comprendre quels virus
circulent chez les chauves-souris, et comment ils peuvent
contaminer d’autres espèces, est donc un enjeu crucial de santé
mondiale.
Une vigilance indispensable
pour prévenir la prochaine épidémie
Cette découverte souligne
l’importance de renforcer la surveillance écologique et sanitaire
dans les zones où les humains et la faune sauvage cohabitent
étroitement. Les risques de transmission sont d’autant plus élevés
dans des zones rurales où les chauves-souris nichent à proximité
des villages et des vergers.
En conjuguant séquençage
génétique, écologie et surveillance sanitaire, les chercheurs
espèrent identifier précocement les agents pathogènes susceptibles
de déclencher la prochaine crise sanitaire mondiale. Cela permettra
d’anticiper les mesures de prévention, notamment en contrôlant la
contamination des aliments et de l’eau, afin d’éviter que ces
nouveaux virus ne franchissent la barrière inter-espèces.
En résumé, la découverte de ces nouveaux
virus chez les chauves-souris du Yunnan est un signal d’alarme
clair. Le risque d’émergence d’une maladie infectieuse grave,
transmissible à l’homme ou au bétail, est réel. Pour limiter ce
danger, une collaboration internationale en sciences, santé
publique et écologie est plus que jamais nécessaire.
