À peine découverte, la
comète interstellaire 3I/ATLAS fait déjà sensation dans le monde de
l’astronomie. Depuis une semaine, les scientifiques du monde entier
observent ce visiteur exceptionnel, cherchant à comprendre son
origine, sa composition et ce qu’il peut nous apprendre sur la
galaxie. Mais ce qui distingue 3I/ATLAS de ses prédécesseurs –
‘Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019 – ce n’est pas seulement sa
trajectoire ou sa vitesse, mais l’éclairage nouveau qu’elle jette
sur une région galactique encore inexplorée : le disque épais de la
Voie lactée.
Une rencontre inattendue au
cœur de la Voie lactée
La découverte de la comète 3I/ATLAS
a coïncidé avec un moment particulièrement symbolique : Matthew
Hopkins venait tout juste de soutenir sa thèse de doctorat sur la
modélisation des objets interstellaires. Ce lien fortuit a permis
aux chercheurs d’appliquer immédiatement leurs modèles à ce nouvel
objet, offrant des perspectives inédites.
Contrairement aux deux
précédents visiteurs interstellaires, 3I/ATLAS semble provenir
d’une zone différente de la galaxie : le disque épais. Cette
structure, située au-dessus et en dessous du plan galactique où se
trouve le Soleil, abrite les étoiles les plus anciennes de la Voie
lactée. Cette comète pourrait donc être un témoin d’un passé
cosmique bien plus lointain que notre propre système solaire.
Une vitesse record qui
intrigue
Un des premiers indices de
cette origine différente réside dans la vitesse de la comète. Se
déplaçant à environ 57 kilomètres par seconde, 3I/ATLAS va presque
deux fois plus vite que ‘Oumuamua et Borisov. Cette rapidité,
couplée à une trajectoire légèrement inclinée par rapport au plan
galactique, suggère qu’elle ne fait pas simplement partie des
objets qui peuplent la région proche du Soleil.
Le professeur Chris Lintott,
directeur de thèse de Matthew Hopkins, explique que cette vitesse
et cette trajectoire correspondent parfaitement à ce que le modèle
prédit pour un objet issu du disque épais. Là où les étoiles et les
objets interstellaires sont plus anciens, plus exposés aux
rayonnements cosmiques, et donc soumis à des processus de
vieillissement différents.
Une couleur rouge
mystérieuse
Par ailleurs, des observations réalisées avec le Très Grand Télescope
(VLT) de l’Observatoire européen austral ont révélé une teinte
rougeâtre inhabituelle pour une comète. Cette coloration, plus
proche de celle des astéroïdes Centaure que des comètes classiques
du Système solaire, est probablement due à l’exposition prolongée
aux rayons cosmiques dans l’espace interstellaire.
L’hypothèse du professeur
Lintott est que cet objet a plus de 7 milliards d’années – bien
plus vieux que notre Système solaire qui n’a “que” 4,6 milliards
d’années. Cette longévité explique son aspect “rougi”, fruit d’un
vieillissement chimique et radiatif prolongé.
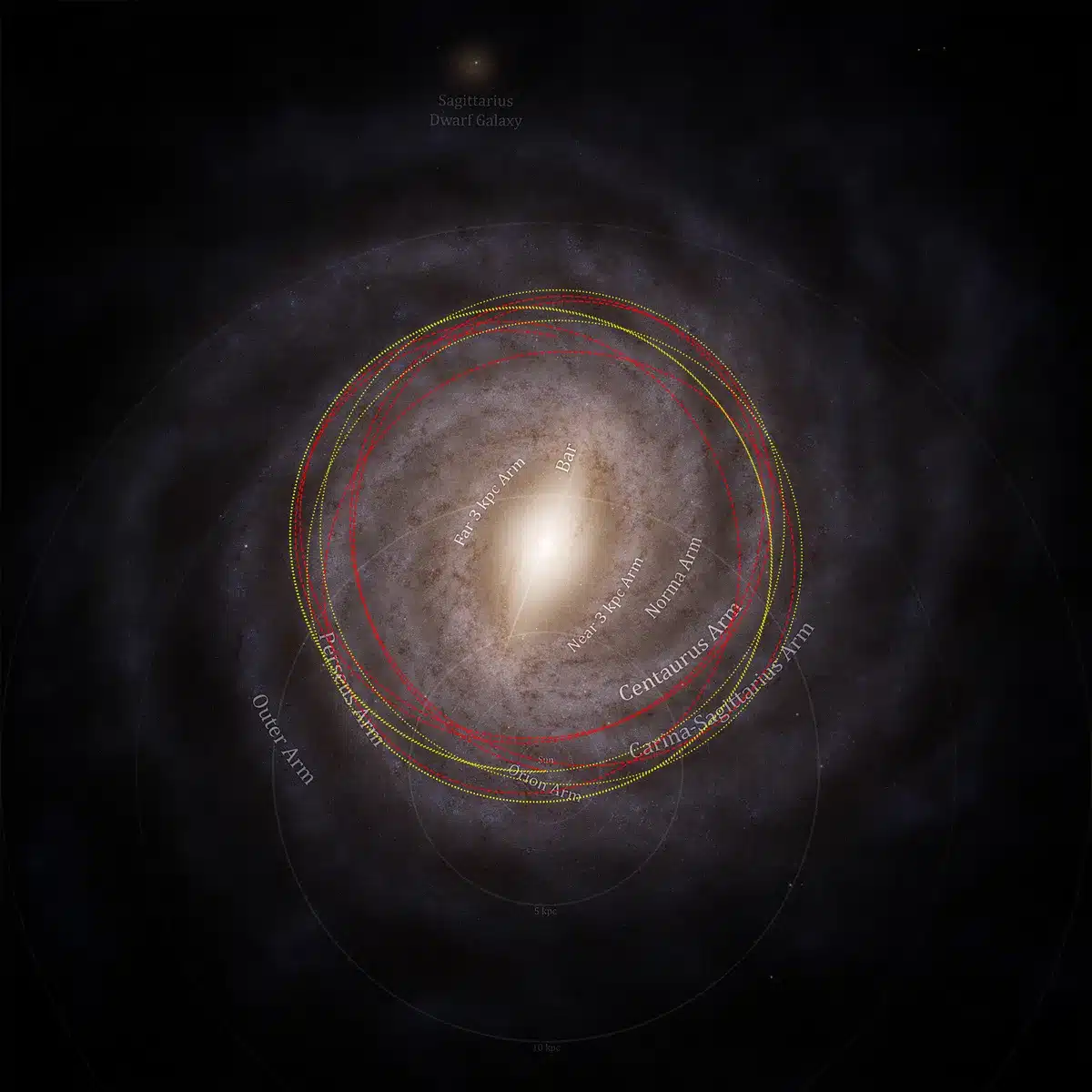
Une estimation de l’orbite de la comète 3I/ATLAS (rouge, en
pointillés) par rapport à l’orbite du Soleil (jaune, en pointillés)
à travers la Voie lactée. Crédit image : M. Hopkins/équipe
Ōtautahi-Oxford. Carte de base : ESA/Gaia/DPAC, Stefan
Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0Une composition qui pourrait
tout révéler
Si la couleur et la vitesse
offrent déjà des indices fascinants, c’est la composition chimique
qui pourrait véritablement confirmer l’origine de 3I/ATLAS. Le
modèle de Hopkins et ses collègues prédit que les objets provenant
du disque épais sont généralement riches en eau.
Cela laisse penser que, à
mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle devrait
développer une activité cométaire marquée, avec sublimation de la
glace et formation d’une queue spectaculaire. Cette prédiction
offre une hypothèse testable, un critère crucial en science pour
valider les modèles.
Vers une nouvelle
compréhension des objets interstellaires
Ce qui rend cette découverte
particulièrement excitante, c’est qu’elle ouvre une fenêtre sur un
pan jusqu’ici méconnu de notre galaxie. Jusqu’à présent, les objets
interstellaires détectés provenaient d’étoiles du disque mince, la
partie galactique où se trouve aussi notre Soleil. La comète
3I/ATLAS, elle, semble être un messager d’une autre époque et d’un
autre environnement galactique.
Selon les chercheurs, il
existerait des milliards de milliards d’objets interstellaires dans
la Voie lactée, certains pénétrant régulièrement dans le Système
solaire. Pourtant, la plupart sont trop petits ou trop sombres pour
être détectés avec nos instruments actuels.
La révolution des télescopes
nouvelle génération
Avec l’arrivée d’instruments
de nouvelle génération, comme l’observatoire Vera C. Rubin, les
astronomes espèrent détecter et étudier bien plus d’objets
interstellaires. Ce télescope, capable de découvrir des milliers
d’astéroïdes en quelques nuits, pourrait bientôt rendre visible
cette multitude d’intrus cosmiques.
Ce développement est une
véritable révolution : il permettra non seulement d’augmenter le
nombre d’objets détectés mais aussi d’obtenir suffisamment de
données pour comprendre leur diversité, leurs origines, et leurs
rôles dans la formation des systèmes planétaires.
Des implications pour la
formation des planètes
Au-delà de la simple curiosité
scientifique, ces recherches soulèvent une question fondamentale :
les objets interstellaires pourraient-ils jouer un rôle dans la
formation des planètes ? Certains théoriciens suggèrent que la
matière interstellaire, en s’incorporant dans les disques
protoplanétaires, pourrait influencer les premières étapes de la
création planétaire.
Si cela s’avère, notre propre
Terre pourrait être partiellement issue d’éléments venus de régions
lointaines de la galaxie. Une idée qui donne un nouveau sens à
notre place dans l’Univers, faisant de chaque planète un patchwork
d’histoires cosmiques multiples.
Un voyage à suivre de
près
La comète 3I/ATLAS est donc
bien plus qu’un simple corps céleste errant. Elle est une clé pour
ouvrir des portes encore fermées sur la composition, la dynamique
et l’histoire de la Voie lactée. Les prochains mois d’observation
seront cruciaux pour confirmer ses caractéristiques et tester les
prédictions des chercheurs.
Pour l’instant, les astronomes
restent aussi enthousiastes que prudents. Chaque nouveau détail
découvert pourrait soit conforter nos modèles, soit les bousculer.
Une chose est sûre : la comète 3I/ATLAS nous offre une occasion
unique d’en apprendre davantage sur notre galaxie et sur la nature
même des objets qui la traversent.
