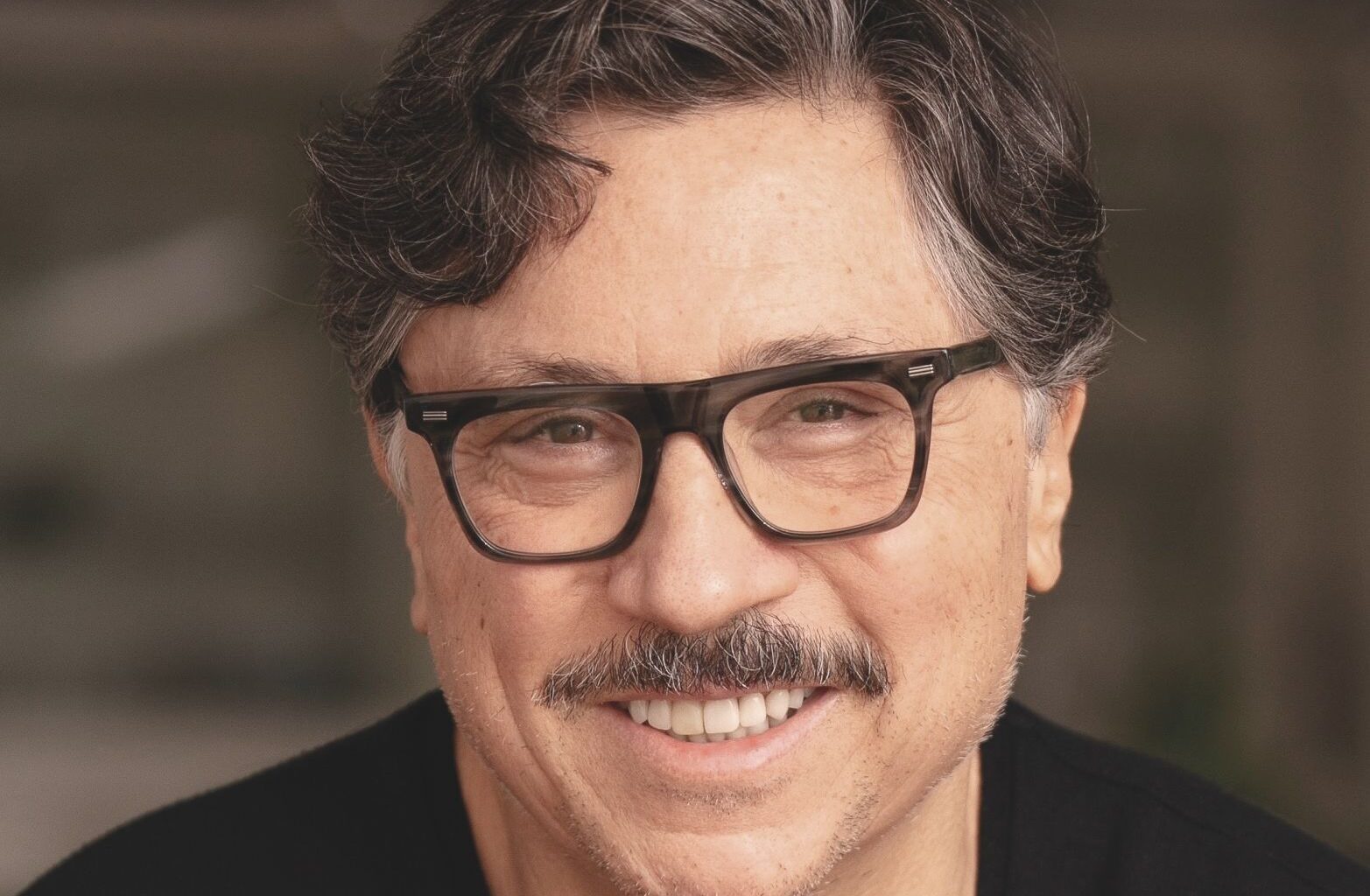Bien sûr, il y a l’aventure exotique de Badaq, un rhinocéros femelle convoyé au XVIe siècle d’une petite île de l’océan Indien jusqu’à Madrid. Mais Carlos Bardem se saisit de ce confetti dans la mythologie espagnole pour interroger la violence et la domination de l’homme sur la nature. Dans ce roman choral où l’homme se fait bête et l’animal se fait conscience, Bardem donne voix à tous, Indiens goguenards, religieux miséricordieux, capitaine cruel, et à Badaq elle-même : une lucidité animale, qui observe avec stupéfaction l’absurdité humaine.
Le récit, foisonnant, évoque tour à tour le fanatisme, la soif de pouvoir, la quête de justice de marins révoltés. Refusant le pittoresque du roman historique, l’auteur convoque le passé pour interroger notre présent – et ses égoïsmes persistants. Par sa langue charnelle et son humour noir, Badaq réfute les certitudes et convoque le doute. Au gré d’une visite des Collections royales, nous avons évoqué cette fresque, engagée sans dogmatisme, humaniste sans angélisme.
Le JDD. Votre roman donne la parole à une rhinocéros. Pourquoi ?
C.B. Je voulais comprendre la fracture qui nous oppose à la nature. J’aurais pu écrire un roman contemporain sur notre monde consumériste, mais l’histoire de Badaq me fascinait depuis l’enfance. J’ai choisi une voix animale pour que Badaq soit, par son bon sens, le miroir d’une humanité monstrueuse. Dans son regard, toute conquête est un pillage légitimé a posteriori.
La critique vaut-elle pour aujourd’hui ?
La suite après cette publicité
Évidemment. Le Moyen-Orient, l’Ukraine, les interventions impérialistes modernes reproduisent ces logiques. Mon roman parle du XVIe siècle, mais c’est notre présent qui m’obsède. Cependant, on écrit pour comprendre, pas pour expliquer, c’est la différence fondamentale entre littérature et propagande : je donne raison à des personnages qui n’ont rien à voir avec moi, au lecteur de juger. C’est aussi ce qui fait la différence entre la littérature, qui donne des doutes, et l’histoire, qui donne des conclusions.
La Déclaration des droits de l’homme est née à Auschwitz
Le roman historique comme cabinet de curiosités ne m’intéresse pas : j’écris sur le monde dans lequel je vis. Ça me permet de voir combien chaque avancée suit une tragédie : la Déclaration des droits de l’homme est née à Auschwitz. Cette alternance entre barbarie et sursauts humanistes rythme notre histoire. C’est pourquoi il y a toujours une place pour l’espoir : le pessimisme est une posture confortable mais stérile. L’espoir, lui, pousse à agir.
Certaines scènes sont d’une violence extrême. Pourquoi ce choix ?
Je refuse de masquer l’horreur. Si je raconte une atrocité, je la montre jusqu’au bout. Sinon, on anesthésie la conscience du lecteur. La violence, dans Badaq, n’est jamais gratuite : elle exprime des rapports de domination.
Vous êtes aussi acteur et scénariste. Cela influence-t-il votre écriture ?
Complètement. Mon métier d’acteur m’aide à incarner des personnages, à leur donner chair. Mais quand j’écris, je ne pense pas au cinéma. Badaq est inadaptable : trop abondant et trop littéraire. Je préfère faire confiance au lecteur pour tirer lui-même sur les fils et pour projeter mentalement le récit.
Badaq, Carlos Bardem, Le Cherche-Midi, 368 pages, 22,50 euros.