Les maux de tête chroniques, les
vertiges, les troubles de l’équilibre ou encore la vision floue
affectent des millions de personnes dans le monde. Si ces symptômes
sont souvent attribués à des causes environnementales ou
neurologiques classiques, une hypothèse récente ouvre une piste
inattendue : ils pourraient être liés à l’héritage génétique laissé
par nos lointains cousins néandertaliens.
C’est ce que suggère une étude
menée par Kimberly Plomp et ses collègues de l’Université des
Philippines Diliman. Publiée dans la revue Evolution, Medicine,
and Public Health, l’étude s’intéresse à une affection
appelée malformation de Chiari de type 1, une anomalie structurelle
du crâne qui toucherait environ 1 personne sur 100. Les chercheurs
ont découvert que la forme du crâne des individus atteints de cette
pathologie ressemble étonnamment à celle des Néandertaliens, ce qui
pourrait indiquer une origine évolutive insoupçonnée.
Une anomalie discrète mais
impactante
La malformation de Chiari 1
est une condition dans laquelle la partie inférieure du cerveau, le
cervelet, s’enfonce anormalement dans le canal rachidien. Cette
configuration engendre une compression de la zone, provoquant des
troubles variés : maux de tête sévères, vertiges, engourdissements,
troubles visuels ou auditifs, voire difficultés motrices. Bien que
cette forme soit considérée comme bénigne, ses effets sur la
qualité de vie peuvent être importants.
Ce qui intrigue les chercheurs
depuis plusieurs années, c’est la structure particulière du crâne
chez les personnes atteintes. Pour mieux comprendre l’origine de
cette malformation, l’équipe de Kimberly Plomp a analysé des scans
médicaux de 46 adultes porteurs de la maladie et les a comparés à
ceux de 57 individus non atteints. À partir de ces données, ils ont
construit des modèles 3D précis des structures crâniennes.
Résultat : les crânes affectés
par la malformation présentent une base plus plate et plus courte,
avec un os occipital (l’arrière du crâne) significativement réduit.
Cela crée un espace réduit à la jonction entre le crâne et la
moelle épinière, une configuration qui favorise justement le
glissement du cervelet vers le canal rachidien.
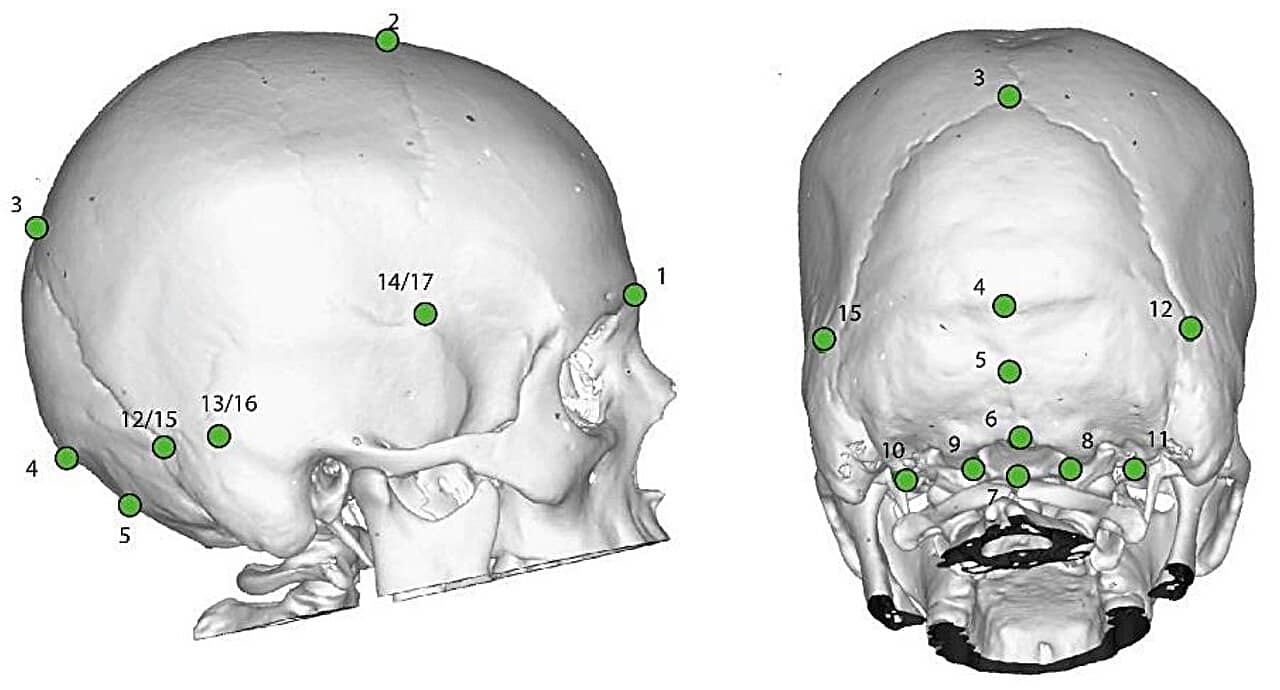
Repères utilisés dans la présente étude, représentés sur un modèle
3D tomodensitométrique du crâne d’un humain vivant sans CM-I.
Crédit : Evolution, Medicine, and Public Health (2025). DOI :
10.1093/emph/eoaf009À la recherche de nos
origines crâniennes
Mais l’étude ne s’est pas
arrêtée là. Les chercheurs ont élargi leur analyse en comparant ces
crânes modernes avec ceux de différentes espèces humaines anciennes
: Homo sapiens, Homo erectus, Homo heidelbergensis… et Homo
neanderthalensis.
C’est là que les choses
deviennent intéressantes. La forme de la base du crâne des patients
atteints de Chiari 1 ressemble fortement à celle des
Néandertaliens, alors que celle des témoins s’aligne davantage avec
l’anatomie de l’Homo sapiens moderne.
Ce rapprochement alimente ce
que les chercheurs appellent l’hypothèse d’introgression archaïque
: l’idée que certains traits anatomiques, y compris pathologiques,
que l’on observe chez les humains modernes pourraient provenir du
croisement génétique avec des espèces humaines aujourd’hui
disparues. On sait en effet que les personnes d’ascendance non
africaine possèdent environ 1 à 2 % d’ADN néandertalien dans leur
génome. Une proportion héritée des rencontres interespèces
survenues il y a environ 50 000 ans.
L’ADN néandertalien : vestige
ou fardeau ?
Selon les chercheurs, les
résultats sont cohérents avec une origine néandertalienne de la
malformation de Chiari 1, mais ne confirment pas totalement
l’hypothèse. Les similitudes anatomiques sont frappantes, mais la
preuve génétique directe reste à établir. En d’autres termes, le
lien est plausible, mais encore spéculatif.
La prochaine étape de la
recherche consistera donc à analyser le génome de patients atteints
de cette malformation pour y rechercher spécifiquement des
séquences d’origine néandertalienne. Si de tels gènes sont
identifiés, cela pourrait non seulement valider l’hypothèse de
l’introgression, mais aussi ouvrir la voie à des diagnostics plus
précoces et à de nouvelles stratégies de traitement.
Un rappel sur l’héritage de
l’évolution
Au-delà de l’aspect médical,
cette étude soulève une question fascinante : dans quelle mesure
sommes-nous encore influencés par notre passé évolutif ? L’idée que
des traits issus de l’évolution humaine ancienne puissent encore
affecter notre biologie contemporaine nous rappelle que l’héritage
génétique n’est pas toujours bénéfique.
Des adaptations utiles il y a
des milliers d’années – comme un crâne adapté à un mode de vie
robuste et physique – peuvent se transformer en handicaps dans un
environnement moderne, où nos cerveaux plus volumineux et notre
station debout permanente exigent une architecture crânienne
différente.
En définitive, ce que nous dit cette étude,
c’est que nos douleurs d’aujourd’hui pourraient être les échos
lointains d’un passé archaïque. Un passé inscrit dans nos gènes,
silencieux mais tenace. Et si une partie de notre mal de crâne
venait, littéralement, de l’âge de pierre ?
