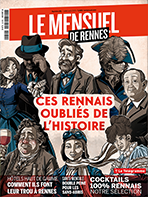Le tee-shirt, taché de sang, est troué comme du gruyère. Les bras, malingres, sont parsemés de tatouages essorés qui ne représentent plus grand-chose. Dans le métro, l’homme nous interpelle, sans terminer sa phrase. Il lève un regard implorant, avant de reprendre, tête baissée, son dialogue sans queue ni tête avec un personnage imaginaire. Souvent aperçu en train de zoner dans le secteur de la gare, il incarne les ravages d’une vie d’errance sur la santé mentale.
Le Mensuel de Rennes
Magazine curieux et (im)pertinent !
Découvrez
À Rennes, il n’existe pas de données précises sur la fréquence des troubles psychiatriques chez les personnes à la rue. Selon l’Inserm, qui a compilé quatre études sorties entre 1996 et 2009, la prévalence des « troubles psychotiques » dans la population de SDF oscille autour de 14 % contre moins de 1 % dans la population générale. Les chiffres montent à 18,5 % pour les « troubles dépressifs majeurs » et à 22 % pour les « troubles de la personnalité ». Chez les badauds, rares sont ceux qui ne remarquent pas une détérioration de la santé mentale des sans-abris. « Il ne faut cependant pas tomber dans le leurre qui consiste à dire qu’il y avait un temps béni pour les SDF, prévient Yannick Nadesan, adjoint en charge de la santé à la Ville. Vivre dans la rue abîme les corps, mais aussi les esprits. »
Augmentation du nombre de SDF
Cette impression de dégradation relève notamment de l’augmentation du nombre de vagabonds. En moins de cinq ans, les chiffres ont bondi. La Fondation pour le logement des défavorisés (ex-Fondation abbé-Pierre) comptabilise, en 2025, 350 000 personnes sans domicile en France. À Rennes, les dernières estimations, de 2023, évoquent le chiffre de 2 000 personnes à la rue. Soit quasiment un SDF pour 100 habitants. Et la tendance est à la hausse.
« Il y a quelques mois, on accueillait une moyenne de 150 personnes, mais, depuis le second semestre 2024, on passe régulièrement la barre des 200 », constate Gaëlle Exelmans, responsable du restaurant social Le Fourneau. La situation risque encore de se dégrader cet été, craint David Travers, maire adjoint chargé de la solidarité et responsable de l’unité de psychiatrie Samu au CHU de Rennes. « Traditionnellement, la période estivale coïncide avec des mouvements plus importants de population, et plus de SDF qui viennent à Rennes. » L’été est aussi la saison de l’isolement pour les SDF. Moins de possibilités de manche, moins de structures d’accueil ouvertes, moins de bénévoles… De quoi aggraver une situation sanitaire déjà critique sur le plan de la santé mentale selon les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.
Crise de la psychiatrie
Comment en est-on arrivé là ? Il y a d’abord les facteurs individuels. « On tombe à la rue avec des fragilités. La rue augmente les symptômes, analyse Stanislas Flavigny, éducateur spécialisé au CCAS de Rennes. Pas de travail, pas de logements, une santé physique défaillante. La personne tombe dans un cercle vicieux. » Tous les spécialistes pointent également les impacts « catastrophiques » de la crise sanitaire. Absence de passants -et donc de sources de revenus-, structures médico-sociales au ralenti, règles strictes de distanciation dans les lieux d’accueil, stress lié au virus… Les personnes sans abri ont été les premières à souffrir de la pandémie.
Quatre ans plus tard, elles en payent encore le prix. La décompensation peut se faire longtemps après l’élément déclencheur, expliquait Pascal Bénard, directeur du Centre hospitalier Guillaume-Régnier (CHGR), dans Le Mensuel, en septembre 2024. Depuis la pandémie, la demande d’écoute se fait davantage sentir. « Le covid a mis en lumière l’importance du lien social, explique Mathilde Guillemin, responsable inclusion ouest à l’association Entourage. De plus en plus de personnes, dans la rue, ont eu besoin qu’on leur tende la main. »
Une fois toutes les deux semaines, l’association organise des maraudes. Pas pour donner à manger, juste pour recueillir la parole de ces laissés-pour-compte. « On peut parler 30, 40 minutes, voire 1 heure avec la personne. » Ces échanges pallient, bon an mal an, les ruptures dans le suivi psychiatrique de certains patients sans domicile.
C‘est que la psychiatrie, à Rennes comme dans toute la France, est en crise. Depuis 2017, 150 lits ont été supprimés au CHGR dans un contexte où les postes de psychiatres manquent. « Le nombre de lits a évolué au sein de l’établissement pour autant, la qualité et la continuité de la prise en charge (…) n’ont pas été altérées », se défend Pascal Bénard après la pandémie. Pourtant, les sans-abris sont confrontés à deux écueils. Les soins ambulatoires -privilégiés pour pallier le manque de lits- sont plus compliqués à mettre en place pour un public sans domicile. Idem pour la sectorisation -les patients sont normalement répartis en fonction de leur adresse-, propre à la psychiatrie. « (Les SDF) sont pris en charge selon leur lieu de vie habituel, qu’il s’agisse d’un squat ou d’un hébergement », précise le directeur du CHGR. En cas d’hospitalisation, ils sont orientés selon le principe de la « file indienne » dans les différents secteurs de la psychiatrie adulte du département.
Impact du narcotrafic local
Parallèlement, une équipe mobile psychiatrie et précarité (EMPP) intervient sur demande des professionnels. En 2016, elle avait accompagné un peu plus de 400 personnes. Pour une population de SDF deux fois inférieure à aujourd’hui. Plusieurs autres mécanismes visent à mieux les suivre dans leur parcours de santé. Par exemple « Un chez soi d’abord », piloté par le CHGR, permet aux SDF de trouver un logement. 34 personnes -sur 2 000 SDF- en ont bénéficié en 2023. Malgré tous ces dispositifs existent d’énormes trous dans la raquette, pointent la plupart de nos sources. Pour de simples consultations en CMP, la durée moyenne pour un rendez-vous avec un psychiatre est de… huit mois à Rennes. Un délai bien trop long, impossible à tenir pour une population très mobile. Et qui peut conduire le patient à glisser encore davantage.
D’autant plus que l’essor du narcotrafic ces dernières années à Rennes a débouché sur une offre plus importante de drogues. Et sur une explosion de la demande, notamment dans les milieux marginaux. « On voit de plus en plus de SDF dans des états de santé mentale très précaires depuis quelque temps, admet David Travers. Le trafic de drogues n’est pas celui d’il y a vingt ans. Désormais, il y a une stratégie de commercialisation massive. »
Arrivée du crack
Produits de synthèse, héroïne, mais surtout cocaïne… « Avec l‘augmentation des consommateurs de cocaïne, on voit une hausse des comportements d’hypervigilance, de la parano. Des sensations d’avoir des insectes sous la peau par exemple, l’aggravation des problèmes psy ou l’apparition de problèmes psy en lien avec un usage de coke trop intensif », témoigne, dans le chapitre du rapport Trend 2023 consacré aux addictions dans les « espaces de la marginalité urbaine », un intervenant.
L’essor de la « C » a amené, dans son sillage, une explosion de la consommation de crack ou « coke basée » dans les milieux marginaux. Contrairement à la cocaïne, elle ne se sniffe pas, mais se fume à l’aide d’une pipe. Elle est plus économique en raison des adjuvants bon marché comme l’ammoniac ou le bicarbonate ajoutés à la « fée blanche ». David Travers note, « depuis 4-5 ans », une augmentation grandissante de demande de matériel lors des déambulations du dispositif Noz’ambule, visant à réduire les risques liés aux addictions.
Fantasme de la violence
Même si l’on n’en est pas encore à des regroupements tels que la « colline au crack » à Paris, le phénomène inquiète. Notamment pour les conséquences qu’il est susceptible d’engendrer. « Chez le public précaire, il y a une montée de la violence avec de plus en plus de vols entre eux. Ça change au niveau de l‘ambiance, (…), avec des patients régulièrement agressés, c’était moins le cas les années précédentes », affirme un infirmier en addictologie cité dans le rapport Trend. Cette montée de la violence, les travailleurs sociaux la ressentent aussi. Gaëlle Exelmans remarque « des états un peu plus explosifs qu’avant ».
Les faits divers impliquant des marginaux victimes de troubles psy demeurent rares. « Les faits graves sont moins présents que dans la population générale », confirme David Travers. Fin mars, un marginal de 40 ans a cependant été arrêté après le viol et le meurtre de Monique, une septuagénaire habitant avenue Sergent Maginot (Le Mensuel de mai). En novembre 2023, un autre homme de 32 ans avait aussi agressé de trois coups de couteau un artisan dans le quartier sud-gare, sans aucune raison. Interpellé, il avait été immédiatement hospitalisé en milieu spécialisé. Des faits divers tragiques, mais isolés.
Surtout des victimes
Les excès de violence s’exercent principalement entre marginaux. Une réalité éloignée de la perception que peut avoir l’opinion. « L’image du marginal est empreinte d’un imaginaire entre compassion et inquiétude, analyse Stanislas Slavigny. Le trouble psychique génère ce même imaginaire. » La conjonction des deux entraîne une appréhension encore plus grande dans la représentation collective, malgré des chiffres attestant que les SDF sont avant tout des victimes.
En 2012, une enquête de l’Insee indiquait que 25 % des sans-abris francophones avaient subi des violences au cours des deux années écoulées. A contrario, en 2023, 1 382 faits de coups et blessures volontaires ont été enregistrés à Rennes. Soit moins d’un habitant sur 100 touché par les violences. Contre 1 SDF sur 4 en France.