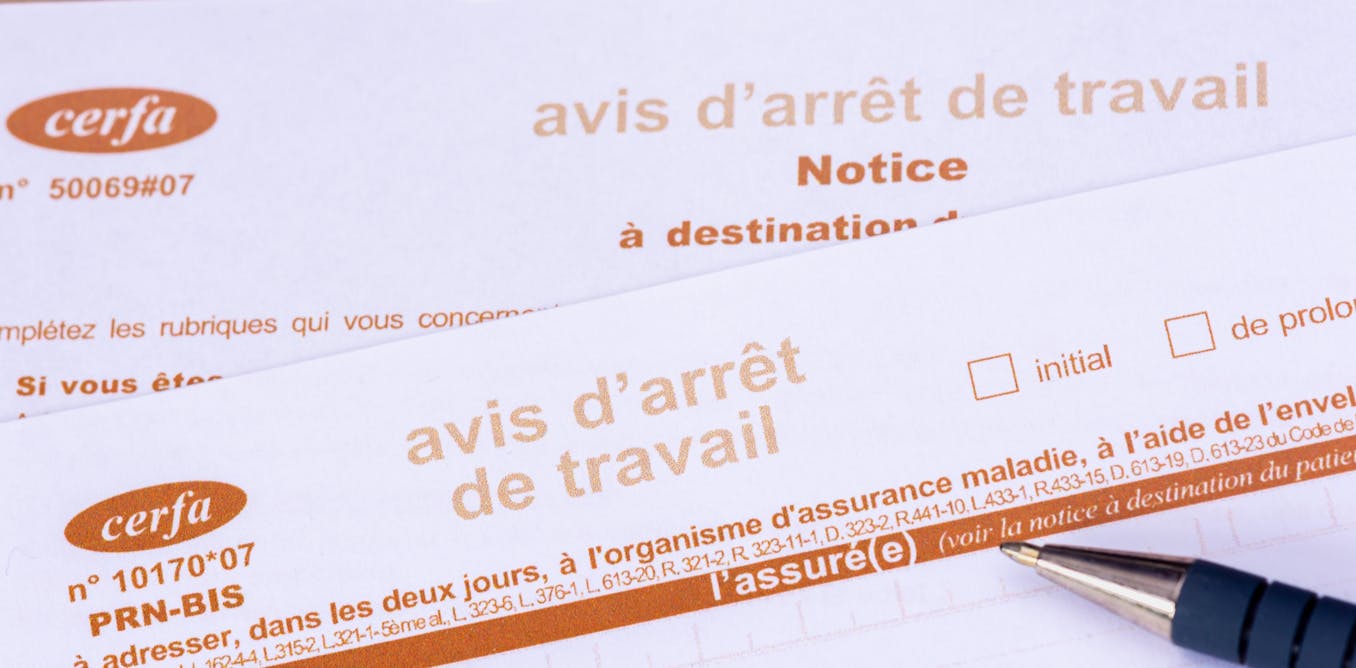Le droit européen vient de prendre une décision en faveur des salariés, contrairement à ce que prétendait jusqu’ici le droit français. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là.
Sous l’influence du droit européen, nous savons désormais que pendant un arrêt maladie, un salarié continue d’acquérir des droits à congés payés qu’il pourra déposer après son retour au travail.
Néanmoins, la situation d’un salarié faisant l’objet d’un arrêt maladie alors qu’il se trouve en période de congés payés semble incertaine. En effet, ce dernier peut-il reporter ultérieurement les congés acquis dont il n’a pas bénéficié du fait de son arrêt de travail ?
Les contradictions des droits français et européen
Par le biais de plusieurs arrêts de l’automne 2023 (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340 à 22-17.342, n°22-17.638 et n°22-10.529 et 22-11.106), la Cour de cassation s’appuyant sur le droit européen (l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et l’article 7 §1 de la directive n°2003/88/CE), a contraint le législateur à modifier sa position au sujet de l’articulation des périodes de congés payés et de maladie (loi nº2024-364 du 22 avril 2024). En effet, par le passé, le droit français indiquait qu’il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel (ancien article L.3141-5 du Code du travail). Or, cette disposition nationale était contraire à celle du droit européen découlant d’une directive (article 7 §1 de la directive n°2003/88/CE) et de l’article n°31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissait à tous les salariés un minimum de quatre semaines de congés payés annuels. Le juge européen nous précisait que cette période de congé ne pouvait pas être subordonnée « par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État » (CJCE, 20 janvier 2009, n°C-350/06 et CJUE, 24 janvier 2012, n°C-282/10).
En outre, en reconnaissant que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne avaient désormais un effet impératif s’imposant aux états membres, le juge européen avait décidé qu’en cas de non-conformité avec les dispositions de l’Union, les juridictions nationales devaient laisser la réglementation nationale en cause inappliquée (CJUE, 6 novembre 2018, n°C-619/16). Suivant la combinaison de ces deux logiques, la Cour de cassation a par conséquent décidé d’écarter les dispositions non conformes du Code du travail empêchant toute acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ordinaire ainsi que celles limitant l’acquisition des congés en cas d’arrêt de travail pour accident (ancien article L.3141-5 du Code du travail).
Dès lors, sur le fondement du droit européen, la Cour de cassation est parvenue à contraindre le législateur jusqu’alors très réticent à toutes modifications en ce domaine, à garantir à tout travailleur en arrêt maladie l’acquisition d’une période annuelle de congés payés.
Read more:
Le droit est-il impuissant au sujet de l’égalité de rémunération femmes-hommes ?
Le travailleur malade continue d’acquérir des congés payés
En effet, la jurisprudence en question est à l’origine du vote de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 dont il ressort que désormais le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d’acquérir des droits à congés, quelle que soit la cause de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle). Il en découle qu’il bénéficie également d’un droit au report des congés qu’il n’a pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident. Désormais, l’ensemble des arrêts maladie constituent donc des périodes assimilées à du temps de travail effectif, quelle que soit leur durée.
Toutefois, selon le motif de l’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel), les droits à congés payés annuels sont calculés différemment. En effet, si la maladie est d’origine non professionnelle, le salarié acquiert deux jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit vingt-quatre jours ouvrables s’il a été absent pendant toute la période d’acquisition. Toutefois, si la maladie est d’origine professionnelle (ou accident du travail), celui-ci acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois d’absence, dans la limite de trente jours ouvrables.
De surcroît, si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie (professionnelle ou non), il bénéficie d’une période de report de quinze mois au maximum. Par conséquent, il en résulte que les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de quinze mois sont perdus. Dès lors, après un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié, le nombre de jours de congés dont il dispose (soit le nombre de jours acquis) ainsi que la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris (soit le délai dont le salarié dispose pour les poser).
L’arrêt maladie survenant pendant les congés payés
Toutefois, la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 ne semble pas envisager précisément la question de l’arrêt maladie survenant durant les congés payés du salarié.
À cette date, la Cour de cassation nous précise que lorsqu’un arrêt de travail débute durant une période de congés payés, le salarié relève de ce seul et unique régime. Par conséquent, les congés payés étant la cause initiale de la suspension du contrat de travail, l’arrêt maladie ne peut pas s’y substituer. Dès lors, si, pendant ses congés, le salarié arrêté pour maladie accomplit les formalités requises (envoi d’un arrêt de travail), l’employeur doit uniquement lui verser son indemnité de congés payés sans défalquer les indemnités journalières de la sécurité sociale (Cass. Soc. 2 mars 1989, n° 86-42426, BCV n°173). Il en ressort que, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus avantageux, le salarié ne peut donc pas exiger de prendre ultérieurement les congés payés s’étant confondus avec son arrêt (Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44907, BCV n°420).
Néanmoins, précisons que la Cour d’appel de Versailles est déjà allée à rebours de cette position ancienne de la Cour de cassation en jugeant que, si le salarié a été en arrêt maladie durant ses congés, il pouvait prétendre au report des jours de congés payés correspondant aux jours d’arrêt maladie (CA Versailles 18 mai 2022, RG n° 19/03230).
Toutefois, les juristes estiment que cette position isolée ne constitue pas un revirement de la jurisprudence française. Par conséquent, au regard du droit national, le sort du salarié malade durant ses congés payés est bien incertain. Or, de son côté, le juge européen a clairement indiqué que lorsqu’un salarié tombe malade alors qu’il était déjà en congés payés, il a droit à un report des jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier dans la limite du congé annuel minimal de quatre semaines (CJUE 21 juin 2012, Aff. C-78/11).
De surcroît, il considère que tout travailleur peut se prévaloir de ce droit, car il est nécessaire de préserver ses congés payés, dont la finalité est de lui permettre de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Par conséquent, ces contradictions sont source d’incertitudes pour le salarié, mais également pour l’employeur confrontés à cette situation relativement courante.
La France mise en demeure
C’est précisément sur ce point que le 18 juin 2025, la Commission européenne a mis en demeure, la France pour manquement aux règles sur le temps de travail découlant de la directive n°2003/88/CE, en considérant que la législation française « ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs ». Elle lui accorde donc un délai de deux mois pour répondre à sa lettre de mise en demeure.
Dès lors, si elle ne propose pas de mesures corrective, la Commission pourrait émettre un avis motivé, étape préalable à une éventuelle saisine de la Cour de justice de l’Union européenne qui estime que la finalité des congés annuels (temps de repos et de loisirs) ne peut être confondue avec celle de la maladie (temps de rétablissement) (CJUE, 21 juin 2012, Aff. C-78/11).
En somme, l’Union européenne garantit la santé et le progrès social des travailleurs alors que fleurissent de nombreux projets de récession de droits notamment en matière de prise en charge des arrêts maladie et de durée des congés payés.