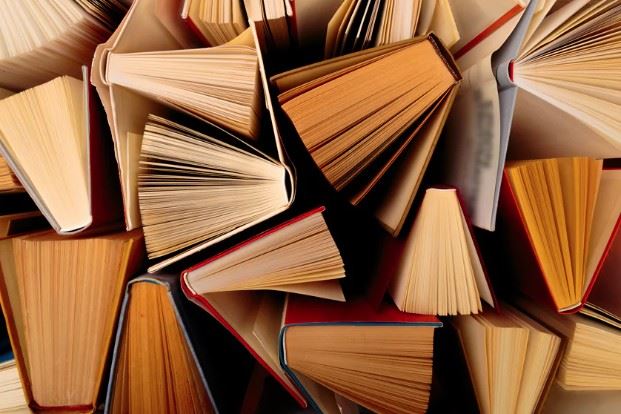La rue, le militantisme, Libé… Deux ans après L’enragé, Sorj Chalandon revient avec un roman dense et intime sur son adolescence à Paris. Critique.
De Sorj Chalandon, on connaissait le journaliste, grand reporter pendant 34 ans au quotidien Libération, qui a couvert la guerre d’Irlande, du Liban ou le procès Klaus Barbie. On connaissait aussi la relation au père. Cet homme, mythomane et violent, qui traverse son œuvre et à qui il a consacré plusieurs livres (Profession du père, 2015 et Enfant de salaud, 2021). Mais on connaissait moins bien le gamin des rues, émancipé à 17 ans, quittant Lyon pour Paris où il vagabonde un temps avant de rejoindre les rangs de l’extrême gauche.
C’est chose faite cette année, avec Le livre de Kells. À travers ce personnage, Kells, nom énigmatique tiré d’un manuscrit celtique du IXe siècle, l’auteur raconte, par le truchement de la fiction, sa propre histoire. Il admet toutefois y avoir « changé des patronymes » et « quelques faits ».
Gavroche des années 1970
Le livre s’ouvre sur un départ. Kells claque la porte du domicile familial. Il cherche moins à voyager qu’à fuir « l’Autre », ce père qu’il préfère ne pas nommer, comme pour tenir à distance le mauvais sort de la filiation. Lorsqu’il arrive à Paris, sans bac ni un sou en poche, c’est un enfant perdu.
On suit ses pérégrinations à travers les rues de la capitale. D’un groupe de jeunes usés par la drogue à la misère d’une chambre d’hôtel insalubre. Sans oublier les déboires infligés par les patrons véreux. Avec sa plume probe et ses mots en petit nombre, minutieusement choisis, l’auteur raconte la faim, la violence et la détresse, dans un réalisme qui trahit l’expérience vécue.
Les 150 premières pages de Sorj Chalandon sont marquantes. Elles nous embarquent dans un tunnel sombre, comme les refuges de fortune où le personnage passe ses nuits. Au moment où cette dureté nous essouffle, le roman s’illumine. Sur le parvis de Saint-Lazare, Kells croise le chemin de Marc, blouson noir, qui vend un journal interdit : La cause du peuple. Bientôt, Marc lui présente Norman, puis Daniel, Yves, Yann et les autres.
Récit initiatique
Le livre de Kells est un roman d’émancipation. Aux côtés des militants de la « GP », la « Gauche prolétarienne », qui lui tendent la main sans contrepartie, le jeune Kells doit tout réapprendre. Cette bascule de la rue, où règne un climat de défiance permanente, à un environnement fraternel, est saisissant. Elle nous donne une idée de la précarité, où l’acte de générosité le plus anodin revêt une importance considérable.
À l’image de ce passage où pour la première fois de sa vie, Kells est convié à une fête dans un appartement. Sur le chemin du retour, Daniel lui demande pourquoi il n’a pas goûté au vin blanc, ni touché à la nourriture. Kells lui répond qu’il aurait aimé, mais qu’il n’avait « pas un centime ». « Tu as pensé que c’était payant ? », lui répond son ami, abasourdi.
S’ouvre à Kells un monde aux antipodes de celui qu’il fuyait. Où le théâtre, le cinéma et la littérature remplacent Mein Kampf et un livre sur la Waffen-SS, les deux seuls titres qui avaient droit de cité dans l’appartement familial.
Une époque violente
À cette ouverture nouvelle, il faut opposer l’omniprésence de la violence. Comme il l’a déjà prouvé avec Mon traître (2008), Retour à Killybegs (2011) ou Le quatrième mur (2013), Sorj Chalandon excelle dans l’art d’enchâsser des destins fictifs à la grande Histoire. À travers les yeux de Kells, son alter ego romanesque, il nous fait traverser les années 1970 à Paris.
Une époque brutale, où l’activisme était rythmé par des affrontements sanglants entre mouvements d’extrême droite et d’extrême gauche. À la Gauche prolétarienne, fondée au lendemain de Mai 68 par des militants maoïstes, la violence, à coups de barres de fer et de bombes incendiaires, était un moyen de lutte légitime.
Avec Le livre de Kells, Sorj Chalandon signe cette année son roman le plus personnel. Il fait le jour sur l’adolescent fragile qu’il a été et dont le destin n’a, pendant un temps, tenu qu’à un fil. « N’importe qui m’aurait tendu les mains, ça aurait été l’église de scientologie, ça aurait été la haute confrérie des compagnons de l’oignon, j’y allais ». Dense et sûrement moins accessible que ses précédents romans, Le livre de Kells est le témoignage d’une époque violente, qui porte en lui les stigmates du militantisme de rue. Moins romanesque que réaliste, ceci ne le rend que plus puissant.