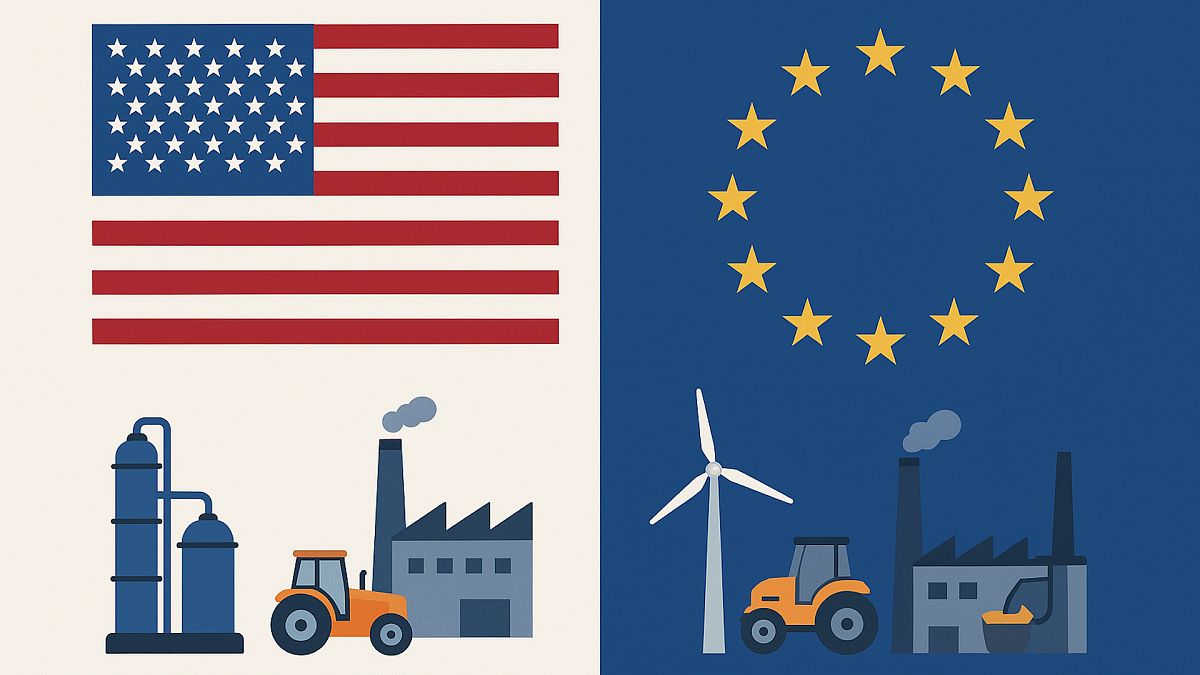PUBLICITÉ
Malgré les similitudes culturelles et les avancées technologiques, l’écart de productivité entre l’Europe et les États-Unis non seulement persiste, mais se creuse.
Dawid Osiecki, expert du marché des nouvelles technologies et coauteur d’un rapport de 40 pages analysant le développement économique des deux côtés de l’Atlantique, nous explique pourquoi il en est ainsi et ce qui peut y remédier.
« Nous avons récemment réalisé une étude dont il ressort clairement que la différence entre les États-Unis et l’Europe n’est pas seulement l’argent, mais aussi le nombre de grandes entreprises capables de mettre en œuvre avec succès les nouvelles technologies, y compris l’IA », explique l’expert.
Une révolution technologique dont l’Europe n’a pas su tirer parti
« En comparant les données depuis 1996, on voit très clairement que les États-Unis ont mieux réussi à se remettre des crises successives – la crise financière de 2008, la crise des pandémies ou la crise actuelle liée à la transformation de l’IA. Chacune de ces crises a entraîné une accélération de la productivité. En Europe, c’est la stagnation », explique notre interlocuteur. Les principales différences ? L’investissement et la structure de l’économie. Le marché boursier américain est dominé par ce que l’on appelle les Big Techs – les sept plus grandes entreprises technologiques qui non seulement génèrent une énorme croissance de la valeur, mais mettent également en œuvre efficacement les dernières technologies. L’Europe ? « Nous n’avons pas saisi cette opportunité », admet Dawid Osiecki.
L’intelligence artificielle : une opportunité ou le prochain défi ?
Le rapport de Mario Draghi intitulé « Comment améliorer la compétitivité de l’Union européenne » indique que l’intelligence artificielle pourrait permettre à l’Europe de réduire l’écart avec les États-Unis. Mais même dans ce domaine, la situation n’est pas simple. Les travailleurs européens déclarent comprendre à 95 % les avantages de l’IA, mais 2/3 d’entre eux craignent de perdre leur emploi. Pire encore, les trois quarts soulignent le manque d’accès réel aux outils d’IA sur le lieu de travail. Et 1/3 d’entre eux évoquent un manque de formation et d’éducation pour mieux utiliser les nouvelles technologies.
Moins de géants, plus de moyennes entreprises
Les données recueillies dans le cadre d’une enquête menée auprès de 800 entreprises de six pays européens montrent que les plus grandes entreprises européennes (d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars) gèrent l’adoption de l’IA à un niveau comparable à celui des géants américains. Les problèmes commencent dans les petites entreprises.
« Le problème se situe plus bas. Les petites entreprises, en particulier celles dont la valeur est comprise entre 1 et 2,5 milliards d’euros, ont trois fois moins de chances de réussir à mettre en œuvre l’IA que leurs homologues américaines », explique le spécialiste.
En outre, l’économie européenne est plus fragmentée : il y a plus de moyennes entreprises, mais moins de géants mondiaux. Ces petites organisations ont souvent un accès limité à la technologie, aux outils et au personnel spécialisé. La taille des entreprises n’est pas le seul facteur déterminant. Les différences sectorielles sont tout aussi importantes. L’aérospatiale, la défense et l’industrie de pointe sont à la pointe de l’utilisation de l’IA en Europe. En revanche, le secteur public ou le secteur de l’énergie sont des exceptions significatives, avec des différences de plusieurs dizaines de points de pourcentage.
Les résultats varient également d’un pays à l’autre. La Suisse, l’Allemagne et la France sont en tête, mais une fois la structure sectorielle prise en compte, c’est le Royaume-Uni qui apparaît comme le leader, avec des niveaux d’adoption de l’IA supérieurs à 50 %. La France, en revanche, malgré ses grandes entreprises et ses ambitions technologiques, affiche un taux d’adoption étonnamment faible, de l’ordre de 30 %. L’Espagne et l’Italie sont en queue de peloton.
Manque d’investissement, manque de courage
« Le plus gros problème ? L’investissement », l’expert n’en doute pas. Entre 2013 et 2023, le capital investi dans les nouvelles technologies aux États-Unis a été de 5 à 7,5 fois supérieur à celui de l’Europe. Dans le même temps, les entreprises européennes ont tenté de compenser les différences organisationnelles, mais en vain.
« On ne peut pas se contenter de se serrer la ceinture pendant une décennie et attendre des résultats. Il faut investir, former, mettre en œuvre les nouvelles technologies avec courage », souligne David Osiecki.
Qu’en est-il de la réglementation ?
La bureaucratie européenne est souvent considérée comme un obstacle à l’innovation. Mais, selon notre interlocuteur, « les plus grands acteurs européens s’en accommodent sans trop de problèmes ». Pour les petites entreprises, en revanche, la réglementation peut être une excuse ou un obstacle. Selon lui, la clé n’est pas seulement la simplification de la réglementation, mais surtout des décisions plus rapides, plus de courage et une éducation technologique de masse.
La course européenne contre la montre
L’Union européenne a des objectifs ambitieux : d’ici 2030, 75 % des entreprises devraient utiliser les technologies du cloud et de l’IA et au moins 20 millions de citoyens devraient avoir des compétences numériques avancées. Il s’agit là d’un énorme défi organisationnel, financier et social. Si l’Europe veut préserver sa souveraineté technologique et sa compétitivité économique, elle ne peut pas se permettre de tarder.
Il sera essentiel d’accroître les investissements dans les nouvelles technologies, d’aider les entreprises de taille moyenne à adopter l’IA, de combler le fossé entre les secteurs et les pays, de débloquer des outils pour les travailleurs et de leur fournir une formation.
« Si nous ne le faisons pas, la productivité européenne continuera d’être à la traîne. Et derrière elle, la compétitivité de tout le continent », conclut Dawid Osiecki.