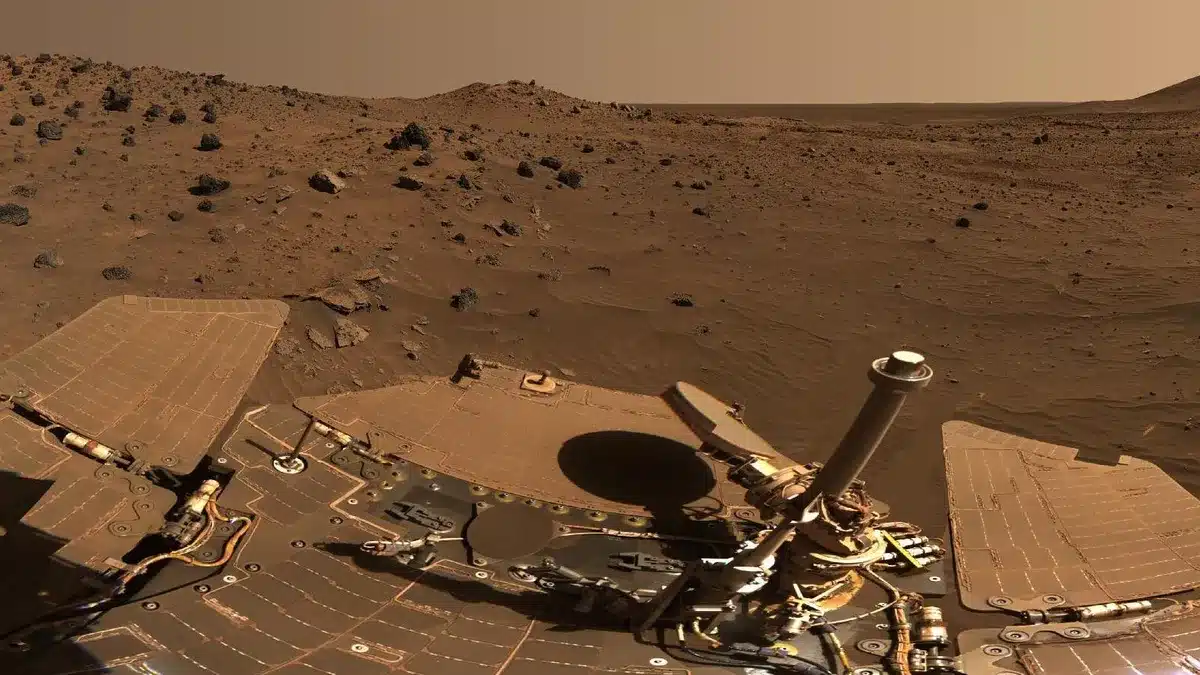Une équipe de
chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison révèle que les
agences spatiales mondiales, incluant la NASA et l’Administration
spatiale chinoise, ont fondamentalement mal compris la physique des
autres corps célestes lors de la conception de leurs rovers. Cette
erreur méthodologique majeure expliquerait pourquoi tant de
missions d’atterrissage échouent encore aujourd’hui. L’étude,
publiée dans le Journal of Field Robotics, remet en
question des décennies de pratiques établies dans l’exploration
spatiale.
L’énigme
des échecs répétés
Malgré les progrès
technologiques considérables, l’exploration robotique du système solaire demeure semée
d’embûches. Les atterrissages ratés sur la Lune se multiplient,
tandis que sur Mars, le rover Spirit de la NASA a connu une fin
prématurée après s’être enlisé dans du sable mou, ses roues ayant
percé une croûte superficielle plus fragile que prévu.
Ces incidents ne relèvent
pas de la malchance ou de défaillances techniques isolées. Ils
révèlent une lacune fondamentale dans notre approche de
l’exploration spatiale : une incompréhension systématique de la
façon dont la gravité réduite affecte non seulement nos machines,
mais aussi les surfaces sur lesquelles elles évoluent.
Une
approche de test défaillante depuis des décennies
Traditionnellement, les
agences spatiales testent leurs rovers dans des environnements
terrestres supposés analogues : déserts, terrains aménagés comme le
célèbre « Mars Yard » du Jet Propulsion Laboratory. Pour
compenser la gravité réduite de Mars (environ 38% de celle de la
Terre), les ingénieurs allègent leurs prototypes de test.
L’exemple du rover
Curiosity illustre parfaitement cette méthode : son prototype
terrestre fut délesté de 567 kilogrammes, passant de 907 à 340
kilogrammes pour reproduire son poids martien. Cette approche
semblait logique et fut appliquée pendant des années par toutes les
agences spatiales.
Bryan Martin, responsable
des logiciels de vol au JPL, résumait cette philosophie :
« Nous testons énormément pour déterminer ce qu’il faut
éviter. Ce que nous avons traversé en sécurité ici permet aux
pilotes de rovers de planifier leurs trajets sur
Mars. »
L’erreur
cachée dans l’équation
L’équipe de Dan Negrut a
identifié le défaut fatal de cette logique : en ne modifiant que la
masse du rover, les ingénieurs oublient que la gravité terrestre
continue d’agir sur le sol de test avec sa force normale. Résultat
: le terrain terrestre conserve une résistance et une cohésion
supérieures à ce qu’elles seraient réellement sur Mars ou la
Lune.
« L’idée est
simple rétrospectivement », explique Negrut.
« Nous devons considérer non seulement l’attraction
gravitationnelle sur le rover, mais aussi l’effet de la gravité sur
le sable pour mieux anticiper les performances
lunaires. »
Sur Mars, chaque particule
de poussière et de sable subit une attraction gravitationnelle
trois fois moindre que sur Terre. Cette différence modifie
radicalement les propriétés mécaniques du sol : sa limite
d’élasticité, sa résistance au cisaillement, sa capacité à
supporter le poids d’un rover.
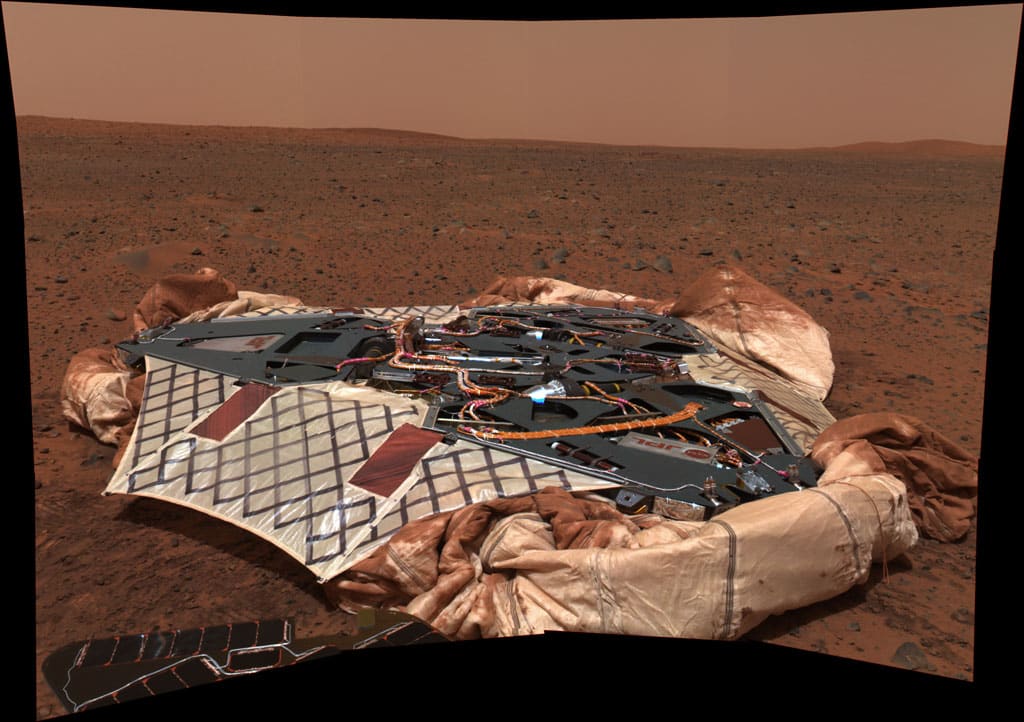
Photographie prise par le rover Spirit de son atterrisseur sur la
surface de Mars le 18/19 janvier 2004 (Spirit sol 16). Crédits :
NASA/JPLDes
simulations révélatrices
Travaillant sur la mission
VIPER (aujourd’hui annulée), l’équipe a utilisé Project Chrono, un
simulateur de physique open source. Les résultats ont révélé des
écarts significatifs entre les performances prévues lors des tests
terrestres et celles simulées dans des conditions lunaires
réalistes.
Ces simulations ont
également mis en évidence que les tests sur roues individuelles
fournissent des données plus fiables que ceux sur rovers complets,
et que la réduction de masse des prototypes pourrait même être
superflue dans certains cas.
« Le véhicule
nominal a produit les mêmes courbes de glissement en fonction de la
pente sur la Lune et sur Terre« , note l’étude, suggérant
que conserver la géométrie originale du rover pourrait être plus
pertinent que modifier sa masse.
Une
révolution méthodologique nécessaire
Cette découverte impose
une refonte complète des protocoles de test. Les futures missions
devront s’appuyer massivement sur des modèles de terramécanique
intégrant la physique des environnements à gravité réduite, plutôt
que sur des analogies terrestres approximatives.
L’enjeu dépasse la simple
amélioration des performances : chaque échec de mission représente
des centaines de millions d’euros perdus et des années de recherche
anéanties. Plus fondamentalement, ces erreurs ralentissent notre
compréhension scientifique du système solaire.
Vers une
nouvelle ère d’exploration
« Il existe
certains types d’applications pertinentes pour la NASA et
l’exploration planétaire que notre simulateur peut résoudre,
contrairement aux outils des grandes entreprises
technologiques« , souligne Negrut avec enthousiasme.
Cette révélation arrive à
un moment crucial, alors que l’exploration spatiale s’intensifie
avec les programmes Artemis, les missions martiennes chinoises et
les projets d’exploration des lunes de Jupiter et Saturne. Corriger
cette erreur fondamentale pourrait considérablement améliorer les
taux de succès des futures missions et accélérer notre expansion
dans le système solaire.
La leçon est claire :
explorer d’autres mondes exige de repenser entièrement notre
relation à la physique, même la plus élémentaire.