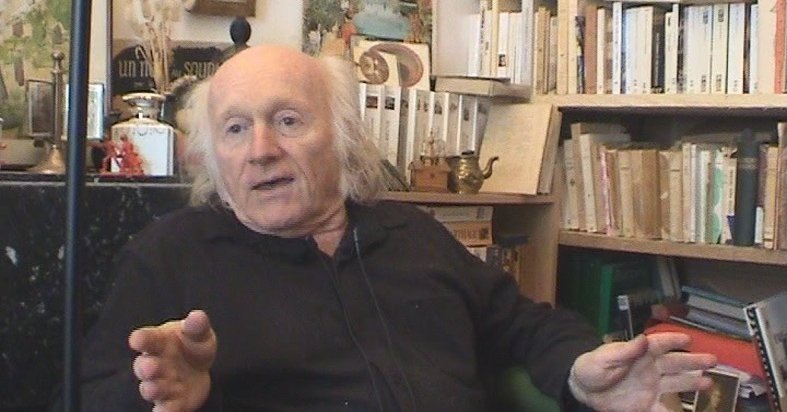« Vous éprouviez pour ce pays un tel amour
que nous l’avons ressenti à notre tour. »
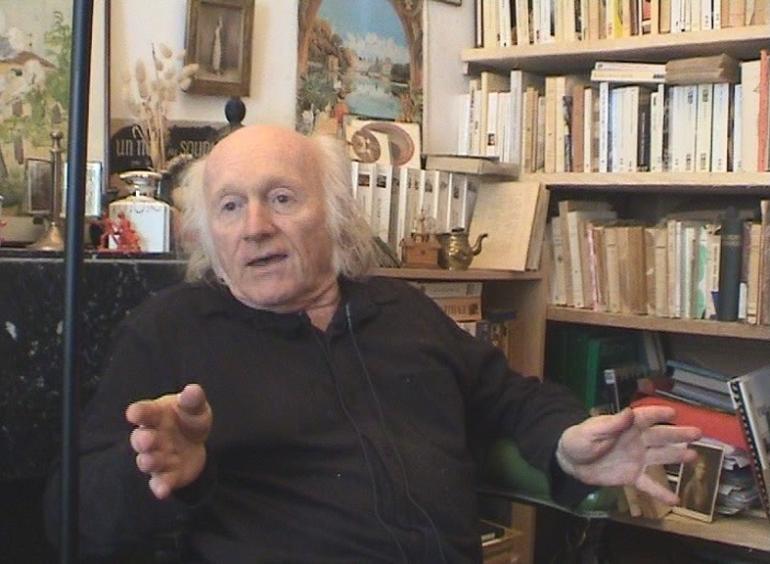
Claude Frioux
DR
Ces deux vers d’un élève de Claude Frioux à l’université de Rennes, Jean-Jacques Rimasson, résument si bien l’ascendant et le charme extraordinaires de cet homme, grand traducteur de Maïakovski et de nombreux auteurs ou poètes, au savoir encyclopédique et qui déploya une activité inlassable, sa vie durant, en faveur de la culture russe. Avoir une telle puissance « jubilatoire » dans la communication du savoir est rare.
Il était un « passeur hors pair », abonde le géographe Jean Radvany, il avait « le génie de la transmission », appuie la slaviste Annie Epelboin, dans l’épais volume d’hommages et de souvenirs, d’universitaires ou de proches, d’étudiants, de voisins, français ou russes, que publie l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, sous les auspices de Mireille Azzoug, de l’Institut d’études européennes de l’Université, et de la veuve de Claude Frioux, Irène Sokologorsky. Claude Frioux fut le président de Paris 8 Vincennes pendant les années souvent tumultueuses de 1971 à 1976, puis de 1981 à 1987. Irène Sokologorsky en fut quant à elle la présidente de 1981 à 1987.
L’ouvrage comprend aussi plusieurs des traductions ou essais de Claude Frioux, des articles, extraits de textes, et même des poèmes inédits..
Charmant et charmeur sans chercher à l’être, les plus irrésistibles, inattendu et tout en simplicité réelle, atypique, tous les témoignages se rejoignent pour saluer cet homme, issu d’une famille protestante, venu à la Russie par la politique et qui adhéra, jeune, dans les années cinquante, au Parti communiste français. Il se montra cependant assez vite critique à l’égard de la direction du PCF et manifesta, le 25 août 1968, sur la place Rouge, avec Irène Sokologorsky et quelques autres, contre l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. Il s’était lié d’amitié auparavant avec Andreï Siniavski dont le procès et la condamnation avec Iouli Daniel, en 1966, fit grand bruit et est considéré comme à l’origine de l’essor de la dissidence soviétique.
Son activité littéraire s’est déployée dans de nombreuses directions. D’innombrables essais et critiques, littéraires ou politiques, rédigés entre 1957 et 2012, ont été réunis en quatre tomes chez l’Harmattan sous le titre du Chantier russe. Il s’essaya également au roman, Vie et Oeuvre de Youri Solntsev (2005) , Trois correspondances (2008), traduisit des poètes tels que Alexandre Pouchkine, Andreï Biely ou Vélimir Khlebnikov.
Une génération de slavistes français
Mais au-delà de l’exercice obligé des hommages propres à ce type d’ouvrage, la lecture du livre nous rappelle plusieurs décennies de vie intellectuelle en France, à la fois culturelle et politique, face à l’Union Soviétique, depuis les années cinquante, après la mort de Staline, jusqu’aux débuts difficiles et douloureux des débuts de la Russie post-soviétique.
Ce livre est l’occasion aussi de se remémorer l’histoire de toute une génération, particulièrement brillante, de grands slavistes français que quelques années seulement séparaient : Claude Frioux était né en 1932, Michel Aucouturier en 1933, tous les deux sont morts la même année, en 2017, Jacques Catteau était de 1935 (décédé en 2013), tout comme Georges Nivat, le dernier qui soit encore parmi nous. Et ce n’est pas l’un des moindres intérêts de ce travail collectif.
Michel Aucouturier présente une saisissante description du Moscou des années cinquante, peu après la mort de Staline, une époque où, avec Claude Frioux, en tant que « premiers normaliens russisants », ils découvraient une Russie exsangue après la guerre et la terreur. Pas suffisamment toutefois, et c’est prodigieux quand on y pense, pour que des intellectuels russes aient perpétué leurs recherches et leurs exigences, bravant mille dangers. Aucouturier se souvient du jeune Andreï Siniavski qui parcourait en canot avec sa femme les rivières de la Russie du nord, « en quête des trésors de l’art ancien. J’ai découvert, à travers eux, qu’au lieu d’ouvrir les intellectuels russes aux tendances libérales de l’Occident, la remise en question du ’réalisme socialiste’ pouvait aussi préparer une renaissance du passé de la vieille Russie. »
Jean Radvany souligne l’activité militante de Claude Frioux qui engagea, avec d’autres, au sein du PCF, dans les années 1970, un « travail de réflexion critique » sur l’URSS et participa à l’ouvrage L’URSS et nous (1978) qui fit grincer les dents place du colonel Fabien, avant le fameux « bilan globalement positif » des pays socialistes lancé par Georges Marchais en 1979.
Le journaliste Claude-Marie Vadrot se souvient que Claude Frioux n’était « pas seulement amoureux de la Russie mais aussi de l’URSS » dont il connaissait admirablement les mécanismes. « Il m’avait appris que tout en bas de la Pravda on pouvait trouver trois ou quatre lignes qui dissimulaient une information extraordinaire ».
Engagé politiquement à gauche, résolument, resté fidèle au PCF, Claude Frioux décelait dès 1989 que la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev (1985-91) n’était pas qu’un ajustement, un recentrage, une transition, une amélioration mais bien plutôt « une mise en cause radicale (…) du modèle politique soviétique tel qu’il a été de 1918 à 1984 ».
Il ne cachait pas sa déception devant le « silence » des intellectuels devant l’évolution de la Russie post-soviétique, eux qui avaient pourtant « toujours fait entendre leurs voix » depuis 1917, malgré le stalinisme. « Par fatigue, désenchantement et inadaptation, les intellectuels professionnels ne font plus fonction de conscience du pays. Tant pis pour un certain romantisme exotique », ajoutait-il, dépité, en 1998. Seuls des « journalistes courageux » trouvaient grâce à ses yeux.
La culture russe :« vivre entre deux catastrophes »
Claude Frioux est mort quelques années seulement avant la guerre en Ukraine. On imagine le choc que cela aurait constitué pour lui, qui était pétri de culture russe et de son histoire si tourmentée. « Quand on est dans la culture russe, on est toujours entre deux catastrophes », confiait il y a quelques semaines, non sans humour, Georges Nivat, dernier survivant de cette génération de grands slavistes français, à l’occasion de son 90-ème anniversaire.
Le conflit en Ukraine a entraîné une quatrième vague d’émigration russe depuis 1917. « Il faut absolument secourir la littérature russe qui est maintenant de nouveau en exil. » Les Russes de l’exil vont continuer d’écrire, bien sûr, mais pour donner naissance, entrevoit-il, à une littérature « qui ne sera pas forcément en exil », mais qui sera peut-être aussi « américaine, serbe, israélienne, je ne sais pas ». Il rappelle le parcours de Vladimir Nabokov qui opta pour l’anglais après le russe. Nivat souhaite aujourd’hui écrire ses mémoires, lui qui connut personnellement Boris Pasternak et s’est dépensé sans compter pour la littérature russe. Mais à son âge, ajoute-t-il, on est confronté à des « choix exigeants et difficiles ». On regrette d’ailleurs que Claude Frioux n’ait pas écrit aussi ses mémoires, lui qui avait connu et si bien, tant de personnalités littéraires russes.
Dans un texte très émouvant, Annie Epelboin se souvient de ces mots de Claude Frioux, alors qu’elle revenait désabusée d’un séjour en Russie, rebutée par ses aspects « plus sombres » et qu’elle confiait vouloir « se recycler ». « Ne croyez pas, vous n’allez pas changer, vous resterez dans le russe parce que l’amour de la Russie, c’est comme une vieille maîtresse, elle ne vous lâche plus. »