Kolkhoze s’ouvre sur l’hommage national à Hélène Carrère d’Encausse dans la cour d’honneur des Invalides en octobre 2023. Fille d’apatrides, jamais la jeune Hélène n’aurait pu imaginer une telle destinée en devenant la première femme à la tête de l’Académie française. Dans un récit tentaculaire et d’une richesse incroyable, Emmanuel Carrère emporte le lecteur dans son histoire familiale.
 Emmanuel Carrère © Olivier Seignette
Emmanuel Carrère © Olivier Seignette
En plus d’un hymne d’amour adressé à sa mère et à son père, Emmanuel Carrère dresse une fresque familiale qui dépasse la fiction, mêlant la petite histoire à la grande.
De ce récit ressort une sérénité qui est nouvelle dans l’écriture d’Emmanuel Carrère. Il décrit ses souvenirs d’enfance avec une grande tendresse (mais sans sentimentalisme), très certainement parce qu’il a été un enfant très aimé et choyé. Hélènou était son surnom, ce qui démontre le lien fort qui l’unissait à sa mère. Ce lien a pu être distendu, notamment après la publication d’Un roman russe : la mère et le fils sont restés fâchés pendant deux ans. Puis les relations se sont apaisées. Hélène Carrère d’Encausse a reconnu que son fils avait bien fait d’écrire ce livre. Cela aura été l’unique concession de cette femme fière.
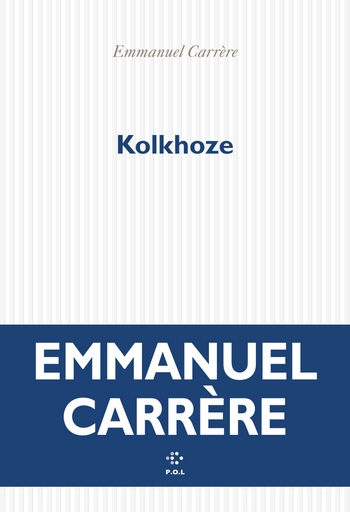 Emmanuel Carrère dresse le portrait de sa mère sans la porter aux nues. Il sait comme elle pouvait être de mauvaise foi et dure. D’ailleurs, il revient également sur la relation qu’entretenaient ses parents sans jeter de voile pudique, ce qui peut amener le lecteur à s’interroger sur le consentement des principaux intéressés. Mais quand on referme Kolkhoze, on réalise à quel point tout est juste et à sa place. Tout ce qui est écrit l’est pour de bonnes raisons. Chaque phrase est une pièce d’un puzzle aux mille facettes, celle d’une famille hors norme.
Emmanuel Carrère dresse le portrait de sa mère sans la porter aux nues. Il sait comme elle pouvait être de mauvaise foi et dure. D’ailleurs, il revient également sur la relation qu’entretenaient ses parents sans jeter de voile pudique, ce qui peut amener le lecteur à s’interroger sur le consentement des principaux intéressés. Mais quand on referme Kolkhoze, on réalise à quel point tout est juste et à sa place. Tout ce qui est écrit l’est pour de bonnes raisons. Chaque phrase est une pièce d’un puzzle aux mille facettes, celle d’une famille hors norme.
Qui peut se targuer d’être née de parents apatrides géorgien et germano-russe, de vivre une enfance pauvre en France, d’intégrer Sciences po (les Sciences po comme disait Hélène Carrère d’Encausse) et à force de travail, être appelée à travailler dans les cabinets ministériels et tenir les fonctions de secrétaire perpétuelle de l’Académie française pendant un quart de siècle ?
Revenons d’ailleurs sur cette famille géorgienne apatride : les Zourabichvili. Ce nom vous évoque quelque chose ? C’est normal. En plus d’être le nom de jeune fille d’Hélène Carrère d’Encausse, c’est aussi celui de sa nièce Salomé, qui a été présidente de Géorgie et qui maintenant s’oppose au gouvernement actuel pro-russe. Quand on parle de famille à la destinée extraordinaire, on se pose là !
Emmanuel Carrère revient sur l’histoire des quatre générations des côtés paternel et maternel, grâce aux travaux de recherches généalogiques qu’aura menés son père. C’est à son décès, seulement quelques mois après son épouse, que l’auteur découvrira l’étendue et la précision des documents précieusement classés dans des dossiers.
Parlons du choix du titre maintenant : Kolkhoze. Le père d’Emmanuel Carrère partait très souvent en déplacement professionnel. Les enfants avaient alors le droit de dormir dans la chambre parentale. « Marina, étant la plus petite, prenait la place dans le lit des parents. Nathalie et moi tirions nos matelas ou tout simplement des coussins autour du lit. Notre mère avait donné à ce rituel du dortoir : faire kolkhoze. Nous adorions faire kolkhoze. Je ne sais pas jusqu’à quand nous l’avons fait – je dirais : bien après que nous avons cessé de croire au père Noël. ».
Les trois enfants ont accompagné leur mère dans ses derniers jours. Les chapitres dédiés à ces moments sont extrêmement émouvants. « Cette nuit-là, réunis tous les trois autour de notre mère dans sa chambre de la maison Jeanne-Garnier, nous avons pour la dernière fois fait kolkhoze. ».
Déjà dans Un roman russe publié en 2007, Emmanuel Carrère avait évoqué la future disparition de sa mère. Lors d’obsèques d’une amie de la famille auxquelles ils assistaient tous deux, Hélène Carrère d’Encausse avait glissé à son fils : « ce qui est bien, tu vois, c’est que Philippe a été avec elle toute la dernière nuit. » Cette phrase lancée l’air de rien avait bouleversé son fils qui écrivait alors : « Philippe est le fils aîné de Martine. J’ai eu envie de pleurer pendant tout le service, pas tant parce qu’elle était couchée dans le cercueil à quelques mètres de moi qu’en pensant à la mort de ma mère et à ce qu’implicitement elle venait de me demander. Non pas que je n’y aie jamais pensé : je soupçonne depuis longtemps qu’en dépit de notre éloignement elle compte sur moi pour le moment de sa mort, et j’espère seulement être prêt quand ce moment viendra. J’écris ceci pour m’y préparer, pour apprendre à regarder ma mère dans les yeux, pour avoir moins peur de l’amour entre nous. ».
Ainsi, Emmanuel Carrère et ses sœurs auront répondu à la demande implicite de leur mère faite en 2007 : être accompagnée de ses enfants pour ses derniers instants. Ils auront fait kolkhoze, comme lors des moments tant chéris quand ils étaient enfants.
Ce récit n’évoque pas seulement l’histoire d’une famille, mais l’Histoire. Il ne concerne pas qu’une génération mais toute une filiation. Il rend compte de l’attachement des racines et du besoin de retourner aux origines.
Kolkhoze est une pièce magistrale dans l’œuvre d’Emmanuel Carrère, dans laquelle il dévoile l’amour infini qu’il porte à sa mère.
![]()
Caroline Martin
Kolkhoze
Récit d’Emmanuel Carrère
Editeur : P.O.L
560 pages, 24 euros
Date de parution : 28 août 2025