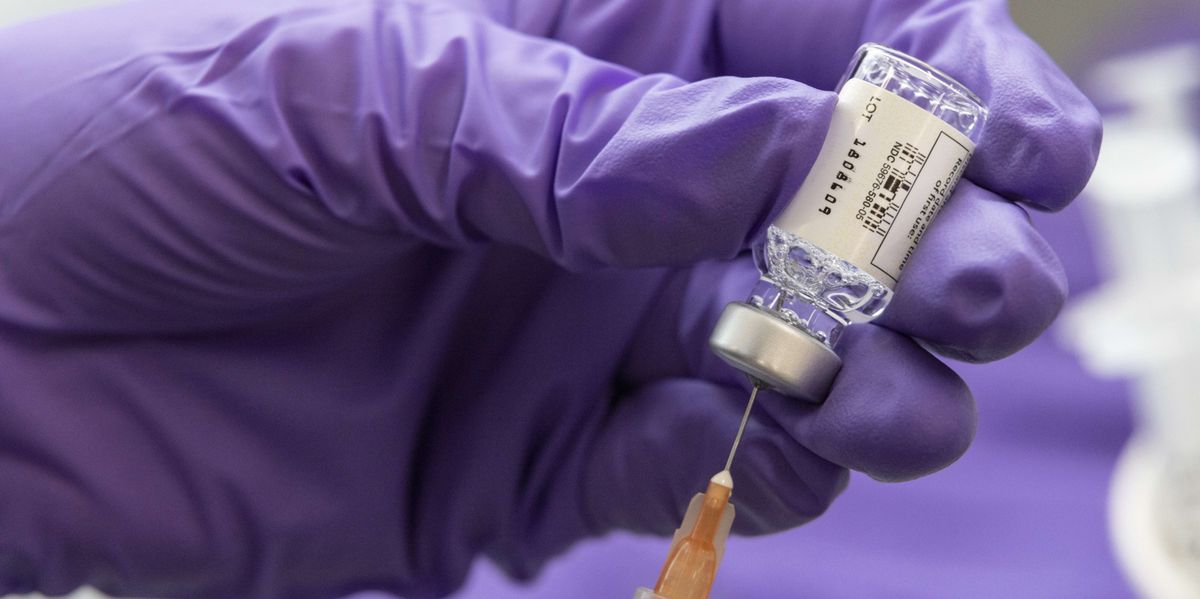Espoir face au cancer –
Un vaccin prometteur contre les cancers du côlon et du pancréas
Une équipe américaine est parvenue à augmenter la survie d’un sous-groupe de patients porteurs de mutations génétiques grâce à un vaccin qui les cible spécifiquement.
Elisa DoréLe Figaro
Publié: 24.08.2025, 17h20
Les vaccins contre le cancer sont «classiques»: on introduit dans l’organisme une petite partie inoffensive de l’agent à combattre pour que le système immunitaire apprenne à le reconnaître. (Image d’illustration)
AFP
Abonnez-vous dès maintenant et profitez de la fonction de lecture audio.BotTalkEn bref:
- Les nouveaux vaccins thérapeutiques anticancéreux montrent des résultats prometteurs en phase clinique.
- Le vaccin ELI-002 2P cible efficacement les mutations KRAS dans les cancers spécifiques.
- L’utilisation innovante de l’albumine permet un meilleur transport vers les ganglions lymphatiques.
- Les patients traités présentent une survie moyenne de vingt-neuf mois après vaccination.
Les vaccins thérapeutiques contre le cancer ne cessent de convaincre et pourraient bientôt s’imposer dans l’arsenal des traitements anticancéreux. Si cette approche est encore expérimentale, les résultats prometteurs de divers essais cliniques, dont ceux de phase II présentés à l’ASCO pour le cancer de la peau, ont conduit de nombreuses équipes à tenter de décliner l’approche à d’autres types de cancers.
En dernière date, un vaccin américain qui cible les mutations du gène KRAS dans le cancer du pancréas et du colon a permis d’augmenter la survie dans un premier essai mené chez une poignée de patients. «Les résultats sont précoces, mais l’approche a du potentiel», estime Olivier Lantz, directeur du laboratoire d’immunologie clinique de l’hôpital de l’Institut Curie à Paris.
De manière générale, la vaccination contre le cancer fonctionne sur le même principe qu’un vaccin «classique»: on introduit dans l’organisme une petite partie inoffensive de l’agent à combattre – par exemple un fragment de virus ou de bactérie – pour que le système immunitaire apprenne à le reconnaître et à fabriquer des anticorps capables de le neutraliser.
Dans le cas du cancer, la cible n’est pas un agent pathogène mais les cellules tumorales elles-mêmes. L’idée est de délivrer directement des fragments de protéines tumorales à l’organisme pour «éduquer» le système immunitaire à mieux repérer et détruire les cellules cancéreuses qui les portent. C’est pour cela qu’ils sont dits «thérapeutiques»: il ne s’agit pas de prévenir l’apparition d’une maladie dont le patient est pour le moment indemne, mais de lutter contre une maladie déjà présente.
«C’est une technologie très intéressante»
Il existe aujourd’hui deux grands types de vaccins thérapeutiques: les vaccins peptidiques, qui apportent directement ces fragments de protéines («les peptides») tumorales, et les vaccins à base d’acides nucléiques (virus, ADN et ARN messager), qui transmettent aux cellules l’instruction génétique leur permettant de fabriquer elles-mêmes les fragments tumoraux à présenter au système immunitaire.
Baptisé ELI-002 2P, le vaccin présenté dans cet essai, dont les résultats sont parus dans «Nature Medicine», fait partie de la première catégorie. Sa particularité: il contient de petits fragments de protéines correspondant aux mutations KRAS des cellules cancéreuses visées, ainsi qu’un adjuvant, les deux étant chimiquement modifiés pour pouvoir se fixer à l’albumine, la protéine circulante la plus abondante du plasma sanguin.
En utilisant l’albumine comme moyen de transport «naturel», les fragments ont pu être directement acheminés vers les ganglions lymphatiques, les centres de formation des cellules immunitaires. «C’est une technologie très intéressante, car l’une des limites des vaccins thérapeutiques traditionnels est leur incapacité à atteindre efficacement les ganglions lymphatiques», estime Olivier Lantz.
Le vaccin a été testé chez 25 patients (20 atteints d’un cancer du pancréas, cinq d’un cancer colorectal) et 68% d’entre eux ont développé de fortes réponses des cellules immunitaires, les lymphocytes T, aux protéines KRAS mutantes.
«Les patients avec les réponses des lymphocytes T les plus robustes ont présenté une survie sans récidive beaucoup plus longue», souligne Dr Zev Wainberg, auteur principal et oncologue au Centre intégré de cancérologie Jonsson de l’Université de Californie, à Los Angeles. La survie globale moyenne était en effet de vingt-neuf mois après la vaccination et la survie moyenne sans récidive de quinze mois, «soit bien plus que ce à quoi nous nous attendons habituellement», insiste l’oncologue.
Extension de la réponse immunitaire
Autre résultat notable: chez 67% des participants, les chercheurs ont observé une extension de la réponse immunitaire («antigen spreading») à d’autres mutations propres à la tumeur des patients, mais non initialement ciblées par le vaccin. «C’est un signal encourageant, car il montre que l’on peut déclencher une réponse protectrice plus large sans recourir à un vaccin entièrement personnalisé pour chaque mutation», indique le Dr Wainberg.
Par ailleurs, les auteurs sont parvenus à stimuler l’activité des deux sous-types de lymphocytes T, appelés CD4+ et CD8+, capables d’agir directement ou indirectement sur les cellules tumorales, «ce qui est habituellement difficile, précise le Pr Lantz. Généralement, les lymphocytes CD8+ sont difficilement activés par les vaccins peptidiques.»
D’autres essais à plus grande échelle sont cependant nécessaires pour évaluer la réelle efficacité de cette approche. Plusieurs choses pourraient la limiter, met en garde le Pr Lantz. D’abord, le fait que tous les patients souffrant de ces cancers ne sont pas porteurs de mutations KRAS, ce qui rendrait, de fait, le vaccin inefficace.
«D’autre part, les patients inclus dans l’essai présentaient peu de signes résiduels de la maladie après traitements standard (chimiothérapie, immunothérapie), ce qui a pu «optimiser» les résultats sur la survie, souligne le Pr Lantz. C’est pourquoi il est important de vérifier ces données sur un groupe de patients plus avancés dans la maladie.»
À ce stade, vous trouverez des contenus externes supplémentaires. Si vous acceptez que des cookies soient placés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous devez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.
Autoriser les cookiesPlus d’infos
Cet article sur le traitement du cancer a été écrit par «Le Figaro», membre français du réseau d’information LENA.
Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.
8 commentaires