La nouvelle saga d’Anne Berest débute en 1909 à la pointe de la Bretagne. Eugène Bérest, paysan, fonde la première coopérative agricole du Léon, qui permet aux producteurs de légumes de se défendre face aux marchands. Son fils, prénommé aussi Eugène, professeur de latin-grec, est élu maire de Brest. Pierre Berest, père d’Anne, fils et petit-fils des deux Eugène, est le héros de la seconde moitié de Finistère. Le polytechnicien décédé en 2022 était austère et taiseux, des traits de caractère qui tranchent avec la permissivité de l’éducation qu’il a donnée à ses trois filles par fidélité à son passé gauchiste. Soutenu par une plume vivante et joueuse, le livre de sa fille cavale.
LA TRIBUNE DIMANCHE – Quand avez-vous décidé d’écrire l’histoire de votre famille paternelle ?
ANNE BEREST – J’avais très envie de construire une œuvre qui déploierait mon arbre généalogique ; j’ai su petit à petit que je tiendrais ce projet et cette architecture littéraire. La transgénéalogie me passionne. Elle englobe ce qui se transmet de façon consciente - les récits que se racontent les familles -, ce qui se transmet inconsciemment - les silences, les secrets - et les transmissions invisibles, ce que nos ancêtres nous transmettent sans qu’on en ait conscience et qui rejoint les travaux sur la mémoire cellulaire. Nos cellules contiennent une mémoire des émotions de génération en génération, une mémoire liée aux traumatismes. J’ai encore de nombreux livres à écrire à partir de membres de ma famille et de moments de l’histoire de France.
Votre père était polytechnicien. Étiez-vous admirative de sa réussite académique ?
Polytechnicien était un mot impressionnant pour nous, difficile à prononcer. Entre eux, les amis de mon père parlaient de l’X. Il y avait une étrangeté magique autour de Polytechnique. Cependant, mon père n’était pas particulièrement fier d’être polytechnicien et il riait en citant cette phrase de de Gaulle : « Il est plus facile de sortir de l’X que de l’ordinaire. »
Vos parents furent des acteurs de Mai 68. Y avait-il néanmoins chez votre père quelque chose de la figure paternelle traditionnelle ?
Ce qui est attaché au masculin ne l’intéressait pas : il ne savait pas conduire et c’est ma mère qui bricolait ; lui ne savait pas planter un clou. En revanche le football était pour lui une religion et il manifestait vis‑à-vis de ses filles une intransigeance que l’on attribue souvent au père. Il nous répétait qu’il était contre l’héritage, manière de nous dire qu’il faudrait sortir de la maison et tout construire par nous-mêmes. Nous en avons eu conscience très tôt.
Connaissiez-vous son passé trotskiste ?
Pas du tout. Lorsque je lui annonce que je vais écrire sur la branche bretonne, cela lui fait très plaisir et il me dit qu’il aimerait qu’il soit question de deux choses : ses travaux scientifiques sur la théorie de la bifurcation - je me suis dit que ça ne serait pas simple - et son engagement dans le trotskisme entre 1968 et 1973, que j’ignorais. J’aurais pu le déduire de sa façon de voir le monde, de son vocabulaire. Son silence là-dessus était lié à l’engagement qu’on prenait en entrant dans la LCR [la Ligue communiste révolutionnaire] de rester dans la clandestinité. J’ai découvert son histoire à la faveur de Finistère. Voilà pourquoi j’écris : l’histoire me passionne. Mes romans me permettent d’approfondir des sujets à la manière d’une étudiante qui rédige un mémoire.
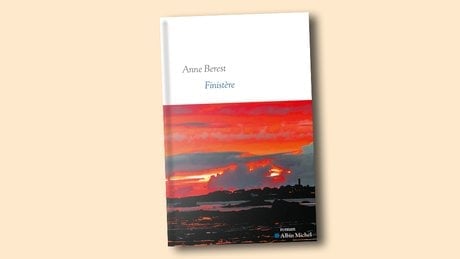 « Finistère », de Anne Berest, Albin Michel, 432 pages, 23,90 euros. (Crédits : LTD/Albin Michel)
« Finistère », de Anne Berest, Albin Michel, 432 pages, 23,90 euros. (Crédits : LTD/Albin Michel)
L’engagement trotskiste de votre père peut-il se comprendre à l’aune de celui de son propre père, maire de Brest donc notable ?
Le gauchisme était un mouvement générationnel qu’on ne peut pas expliquer par le comportement d’un seul individu. Mon père appartenait à une jeunesse qui s’est embrasée contre des valeurs qui n’étaient pas les siennes. Mais j’ai aussi une lecture transgénérationnelle de son engagement : pendant trois générations successives, les hommes de ma famille s’engagent politiquement. Mon arrière-grand-père crée la première coopérative agricole des paysans du Léon, son fils devient maire de Brest et mon père, trotskiste. Bien qu’il ait été gauchiste alors que son père était de centre droit, mon père l’imite en s’engageant.
Votre relation avec votre père se dégrade à l’adolescence…
J’ai voulu aborder ce sujet qui n’est pas très romanesque car il est silencieux et ténu. Tout se passe en apparence bien entre un père et une fille, sans drame ni rupture, et pourtant il y a dans les cœurs des pères et des filles quelque chose qui chagrine, de l’ordre de l’éloignement, un non-dit : l’éloignement entre pères et filles au moment de la puberté. Il existe peu de couples pères-filles dans l’histoire de la littérature puisque les femmes sont entrées tard dans la littérature. Or elles sont les seules à pouvoir décrire cette relation. Ce que je raconte est un champ aveugle de la fiction, et pourtant je ne suis pas la seule à avoir eu cette expérience.
Vous écrivez que votre père a eu de vous une image fausse, jusqu’à sa mort…
L’adulte que je suis devenue n’est pas la personne dont il a rêvé. Je le déçois parce que je bifurque, je prends un chemin qui ne correspond pas à ses valeurs. Il trouve que je m’embourgeoise. J’ai reçu une éducation très à gauche, et à ses yeux je me rapproche de ce qu’il considère comme un mode de vie de droite. Il fait des remarques sur mes choix de vie et je devine le mépris qu’ils lui inspirent. Cela m’a blessée parce que j’étais dépendante de son regard.
Il existe peu de couples pères-filles dans l’histoire de la littérature puisque les femmes sont entrées tard dans la littérature. Or elles sont les seules à pouvoir décrire cette relation.
Contrairement à nombre d’enfants de baby-boomers, vous ne les critiquez pas…
On fait beaucoup le procès des boomers gauchistes qui ont ensuite pris des postes de pouvoir. C’est vrai pour certains d’entre eux, mais la majorité de ces gens a cru en ses idéaux. La plupart ont tenté silencieusement de mener une vie exemplaire. Je voulais leur rendre hommage.
Propos recueillis par Virginie Bloch-Lainé
