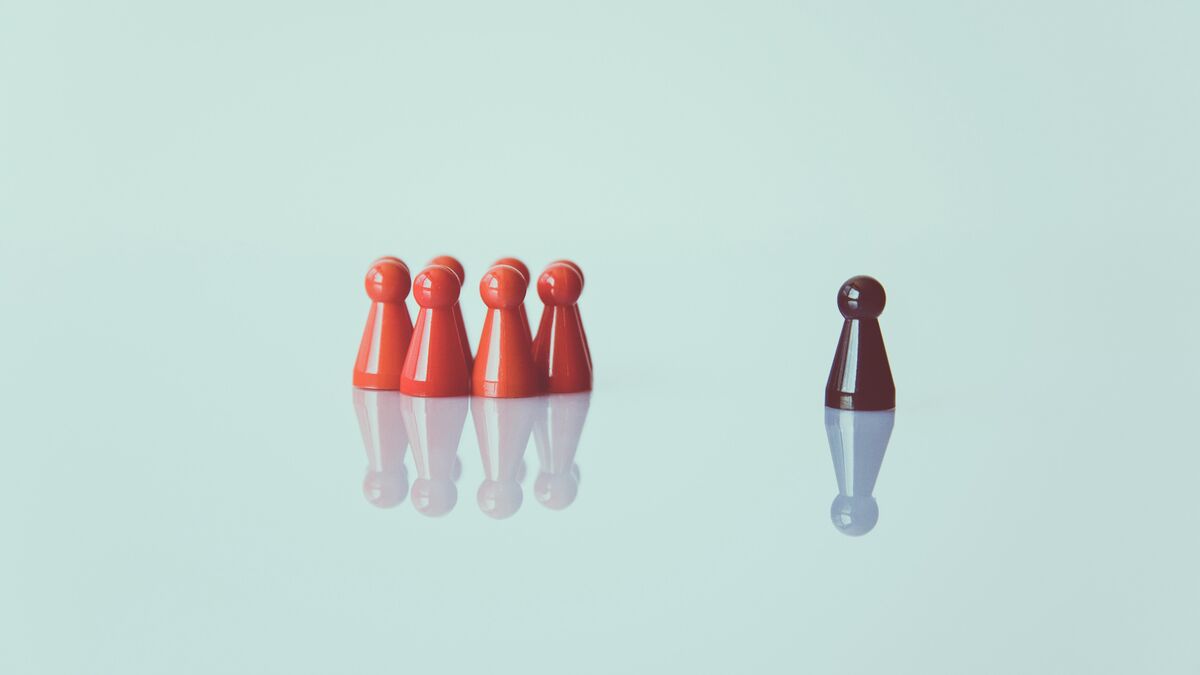« Un jour, je suis arrivée en stage, l’infirmière a dit ‘moi, je veux pas de la stagiaire noire, prenez-la !’. », a témoigné une étudiante auprès de la Coordination nationale des étudiants (Cnaé). « Sauf qu’aucune infirmière n’a voulu m’encadrer, je me suis retrouvée avec la seule aide-soignante de couleur. Ma formatrice ne m’a pas cru quand je leur ai dit, et m’a demandé de prendre sur moi. »
À la Cnaé, les appels au sujet de discriminations ne sont pas rares. D’octobre 2023 à décembre 2024, le « dispositif d’écoute, d’accompagnement et de signalement pour les étudiants qui vivent des situations de mal-être, de violence ou de discrimination » note que 5 % des échanges avec les étudiants ont pour origine ce motif. Au téléphone, principalement des étudiants infirmiers.
« Ils dénoncent très souvent des discriminations sur les lieux de stages, c’est le motif qui revient le plus, devant le mal-être », raconte Louise Delavier, la directrice des programmes En Avant Toutes, association qui pilote la CNAÉ.
D’après la dernière enquête de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières (FNESI) sur le bien-être des étudiants en soins infirmiers, 11 % d’entre eux considèrent avoir été discriminés pendant leur formation et près de 9 % en raison de leurs origines ou de leur religion.
Des brimades, des moqueries sur la couleur de peau, des clichés liés aux origines ethniques voire du harcèlement – le plus souvent moral – et de la discrimination quant au port du voile ou en raison d’une coupe de cheveux particulière… le racisme est loin d’être anodin pour les étudiants en santé et ce, qu’ils envisagent de devenir médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier.
Des discriminations racistes « banalisées » en santé
Aujourd’hui, la FNESI est la seule association représentant des étudiants en santé à s’interroger sur les discriminations racistes particulièrement. Si en kiné, la Fédération nationale des étudiants en masso-kinésithérapie (FNEK) confirme ne pas recenser de chiffres, chez les étudiants sages-femmes, l’Association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF) assure de son côté qu’il s’agit d’un « projet d’enquête » que l’association aimerait « lancer dans les prochains mois » : « Les témoignages, les questions et les interpellations concernant des situations de discrimination, à l’école ou en stage sont réguliers. »
« Vu que je suis étrangère voilée, j’ai eu du mal à trouver des stages en officine »
Une étudiante en 5e année de pharmacie
La situation n’est pas rare non plus pour les étudiants en pharmacie. L’enquête de l’Association nationale des étudiants en pharmacie (ANEPF), publiée en février dernier, « aborde les discriminations au sens large » même si plusieurs témoignages concernent exclusivement les discriminations raciales.
« Vu que je suis étrangère voilée, j’ai eu du mal à trouver des stages en officine. Je finis toujours dans les quartiers pauvres, alors que j’habite à côté de la fac. Ça me fait entre 45 et 1h de trajet pour y aller en transport en commun », relate une étudiante en cinquième année. « Messages à caractère discriminant de la part d’étudiants pendant les TP (« Les Arabes/noirs veulent que la CAF «), et ce, sans aucun contexte et de leur plein gré. Ils pensaient sans doute amuser la galerie », écrit une autre étudiante en quatrième année.
Des remontées qui n’étonnent plus Chloé Sabatier, vice-présidente de l’ANEPF en charge de la lutte contre les inégalités : « Les discriminations sont reçues sous forme de blagues donc de plus en plus, il y a une forme de normalisation de ces micro-agressions qui sont pourtant quotidiennes. »
D’après Elodie Lenfant, secrétaire générale de la FNESI, les étudiants « ne se rendent même pas compte de ce qu’ils racontent parce que pour eux, c’est tout à fait banal. Mais quand on creuse un peu, on voit bien qu’il y a un lien avec leur couleur de peau ou leur origine et c’est nous qui leur disons qu’il s’agit de racisme. »
Un racisme présent mais tabou
À l’Observatoire National des Discriminations et de l’Égalité dans le Supérieur (ONDES), Yannick L’Horty analyse régulièrement l’état de la discrimination au sein des formations, depuis 2021, et de la profession, depuis 2015. Grâce à des candidatures fictives, le directeur de l’observatoire confirme que ces discriminations se basent uniquement sur les noms et prénoms des candidats. « Nous avons envoyé des milliers de candidatures et nous avons des preuves statistiques que Samira Belkacem (prétendue d’origine maghrébine), est sans cesse pénalisée. »
Dans le domaine des sciences, technologies et santé, la discrimination des étudiantes « dont l’identité signale une origine africaine » est plus flagrante qu’ailleurs avec une baisse de 15 % de chances de succès sur la plateforme Mon Master par rapport aux candidates franco-françaises. « On renouvelle nos tests chaque année et nous avons toujours la même stabilité. L’ampleur des pénalités est constante », regrette Yannick L’Horty.
D’après l’ONDES, « ces professions du soin où l’on est censé être soucieux d’autrui, ne sont pas abritées des ressorts discriminatoires. » De quoi lever un tabou. Car les étudiants en santé s’expriment encore assez peu sur ce sujet. « C’est difficile à imaginer parce que c’est à l’opposé de nos valeurs humanistes mais on veut montrer que les étudiants ne sont pas seuls, qu’on a un devoir d’écoute et qu’une tolérance 0 doit être appliquée », plaide Chloé Sabatier. Car pour la FNESI, c’est le serpent qui se mord la queue : dénoncer, c’est risquer de voir un stage invalidé et donc une année de formation incomplète. « Il y a encore une omerta parce qu’on ne sait pas à qui on peut faire confiance pour en parler », estime Elodie Lenfant.
Peu de sensibilisation mais des étudiants « plus alertes »
Pour ne rien arranger, face à ces constats, peu d’actions publiques sont entreprises, comme le regrette le président de l’ONDES. « Il y a des actions mais elles n’ont pas été évaluées donc on ne sait pas comment guider ces actions sur le long terme. » Les associations étudiantes l’affirment : aucun cours ne concerne le racisme alors que les violences sexistes et sexuelles sont abordées dans la plupart des études de santé.
Vrai, sauf à Sorbonne Université, où Priscille Sauvegrain, sage-femme et docteure en sociologie et sa collègue, Racky Ka-Sy, docteure en psychologie sociale, ont monté un module de six heures sur les « Soins différenciés, discriminations et racisme en santé » pour les étudiants en sixième année de médecine.
« On est encore très en retard sur le racisme comparé aux violences sexistes et sexuelles »
Priscille Sauvegrain, sage-femme et docteure en sociologie
Les deux enseignantes-chercheuses écoutent régulièrement les témoignages des étudiants et la réalité est sans appel : « Le racisme est peu explicite en santé mais oui, sur les terrains de stage, on peut décrire des situations de discriminations raciales, que cela vienne des étudiants, des patients ou des enseignants », résument-elles.
Plébiscitées par leurs collègues et les étudiants eux-mêmes, elles estiment que le sujet commence tout juste à émerger. « On est encore très en retard sur le racisme comparé aux violences sexistes et sexuelles par exemple. Il faut pourtant être aussi ferme parce que le racisme est un délit !, pointe Priscille Sauvegrain. On encourage donc toutes les facultés à développer cette formation vis-à-vis des discriminations, c’est indispensable. Les étudiants sont plus alertes sur ces sujets mais il ne faut pas baisser la garde. »