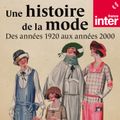Avec plus d’un million de visiteurs, « Louvre Couture » est devenue en 2025 la deuxième exposition la plus fréquentée de l’histoire du musée, juste derrière celle sur Léonard de Vinci. Pour Olivier Gabet, directeur du département des Objets d’art, ce succès illustre combien la mode peut dialoguer avec l’histoire de l’art : « Présenter des vêtements dans un lieu comme le Louvre, c’est montrer qu’il existe une histoire universelle de la création, qui dépasse les clichés. » Conçue avec le soutien de Laurence des Cars, directrice du Musée du Louvre, l’exposition visait aussi à rendre le musée moins intimidant et à attirer des publics nouveaux. En confrontant les period rooms : véritables « capsules temporelles », allant du XVIIIᵉ siècle à la Chine des Ming aux créations de Chanel, Louboutin ou Balenciaga, le commissaire a voulu « réveiller un département qui le mérite amplement » et tisser des passerelles inédites entre grande culture classique et culture populaire.
La mode, une discipline désormais légitime
Salomé Dudemaine, 32 ans, appartient à la première génération d’historiennes de la mode formées directement à l’École du Louvre dans une spécialité dédiée. « J’ai grandi avec les expositions du Musée des Arts décoratifs et du Palais Galliera, qui ont enfin permis de considérer la mode comme un véritable sujet scientifique », souligne-t-elle, rappelant le rôle pionnier d’Olivier Gabet, ancien directeur des Arts Décoratifs et initiateur de l’exposition « Christian Dior, couturier du rêve » en 2017.
« Louvre Couture », qui a fermé ses portes fin août, plongeait les visiteurs dans l’aile Richelieu, ses salons et ses period rooms, où mobilier, objets d’art et créations contemporaines se répondaient harmonieusement : robe découpée de Charles de Vilmorin, bottes cloutées de Louboutin ou tailleur Chanel inspiré d’une commode ancienne. « Ce ne sont pas seulement des vêtements que l’on observe comme des pièces de musée, mais une véritable histoire culturelle « , insiste l’historienne. La mode y apparaissait comme un miroir de l’imaginaire collectif, à la croisée du patrimoine et de la création.
Mode et patrimoine : raconter l’histoire
Salomé Dudemaine, co-fondatrice de la revue de mode Griffé, souligne que la popularité des expositions consacrées à la mode tient à leur dimension culturelle. « La mode dépasse le pur objet, le vêtement. D’ailleurs, l’objet, c’est ce qu’on montre souvent dans les musées pour raconter les histoires humaines qui se cachent derrière », explique-t-elle, insistant sur l’importance de dépasser les monographies centrées uniquement sur les créateurs pour inclure toutes les personnes qui gravitent autour d’une maison de mode.
Olivier Gabet, directeur du département des Objets d’art du Louvre, rappelle cependant que la monographie reste essentielle en histoire de l’art : « Dans la mode, elle fait partie de la grammaire de base parce que c’est aussi une façon de raconter à travers un destin particulier, une manière de se projeter dans cette histoire ». Selon lui, Paris bénéficie d’une richesse unique avec des institutions comme la Fondation Alaïa ou le Musée Yves Saint Laurent, où « beaucoup de ces grands destins s’incarnent dans des maisons qui ont compris l’importance de revendiquer ce patrimoine historique, artistique et qui y ont consacré pour beaucoup d’entre elles, beaucoup de moyens ».
Art et mode : une histoire intemporelle
Les expositions de mode existent depuis longtemps : « Dès les années 1920, le musée présentait déjà de la mode, ancienne et contemporaine », rappelle Olivier Gabet. Il souligne que ces grandes expositions doivent concilier la valorisation du patrimoine des maisons et le respect des règles scientifiques des musées, tout en résistant à la tentation de devenir de simples vitrines publicitaires : « La mode qui parle à la mode, c’est un peu limité. Ce qui est plus passionnant, c’est de la faire entrer en résonance avec son époque et avec d’autres domaines ».
La mode a toujours été présente et observée à travers l’art et les collections. « Les artistes m’ont montré leur capacité à retranscrire de manière très réaliste les matières et les vêtements, broderies, dentelles… », explique Salomé Dudemaine, évoquant la peinture du XVe siècle. Au début du XXe siècle, Maurice Leloir a constitué des collections historiques qui ont jeté les bases des musées de mode. Dans les années 1970, Diana Vreeland, patronne de Vogue aux États-Unis, « va vraiment faire de la mode cet espace qui accueille les arts, les tendances, les évolutions de la société ».
La suite est à écouter…
À écouter