La pulpe et le jus est un premier roman qui ne ressemble à rien de ce qui se publie aujourd’hui.
Jenna Astoli, 26 ans, est une jeune femme passionnée par les agrumes rares et qui travaille dans un bistrot parisien. Hypocondriaque, elle va chez le médecin comme on irait acheter du pain, quatre fois par semaine depuis deux ans. C’est avec le même appétit que sitôt rentrée chez elle, elle dévore Les Nouveaux Guérisseurs, une émission de télé-réalité qui prétend libérer les participants de leurs angoisses. C’est donc avec elle que l’on suit les tribulations de Denis Clavetot, agoraphobe et claustrophobe notoire, figure de proue de la nouvelle saison.
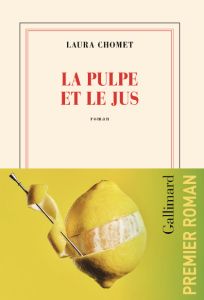
Portrait cinglant d’une époque qui surconsomme les séries et vidéos en tous genres, le roman cible aussi les dérives du monde moderne, dans le sillage d’une Annie Ernaux qui s’intéressait au RER dans Journal du dehors : « Dans moins de cinquante ans — si les humains courent toujours — on racontera aux nouvelles générations : pendant les premières décennies du millénaire, on transbahutait les travailleurs dans des wagons à bestiaux, promiscuité de mise, chacun cherchait sa dose d’oxygène et maudissait son voisin, les gens tombaient dans les pommes, attendaient des heures sur des quais bondés, se faisaient piétiner à l’envi, ou se jetaient sur les rails. Les survivants patientaient le temps qu’on nettoie. L’humanité n’existait pas ».
Le portrait qu’elle dresse de Paris, lui, n’est pas sans rappeler Echenoz : « Alentour, sur le boulevard Beaumarchais, l’humanité ordinaire va bon train : un SDF enroulé de bâches plastiques parle à un pigeon qui, à défaut de répondre à l’enplastiqué, barbote tout aise dans l’eau croupie, picorant selon l’offre du courant un morceau de carton à pizza détrempé ou un trognon de pomme, tandis que sur la chaussée un automobiliste informe un cycliste qu’il est un mange-merde bon à crever aplati sous ses roues, que ça fera du bien à sa sale gueule de pédale et à sa mère la chienne, sur quoi l’intitulé mange-merde envoie un coup de casque auquel l’automobiliste riposte par un coup de poing. S’ensuit l’intervention d’un second mange-merde décarboné — dont l’ascendance n’est pas précisée — manifestement pas moins inspiré que le premier, voire tout autant que l’automobiliste […]. Jenna pense : à la vie comme à la ville, en fin de compte, il suffit de s’acclimater ».
Du surtourisme, Laura Chomet écrit encore : « Les touristes sont partout en bandes organisées, les rues d’Héraklion en dégueulent des milliers quotidiennement. Des vieux couperosés, bobs, lunettes, des gras en shorts, doigts toujours tendus vers des merveilles qu’ils sont venus détruire ». Raillant aussi la toponymie des villes, de la rue des Bluets, elle écrit : « Encore une dénomination de fleur pour qualifier une rue de merde ». Du bio : « Tu es bio, toi qui es né sous péridurale, a grandi sous antibiotiques, et prospère à coups de vaccins dans un monde en plastique ? ». Et quand l’ancien petit ami de Jenna prépare un film sur une transfuge de classe, fille de femme de ménage devenue avocate, son héroïne répond : « Très original ».
Laura Chomet montre combien certains hypocondriaques — ou prétendus tels — se croient plus légitimes que les médecins, mais aussi combien ils se situent en marge : « Jenna est morte mille fois. Ça n’émeut plus personne ». Pas même sa généraliste, le docteur Seksik. De là découle une très profonde solitude : « Je suis plus seule qu’un chien, plus vieille qu’un vieux, l’humanité, je crois, n’est pas mon rayon » ; ou bien : « Jenna jalouse le nourrisson. A-t-on jamais cherché à interpréter sa langue à elle ? ». C’est que derrière l’hypocondrie de son héroïne se cache une incapacité à vivre, aimer ou ne serait-ce qu’avoir une vie sociale : « De contraintes en dégueulasseries, à la longue, le plus pénible reste de supporter les gens ».
Parsemé de zeugmas et de trouvailles stylistiques, le livre est surtout servi par un humour noir employé à bon escient. Quand on fait remarquer à Jenna qu’elle n’est pas une bonne vivante, elle rétorque : « Non, mais je fais une assez bonne morte ». Lorsqu’on lui apprend qu’on va lui retirer l’estomac : « Même fausse, une phrase pareille peut entamer l’humeur ». Même lorsque son héroïne est véritablement malade, la romancière demeure sarcastique : « Face à la cuvette, à genoux, elle vomit le pain au levain, pense à ce qu’il lui a coûté », avant d’ajouter : « Il est rare de voir les matériaux d’aussi près ». Heureusement, en plus de l’émission de télé-réalité, Jenna se passionne pour les agrumes rares, qu’elle subtilise là où elle travaille. Les palper la rassérène aussitôt.
Le portrait caustique qui est fait de l’hôpital et des médecins n’est pas sans rappeler les pages qu’Hervé Guibert consacre aux docteurs Lévy et Aron dans À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, qui soit ne voient rien, soit lui prescrivent un traitement à base d’eau gazeuse et de citron. Chez Laura Chomet, la satire n’est jamais loin lorsqu’elle décrit la généraliste, obsédée par la plongée et dépourvue de psychologie, ou le gastroentérologue, presque impotent, qui assimile l’ablation d’un organe à de la couture — ou ne serait-ce que les lieux réservés aux malades : « Les cabinets médicaux ne sont jamais assez aseptisés ». Car le roman est aussi un portrait à charge de la dérive du service public : « Face à elle, trois médecins rincés par l’AP-HP : la lunatique, l’inerte et le tremblant ».
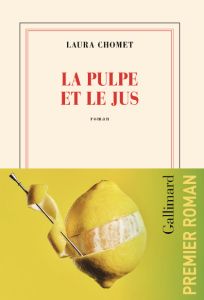
Ce qui est dit du cancer, dont la progression est exponentielle dans nos sociétés, est d’une justesse rare. Cette maladie n’a aucune logique et s’en prend bien souvent aux personnes dont le mode de vie paraît le moins propice à son développement, dont Jenna : « Et c’est elle, avec sa jeunesse et sa discipline, avec ses cinq fruits et légumes par jour, avec ses agrumes, ses navets, ses courges, ses radis bio de toutes les couleurs qu’elle raque trois fois le prix à force d’extras […], elle, qui doit écoper de l’adénocarcinome ? ». La romancière ajoute au détour d’un paragraphe que la France est un pays « suicidaire qui persévère dans une tradition de graisse saturée, d’éthanol et de maladies cardiovasculaires », évoque avec clairvoyance la façon dont la maladie puis la mort de l’héroïne sera de toute manière évacuée : « On sera sous le choc dix minutes, on ne déjeunera pas, à tout le moins on boudera son dessert pour marquer le coup, puis on reviendra à la vie, à ses intérêts, à son bon plaisir, et cet été — déjà morte et enterrée — elle ne sera plus qu’une anecdote tragique racontée entre deux gorgées de spritz sur les terrasses bondées ».
Pendant acidulé de Téléréalité, le roman d’Aurélien Bellanger paru en 2021, qui s’intéressait aux coulisses du monde télévisuel des années 1990 en faisant le portrait d’un jeune homme ambitieux moitié balzacien, moitié inspiré par la propre trajectoire de Stéphane Courbit, roman du corps qui encombre et ne jouit pas, La pulpe et le jus montre surtout combien la croyance gouverne nos vies et a le pouvoir de nous transformer.
Dans ce premier roman doux-amer, mêlant humour et tendresse, Laura Chomet parvient à rendre attachants et sympathiques deux personnages singulièrement névrosés : Jenna et Denis. C’est dans cet entre-deux, ce glissement d’une croyance à une autre — de l’hypocondrie de Jenna à sa certitude d’avoir été sélectionnée pour participer à l’émission, mais aussi le passage de la claustrophobie au retour du désir chez Denis —, que le roman atteint son acmé. La maladie fait figure de catharsis ; Jenna semble enfin échapper à l’inconvénient d’exister pour se jeter dans la vie. À la manière d’un Bertolt Brecht, la romancière insère sporadiquement des phrases qui mettent son héroïne et le lecteur à distance : « Jenna accèdera-t-elle à la vraie vie, elle qui n’a prisé jusqu’alors qu’un terrier avec tisane ? ».
Laura Chomet, La pulpe et le jus, éditions Gallimard, avril 2025, 224 pages, 20€.
Articles similaires
