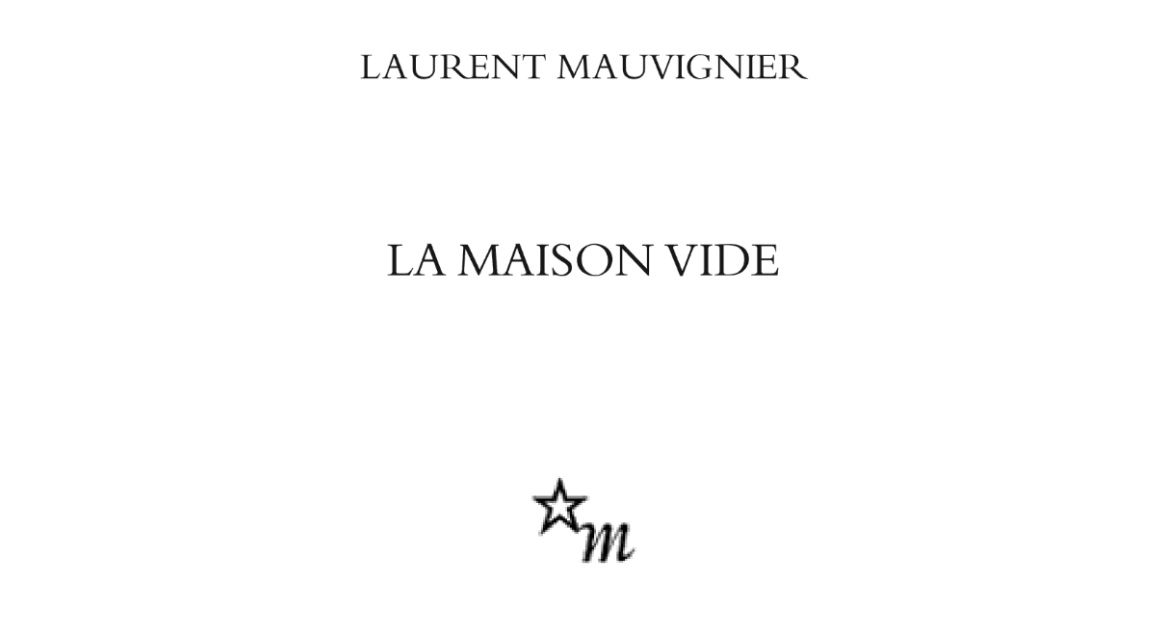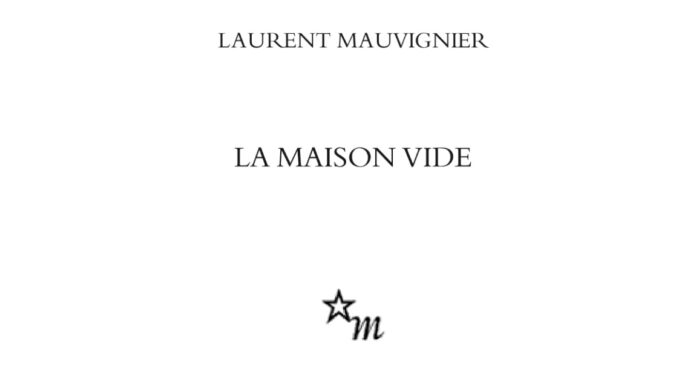Avec La Maison vide Laurent Mauvignier accomplit un geste littéraire d’une rare ampleur : plus de 700 pages pour explorer une généalogie, fouiller les fractures intimes d’une lignée et interroger ce que la mémoire familiale — ses silences, ses traumatismes, ses légendes — dépose dans nos vies. Ce roman, monumental et fragile, s’impose comme une méditation sur la transmission des blessures et des espoirs, sur la façon dont l’Histoire pénètre la chair des familles.
Le titre dit tout : une maison, désertée, mais hantée de présences. Laurent Mauvignier la repeuple, pièce après pièce, génération après génération. Dans cet espace, les voix disparues se superposent, les destins s’entrechoquent, les guerres traversent les murs. Le romancier en fait un lieu de condensation : La Maison vide n’est pas seulement une bâtisse abandonnée, mais la métaphore de l’écriture elle-même, ce réceptacle qu’il faut habiter, combler, réinventer.
Tout part d’une photographie abîmée, d’un visage lacéré : Marguerite, la grand-mère tondue à la Libération. À partir de cette béance, Laurent Mauvignier reconstruit le fil d’un roman familial. La lignée déploie ses figures : Marie-Ernestine, pianiste empêchée, recluse après son mariage imposé ; Jules, le mari sacrifié aux tranchées ; Marguerite, rebelle, amante, humiliée ; puis, en aval, le père de l’auteur, qui finit par se suicider en 1983.
L’enjeu du récit est là : comprendre d’où vient la blessure, comment elle se transmet. Comme l’écrit Laurent Mauvignier :
« On ne sait jamais où commence la blessure : peut-être dans un geste qu’on n’a pas vu, une phrase qu’on n’a pas entendue, et qui pourtant traverse les générations comme une lame invisible. »
Là réside la force stylistique de Laurent Mauvignier : l’écriture avance par ressassements, par reprises infimes, comme si chaque mot tentait de cerner l’invisible. Ses phrases, longues, sinueuses, traquent les interstices du temps, la crispation d’un visage, l’éclat d’un piano Bösendorfer couvert de poussière.
« Et c’est ainsi qu’à force de regarder la poussière sur le clavier, de voir ses doigts immobiles au-dessus des touches, de l’imaginer encore et encore jouer cette musique qu’on lui avait refusée, je comprenais que le silence de ma grand-mère n’était pas l’absence d’une voix mais le poids écrasant de toutes celles qu’elle n’avait jamais pu laisser s’échapper. »
Certains lecteurs pourraient y voir une exigence presque vertigineuse, tant la densité formelle et la lenteur assumée réclament une attention soutenue. Mais c’est précisément cette patience qui donne au texte sa puissance hypnotique et sa singularité : ce refus de la précipitation qui permet de saisir ce qui, d’ordinaire, échappe.
Au cœur de ce livre, il y a la voix des femmes. Elles portent l’essentiel de la tragédie : Marie-Ernestine, mutilée dans son rêve de concertiste ; Marguerite, qui incarne la révolte et la honte ; Henriette, témoin muet. À travers elles, Laurent Mauvignier interroge la violence des mariages imposés, l’effacement des désirs, la cruauté des héritages.
Ce n’est pas un hasard si la musique, motif central, surgit comme métaphore de l’émancipation entravée. Le piano, interdit puis forcé, devient le symbole des existences étouffées. Dans ces portraits de femmes abîmées, Laurent Mauvignier rejoint une lignée littéraire qui va de Maupassant à Ernaux, en passant par Brel — dont le spectre de Ces gens-là semble hanter les pages.
Le roman ne se contente pas de raconter des vies antérieures : il interroge le suicide du père de l’auteur, événement matriciel. Tout commence par une image mutilée, comme une énigme à résoudre :
« C’est devant cette photo, dont le visage a été lacéré, que tout a commencé.
La photographie ne montre rien d’autre qu’une robe claire, un arrière-plan indistinct, une jeune femme qui aurait pu sourire. Mais il manque le visage. On a gratté, on a rayé, on a fait disparaître. Alors je me suis demandé : qui a tenu la lame ? Était-ce la main de la honte, la main de la colère, ou celle de l’oubli ?
C’est à partir de ce vide que j’ai voulu réécrire la vie de Marguerite, et derrière elle, celles de tous les autres. Car la maison, elle aussi, est un visage effacé. Et le roman n’est rien d’autre que la tentative de lui rendre ses traits. »
La démarche a parfois été jugée périlleuse — on sait combien l’autofiction peut susciter le soupçon d’un trop grand rabattement sur soi. Mais Laurent Mauvignier échappe à ce travers en inscrivant son expérience dans une fresque collective : ses ancêtres, leurs guerres, leurs humiliations, deviennent des figures universelles.
En dernière instance, La Maison vide est une tentative de sauver de l’oubli. Laurent Mauvignier ne cherche pas seulement à restituer le passé : il invente, il fabrique, il comble les blancs. C’est là son courage et sa modernité : accepter que le roman familial est aussi une fiction, qu’il s’agit d’une reconstruction toujours hypothétique.
Ce geste d’écriture est aussi une réponse au suicide du père : réinscrire ce geste dans une histoire, lui donner une place, plutôt que de le laisser comme une faille muette. Le roman se fait tombeau et rédemption, offrande et expiation.
Par son ampleur, par sa densité, par la justesse de son style, La Maison vide se situe dans la continuité des grands romans européens de la mémoire familiale, aux côtés de Sebald ou de Pierre Bergounioux. On pourrait objecter que son ampleur exige du lecteur une disponibilité rare, presque une ascèse : impossible d’y entrer à la légère. Mais pour qui accepte cette traversée, l’expérience est celle d’un roman-monde inoubliable.
- Titre : La Maison vide
- Auteur : Laurent Mauvignier
- Éditeur : Les Éditions de Minuit
- Date de parution : 28 août 2025
- Collection : Romans
- Nombre de pages : 752 p.
- Format : 14 x 20,5 cm
- ISBN : 978-2-7073-XXXX-X
- Prix indicatif : 24 €