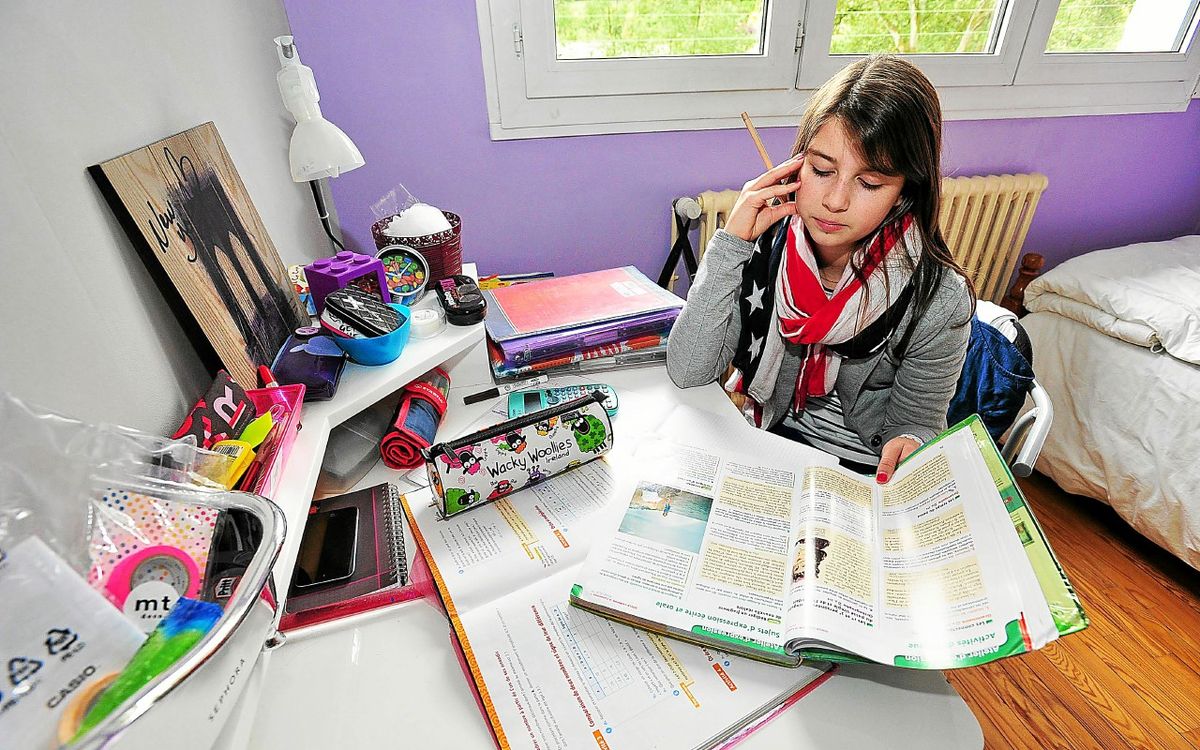Jusqu’en 2021, une simple déclaration suffisait pour instruire son enfant à la maison. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et les écoles non déclarées, la loi a durci les conditions. Depuis cette date, les parents doivent obtenir une autorisation du rectorat, accordée uniquement pour des raisons précises (état de santé, pratique sportive ou artistique de haut niveau, itinérance de la famille, ou situation propre à l’enfant).
Un recul massif de l’IEF en France
Conséquence directe : l’instruction en famille (IEF) recule fortement. Un rapport de la Cour des comptes, publié en avril 2025, dresse un constat sans appel. Alors que 72 000 enfants étaient instruits à domicile en 2021-2022, ils n’étaient plus que 30 644 trois ans plus tard, soit 0,3 % des enfants soumis à l’obligation scolaire.
Cette tendance se retrouve également en Bretagne. Dans l’académie de Rennes, le nombre d’élèves concernés est passé de 2351 en 2023/24 à 1432 l’année suivante. Une baisse de 40 % en un an.
Des causes multiples
La chute s’explique d’abord par le contexte sanitaire. En 2020-2021, de nombreuses familles avaient choisi l’IEF pour éviter un retour en classe après les confinements. Mais avec la stabilisation du système scolaire, une partie d’entre elles a réintégré l’enseignement classique.
S’y ajoute le nouveau régime d’autorisation, beaucoup plus restrictif. La prolongation temporaire accordée aux enfants déjà instruits à domicile a pris fin en 2024/25. Désormais, toutes les familles doivent déposer un dossier justifiant leur choix.
Aucune logique
En 2021, une demande sur quatre était rejetée. En 2024, près d’une demande sur trois n’a pas abouti. L’académie de Rennes affiche un taux de refus de 30 %, dans la moyenne nationale haute. « Il n’y a pas de raison logique qui explique que telle ou telle académie refuse davantage l’instruction à la maison, souffle Caroline de l’association Enfance libre qui défend le retour à un régime déclaratif. Comme les textes sont flous, c’est l’interprétation faite par les Directeurs académiques des services de l‘éducation nationale (DASEN) qui joue… Voilà pourquoi dans les académies de Rennes ou Versailles, on a 30 % de refus alors qu’on a 8 % à Bordeaux. Il n’y a aucune logique. »
Recours en justice en hausse
Le motif de la « situation propre à l’enfant » concentre l’essentiel des désaccords. « Chaque demande est analysée au cas par cas pour apprécier l’existence d’une telle situation », précise le cabinet de la rectrice. « Il appartient aux familles de démontrer en quoi leur projet éducatif répond à cette situation particulière. »
Une règle jugée floue, qui pousse de nombreux parents à contester les décisions devant le tribunal administratif. À Rennes, 25 jugements ou ordonnances avaient été rendus en 2022. Deux ans plus tard, ce chiffre est monté à 121, avant de redescendre à moins de 30 en 2025. « Ce contentieux alourdit la charge des juges de référés pendant la période estivale », confie Alain Poujade, président du tribunal administratif de Rennes. « C’était particulièrement vrai en 2024, mais beaucoup moins en 2025. Il s’agit toujours de dossiers sensibles humainement, qui nécessitent un examen attentif de la situation de l’enfant et de sa famille. »