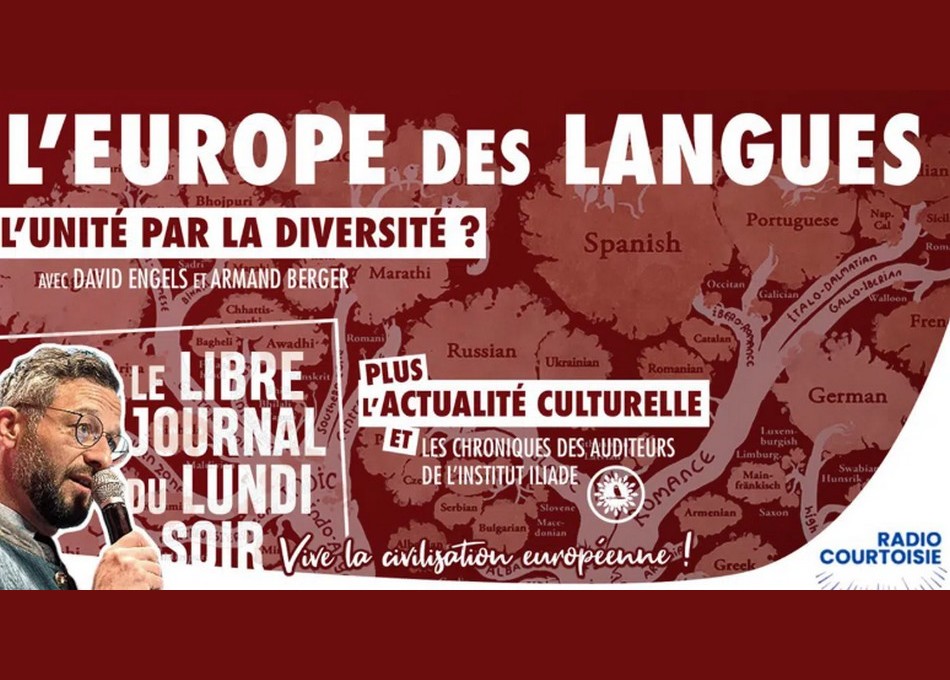Peu d’expressions culturelles participent autant que la langue à la diversité du monde.
Les Hans, les Arabes ou les Français, aux assises ethniques et territoriales différentes, renforcent leur singularité par leur langue qui créent chacune des univers fondamentalement différents, des civilisations différentes, des « planètes différentes » pour reprendre l’allégorie de René Marchand. La résistance de son univers à soi, toujours, est passée par la langue : le gaélique pour les Irlandais ou le français pour les Québécois. Comme si le peuple qui perd son langage se perdait entièrement.
Cette réalité jette une lumière toute particulière sur la civilisation européenne, qui compte pas moins de 24 langues officielles sur un territoire relativement réduit – et combien de déclinaisons minoritaires, de dialectes, de parlers ? Une telle diversité linguistique est un cas unique qui met en évidence la dimension problématique de l’appartenance civilisationnelle. Elle se caractérise par une réalité double : les Européens parlent en effet en grande majorité des langues qui, étant donné leur histoire, sont toutes apparentées (via la racine principale indo-européenne), et pourtant les Européens ne se comprennent pas.
Malgré cette tendance aux évolutions singulières et séparées des langues en Europe, notre histoire est marquée par une tentative de rapprochement via l’établissement de langues communes dépassant les frontières ou la création ex nihilo de langues dites universelles comme l’espéranto. Le latin autrefois, et l’anglais – largement appauvri – désormais, se sont imposées comme des langues impériales permettant aux Européens de discuter entre eux, certes, mais accouchant en parallèle d’un indéniable appauvrissement de la diversité linguistique et culturelle dans la vieille Europe. Un appauvrissement qui, il faut le dire, permet un meilleur contrôle des esprits et un changement des mentalités comme on le voit avec le succès de la langue techno-marchande anglaise.
Si bien qu’on peut se poser, comme Umberto Eco, la question de savoir si finalement « la langue de l’Europe, c’est la traduction », et mettre alors sur la table la problématique de l’apprentissage des langues étrangères dans chacune des grandes et petites patries européennes. L’impératif d’une réflexion constante sur l’unité dans la diversité des langages, pour se hisser au niveau des enjeux stratégiques et politiques qu’elles impliquent pour l’idée même du devenir civilisationnel.
Un vaste sujet que nous aborderons avec deux universitaires qui ont une expérience très concrète de la diversité linguistique de l’Europe :
- Armand Berger, germaniste et auditeur de la promotion Dante. Il a coordonné le numéro de Nouvelle École consacré à Tolkien (2021) et rédigé plusieurs notices pour La Bibliothèque européenne du jeune Européen (Le Rocher, 2021). En 2022, il a publié Tolkien, l’Europe et la tradition dans la collection « Longue mémoire » de l’Institut Iliade et a livré un texte de réflexion « Quelles réalités linguistiques pour l’Europe » dans le Cahier numéro 1 du Pôle Études
- David Engels, ancien titulaire de la chaire d’histoire romaine à l’Université libre de Bruxelles (ULB), est chargé de cours à l’ICES en histoire mondiale et auteur et éditeur de nombreux livres et articles sur l’histoire ancienne, la philosophie de l’histoire et le conservatisme moderne. En France, il est principalement connu par son étude Le déclin (Paris, Toucan, 2013), où il compare la crise de l’UE au déclin et à la chute de la République romaine au 1er s. av. J.-C., et par ses livres Que faire ? (réédition, Paris, Nouvelle Librairie, 2024) et Défendre l’Europe civilisationnelle (Paris, Salvator, 2024), tous publiés dans de nombreuses traductions.
Vous pourrez retrouver les chroniques des auditeurs de l’Iliade :
- « Perspectives identitaires » de Raphaël Ayma, auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l’Institut Iliade.
- Autour d’un vers, le rendez-vous poétique de Frédérique de Saint-Quio, auditrice de la promotion Homère.
- Les chroniques musicales de Pierre Leprince, auditeur de la promotion Patrick Pearse de l’Iliade.
- La boussole artistique de Gabrielle Fouquet.
SOURCE : Institut ILIADE pour la longue mémoire européenne.