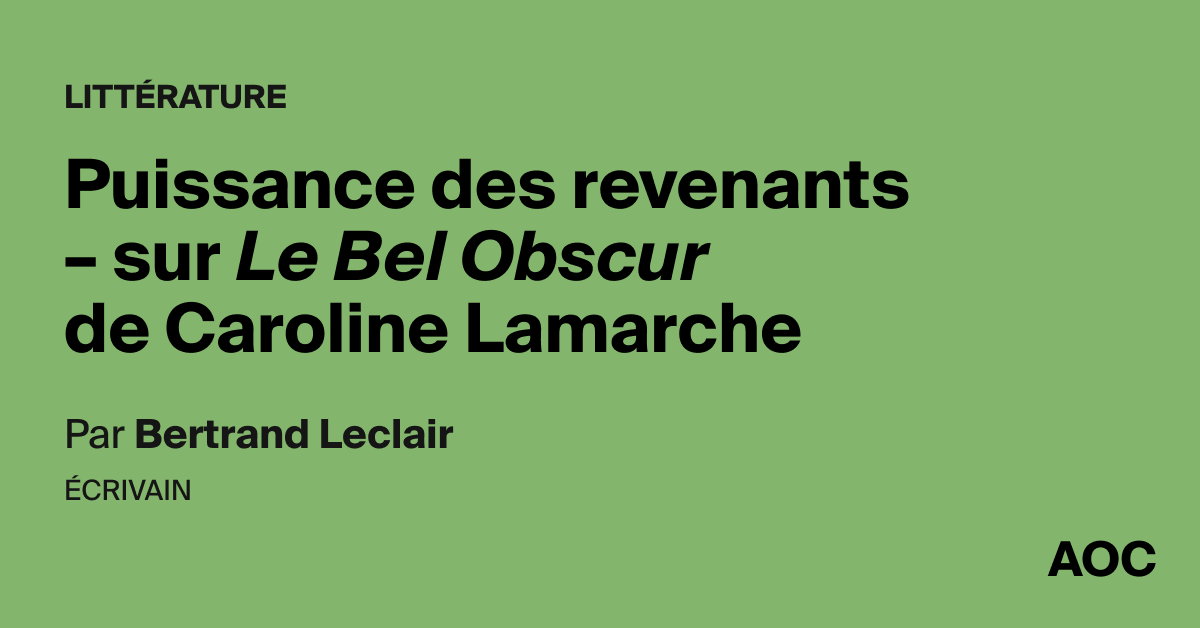Puissance des revenants – sur Le Bel Obscur de Caroline Lamarche
Dans son nouveau roman, Caroline Lamarche s’attaque à un des grands tabous de la littérature romanesque en réinventant l’écriture d’un de ses motifs les plus communs : le couple. En adoptant le point de vue d’une femme dont le mari est homosexuel, Le Bel Obscur devient cet étrange récit où un couple se fait et se défait, sans jamais se briser, au rythme des aventures extra-conjugales de ses deux protagonistes.
Sans se départir de l’ironie légère teintée de mélancolie qu’on connaît à l’autrice, le douzième roman et vingtième livre de Caroline Lamarche démarre sur les chapeaux de phrases d’un subi mouvement de rage qui pourrait être, à l’insu de la narratrice, peut-être, mais certainement pas de l’autrice, une métaphore de la décision salutaire d’écrire tout ce qui va suivre.
Alors que Le Bel Obscur doit son titre à un « proème » de Francis Ponge cité en exergue et intitulé « L’avenir des paroles » dont la merveilleuse ambivalence résonne tout au long des pages (« Le corps du bel obscur hors du drap des paroles (…) »), ses premières pages ont, paradoxalement, quelque chose d’un somptueux bouquet final qui viendrait clore l’histoire d’amour inscrite dans le temps long que le livre s’apprête à ressaisir, puisque ladite histoire semble atteindre un point de non retour.
C’est en majesté que siffle la première fusée, amorce d’une décision radicale : « J’arracherai le buddleia. Sa beauté trompeuse a régné trop longtemps ». Aussitôt les phrases fusent, zébrant le ciel chargé du récit pour en révéler un instant la profonde obscurité, avant de retrouver le sens de la terre : car la « beauté trompeuse » a des racines coriaces sinon « sournoises » en nos terres occidentales. Si le buddleia est une plante invasive parfois nommée arbre à papillons, ce qui en dit long sur le pouvoir nectarifère de ses fleurs en grappes violettes, c’est un violent combat qui commence ici et réclame la hache, la scie et l’acharnement de la bêche jusque dans les profondeurs du sol, au jardin « délaissé » qui fut celui de la narratrice et de son mari avant de n’être plus que le sien où regretter solitaire les multiples fêtes d’antan : « Je tourne autour, sciant, hachant, tranchant, furieuse et faible. Il me faudrait une force d’homme, Vincent, Nikolaï, ou les deux à la fois. J’aspire aux conseils du premier, que j’ai si longtemps appelé « mon cher mari », « mon amour », et à la vigueur du second, v