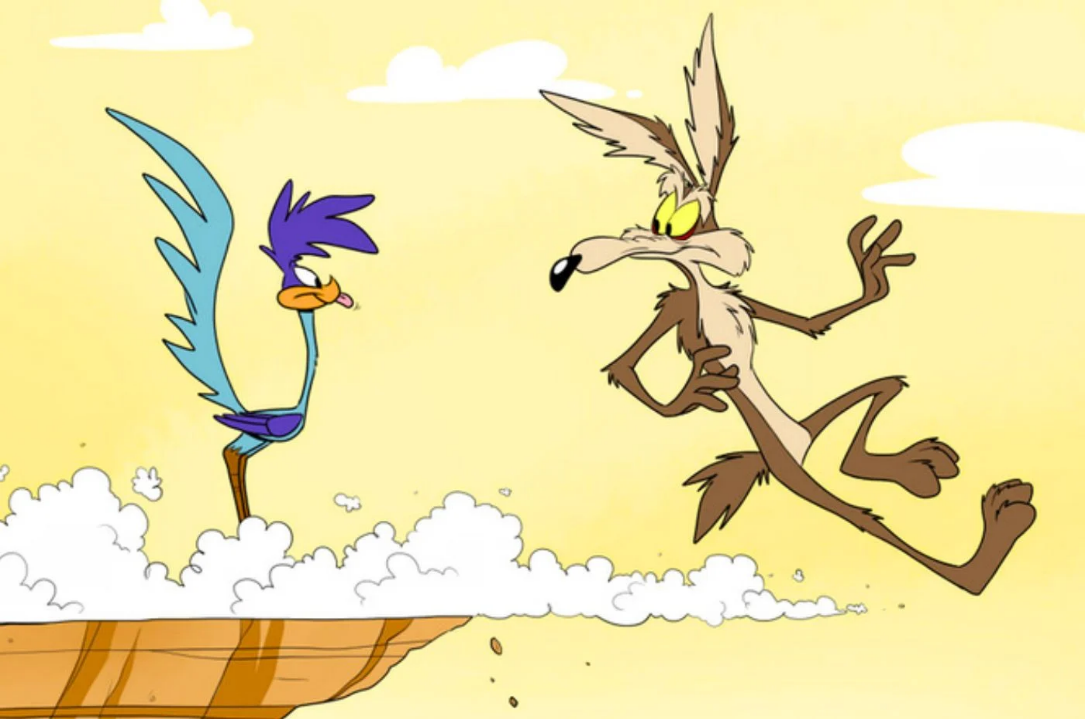Dans cet article, Stathis Kouvélakis – philosophe membre de la rédaction de Contretemps – revient sur la séquence politique de cette dernière année, de la nomination de François Bayrou à la tête du gouvernement jusqu’à sa chute. Il insiste en particulier sur un aspect généralement occulté, à savoir le rôle de l’Union européenne, et analyse la stratégie du PS dans la conjoncture politique actuelle.
***
Le vide de la répétition
On connait cette mésaventure récurrente de Coyote Rusé « Wile », un personnage des dessins animés de Tex Avery, obsédé par l’oiseau du désert « Bip-Bip » : à un certain moment de la course-poursuite, le coyote, emporté par son élan, se lance au-dessus d’un précipice et continue allégrement à courir dans le vide. Les lois de la pesanteur sont transgressées, et pourtant rien de fâcheux n’arrive, il poursuit sa course comme si de rien n’était. Jusqu’à l’instant où il finit par regarder en bas et découvre le vide au-dessus duquel il est comme suspendu. Ce vide devient alors « effectif », et les lois de la physique reprennent leurs droits.
Le philosophe slovène Slavoj Zizek se réfère souvent à cet épisode pour illustrer le paradoxe d’un « voile d’ignorance » doté, dans certaines situations, d’une fonction protectrice, paradoxe qui renvoie au décalage entre l’objectivité d’une situation et le moment de sa perception subjective qui la rend agissante. Il faut toutefois remarquer que ce qui déclenche cette perception subjective n’est pas tant une « prise conscience », au sens d’un processus mental se déroulant dans l’intériorité d’une conscience, mais un geste, un acte : regarder ses pieds.
La question qui se pose est dès lors double : qu’est-ce qui pousse le coyote à faire ce geste fatal ? Et de quoi ce drôle d’oiseau bleu, un Grand Géocoucou selon la classification animalière, est-il la représentation allégorique ? Sur ce dernier point, nous disposons d’une indication claire : comme l’indique le nom onomatopéique dont il est affublé, l’oiseau représente la répétition en tant que telle, en d’autres termes le vide d’une répétition aveugle, indestructible, qui est son propre but. « Bip-Bip » ne cesse d’afficher une mine imperturbable et satisfaite, et c’est l’affichage insolent de cette pure jouissance libidinale qui alimente la rage de poursuite de Coyote.
L’ensemble des dessins animés de cette série est construit sur le contraste entre le mouvement incessant mais toujours identique à lui-même de l’oiseau et les stratagèmes toujours renouvelés de Coyote, entièrement livré à son obsession, non moins répétitive et vide de sens que le son émis par l’oiseau coureur. C’est fort logiquement dans le vide, i.e. dans la béance d’une répétition, que « tombe » l’opposition entre les deux mouvements pulsionnels, pour réapparaître aussitôt dans les images qui suivent immédiatement la chute : car les personnages de Tex Avery sont indestructibles, ils représentent selon Zizek le « non-mort », le circuit perpétuellement recommencé de la pulsion de mort dépersonnalisée.
Le parallèle avec le sort annoncé de François Bayrou est évident : il aura suffi de l’annonce d’un mouvement social, d’autant plus inquiétant que son ampleur et ses modalités sont imprévisibles, pour que Bayrou accomplisse le geste fatal : il « réalise » alors qu’il ne dispose d’aucune majorité parlementaire et que les ruses par lesquelles il avait jusqu’alors réussi à se maintenir « dans la course » n’auront pas suffi à atteindre son objectif – sauf, bien sûr, celui de faire gagner du temps au camp bourgeois, ce qui est loin d’être négligeable, tout particulièrement en situation de crise politique.
Dans ces conditions, la demande d’un vote de confiance se présente comme l’ultime manœuvre pour prendre de court la mobilisation annoncée et mettre la pression sur la force qui lui a permis de se maintenir jusqu’ici au pouvoir, le Parti socialiste. Reste qu’un gouvernement incapable de faire adopter un budget par l’Assemblée nationale est condamné à connaître le sort de celui dirigé par son prédécesseur, Michel Barnier, en décembre dernier.
Si tout cela est de l’ordre de l’évidence, il reste quelques points à éclaircir, qui restent trop souvent dans l’ombre[1]. En nous inspirant de la chorégraphie de Tex Avery, nous nous pencherons sur ce qui a permis à Bayrou de poursuivre la course au-dessus du vide nettement plus longtemps que son prédécesseur. Nous analyserons également les conditions dans lesquelles la course-poursuite mortifère (pour les classes populaires et travailleuses) à laquelle se livrent les personnages – si cartoonesques dans leur jouissance béate du pouvoir – de la macronie pourrait se poursuivre, moyennant un changement de Coyote Rusé, ou, à l’inverse, si elle est amenée à prendre fin, du moins sous la forme que nous lui connaissons depuis l’été 2024. Mais nous nous interrogerons d’abord sur ce que l’objectif réel que cherche à atteindre dans l’immédiat Bayrou, et, derrière lui, l’ensemble du bloc bourgeois dont Macron reste le pivot, soit leur équivalent du Grand Géocoucou Bip-Bip.

« Bip-Bip » : l’Union européenne, ou la répétition compulsive de l’orthodoxie budgétaire
L’obsession de François Bayrou avec la dette publique est, on le sait, ancienne. Elle a souvent fait l’objet de commentaires ironiques, qui font apparaître Bayrou comme une sorte de Cassandre ratée. Car, à l’inverse de celles proférées par l’héroïne de la mythologie grecque, les prédictions funestes de Bayrou ont été contredites par le cours des choses, aucune crise de la dette n’ayant affecté la France depuis 2007, lorsque le président du Modem fait de cet épouvantail l’axe central de son discours.
Il est sans doute inutile de démontrer longuement ici que ce propos alarmiste sert, aujourd’hui comme hier, à justifier des politiques néolibérales, plus exactement des politiques d’austérité, qui combinent une fiscalité allégée pour le capital et les couches aisées avec la restriction de la dépense publique, avant tout aux dépens de l’Etat social. Des économistes de gauche ont à plusieurs reprises démontré le caractère fallacieux des affirmations de Bayrou, en particulier celles sur lesquelles repose l’actuel projet de budget : la dette publique n’est jamais payée, seuls les intérêts le sont, et cette charge est soutenable, et même sensiblement plus faible que par le passé, malgré la hausse du stock de cette dette[2].
Il en va de même des arguments selon lesquels les causes du creusement déficit budgétaire, qui conduit à l’endettement de l’Etat, résident dans des dépenses excessives, que ce soit des investissements publics, des frais de fonctionnement de l’Etat ou des transferts sociaux. En réalité, le problème est à chercher du côté des recettes, c’est-à-dire dans les cadeaux fiscaux faits au capital et aux ménages aisés, qui atteignent des proportions inégalées depuis le début de la présidence Macron – ses prédécesseurs, et notamment François Hollande (baisse continue des « charges » sur les entreprises et de la fiscalité du capital, CICE etc.), s’étant déjà engouffrés dans cette voie[3].
Cette contre-expertise est aussi pertinente sur le fond que politiquement nécessaire face à au discours dominant, incessamment relayé dans les médias et par les porte-parole du pouvoir. A s’en tenir là, on risque toutefois de passer à côté de la logique interne du discours de Bayrou, qui ne relève pas d’une simple mystification idéologique mais bien d’un projet politique cohérent, qui dépasse de très loin sa personne et emporte des conséquences tout à fait concrètes.
Ce projet a un nom, c’est l’Union européenne, les règles et les procédures sur lesquelles elle repose, et il s’inscrit lui-même dans les tendances à plus long terme du capitalisme contemporain : la crise de l’Etat keynésien de l’après-guerre et son remodelage par le néolibéralisme et la financiarisation. Le sociologue allemand Wolfgang Streeck a désigné cette transformation comme un passage de l’Etat fiscal de la période précédente, orienté vers la redistribution et le maintien du compromis social fordiste de l’après-guerre, à l’Etat-dette, qui repose sur un régime institutionnalisé de consolidation fiscale visant à le placer sous la surveillance permanente des marchés financiers[4].
A l’origine de ce processus se trouve la « crise fiscale de l’Etat » déclenchée par la crise des années 1970[5], avec une baisse des recettes (résultat mécanique de la baisse de la croissance) et au maintien à un haut niveau – voire, dans un premier temps, une hausse – des dépenses due à la relative rigidité des « stabilisateurs automatiques » keynésiens visant à faire face à la montée du chômage et aux effets récessifs d’un contexte inflationniste. L’endettement public, maintenu à un niveau très bas jusqu’au début des années 1980, a amorcé dès lors sa courbe ascendante au niveau mondial.
La réponse néolibérale à cette crise s’est appuyée sur la « révolte fiscale » conjointe du capital, confronté à une baisse de sa profitabilité, et des couches aisées, qui remettent en cause le pacte redistributif de l’après-guerre et misent sur la privatisation néolibérale des conditions de la reproduction sociale. Elle s’est amplifiée avec le double mouvement de la « mondialisation » et de la financiarisation, qui a libéré les mouvements des capitaux et incité au dumping fiscal entre les Etats. La montée de la finance se nourrit à son tour de la spéculation sur la dette publique et l’endettement des ménages, lequel compense le retrait de l’Etat social (dans l’éducation, la santé, l’accès au logement, les retraites etc.) et, pour la masse du salariat, la stagnation des rémunérations.
La « consolidation budgétaire » se présente ainsi comme un dispositif visant à « renforcer la confiance », i.e. à rendre l’État attractif pour les marchés financiers en leur assurant qu’il est en mesure d’assurer le service de sa dette. Les marchés financiers veulent avoir l’assurance que la dette publique est effectivement placée sous contrôle politique, ce qui doit être démontré par la capacité des gouvernements à enrayer, voire à inverser, sa croissance à long terme.
Dans un contexte de dumping fiscal entre Etats, qui interdit fait obstacle à tout accroissement de la taxation du capital, donc de la progression des recettes, cette consolidation opère immanquablement par la compression continue de la dépense publique, en particulier des dépenses sociales. La dynamique de dérégulation et de privatisation continue des biens publics alimente ainsi la transformation de l’Etat social (welfare State) en Etat visant à discipliner la force de travail (workfare State)[6].
Ce tournant autoritaire et répressif est redoublé par la dépossession démocratique inscrite dans le mécanisme même de la consolidation fiscale. Son institutionnalisation implique que cet Etat affiche une détermination sans faille à faire passer ses obligations envers ses créanciers avant toutes les autres. Cela nécessite une configuration des rapports de force politiques qui rend difficile toute augmentation des dépenses et facilite les coupes budgétaires, sauf en ce qui concerne le service de la dette et les dépenses dites « régaliennes » (défense, police, etc.).
Comme le souligne Streeck, un tel État « intériorise fermement la primauté de ses engagements envers ses prêteurs sur ses engagements publics et politiques envers ses citoyens. [Ceux-ci] sont subordonnés aux investisseurs, leurs droits sont supplantés par les revendications issues des contrats commerciaux. (…) Les résultats des élections sont moins importants que ceux sur les marchés obligataires, l’opinion publique importe moins que les taux d’intérêt, et le service de la dette prend le pas sur les services publics »[7].
Il est aisé de voir que l’Union européenne a été le vecteur fondamental de la construction d’un tel régime de consolidation dans une aire géographique où les rapports de force rendaient sa mise en place plus difficile que dans le monde anglo-étatsunien. Ses tables de la loi ont été énoncées dans les fameux « critères » institués par le Traité de Maastricht et resserrés par les traités et pactes qui ont suivis : déficit budgétaire et dette publique plafonnés, respectivement, à 3% et 60% du PIB, priorité accordée à la maîtrise de l’inflation.
Ces critères ne résultent pas d’un simple choix idéologique : ils visent à rendre crédible sur le plan international l’idée d’un euro fort, à savoir une monnaie unique inédite dans l’histoire puisqu’elle ne s’adosse pas à la banque centrale d’un Etat unifié, et ne dispose donc pas des capacités d’intervention de la Fed étatsunienne à laquelle elle est souvent comparée. De là l’obsession de l’orthodoxie ordolibérale, qui avait déjà assuré au mark son statut de monnaie forte, par opposition au franc, sujet à de fréquentes dévaluations.
C’est aussi la raison pour laquelle la banque centrale en question est à la fois « indépendante », à savoir extraite de toute contrôle politique (ce qui est la marque distinctive des institutions européennes), et tenue par un seul mandat, la maîtrise de l’inflation sous un plafond de 2%. Ses statuts interdisent le recours des Etats à un endettement intérieur, rendant impossible quelque chose comme le « circuit du Trésor » qui a permis, entre la Libération et la fin des années des années 1960, à l’Etat français de se financer sans avoir recours aux marchés.
Avec la monnaie unique, les Etats de la zone euro sont désormais tenus de se financer sur les marchés internationaux et, pour y parvenir, de faire continuellement la preuve de leur conformité aux contraintes de la consolidation macroéconomique codifiées dans les Traités européens. Certes, depuis la crise de 2015, la BCE intervient (et même de façon massive entre 2015 et 2022) sur le marché secondaire de la dette publique des Etats-membres de l’UE. C’est la politique de l’« assouplissement monétaire » qui a consolidé la baisse des taux, donc du coût de l’emprunt pour les Etats.
C’est ce qui a permis de « vendre » cette politique aux opinions publiques comme un allègement de la pression que les marchés financiers exercent sur les Etats via le mécanisme de la dette. En réalité, l’objectif de la BCE était tout autre, à savoir fournir les marchés financiers en liquidité en garantissant une forte demande en titres de dette publique. Ainsi, outre le caractère temporaire de cette mesure, le rôle décisif du marché primaire n’est pas remis en cause, les interventions de la BCE étant loin de correspondre à l’ensemble des besoins de financement des Etats.
Ainsi, entre 2015 et 2022, soit au pic de cette politique de rachat, la BCE n’a acheté que l’équivalent de 48% de la dette émise par la France, et la BCE détient actuellement (via la banque de France) moins du quart de la dette française, une proportion qui chute d’ailleurs rapidement depuis la fin de l’ « assouplissement quantitatif » et le retour à une politique de hausse des taux d’intérêt. Actuellement, une majorité des titres de la dette publique de la France (54,7% selon les chiffres de 2025) se trouvant entre les mains de « résidents étrangers ».
La composition de ce groupe est particulièrement opaque, car protégée par l’anonymat du Code du commerce, mais il s’agit pour l’essentiel des « investisseurs institutionnels » (banques, fonds de pensions, fonds d’assurance, fonds d’investissements souverains, et autres fonds spéculatifs) au comportement par définition opportuniste, i.e. extrêmement sensible au moindre frémissement des « marchés ». Loin de contrecarrer l’emprise des marchés sur les Etats, la BCE ne cesse ainsi d’agir comme leur plus fidèle soutien, ajustant sa politique aux cycles de l’accumulation du capital.
Depuis la crise des années 2010-2015, le régime de consolidation imposé par l’UE s’est en réalité rigidifié. L’éphémère relâchement de la période du Covid, au cours de laquelle les règles des Traités avaient été suspendues, avait conduit certains europhiles invétérés à déclarer la fin du corset austéritaire[8].
Sous une forme atténuée, de telles illusions s’étaient également répandues à gauche. En témoigne notamment le programme de la NUPES de 2022 qui affirmait (dans son chapitre 8) que « le contexte de remise en cause des règles européennes face aux urgences joue en notre faveur ». Se voyait ainsi doté d’un semblant de crédibilité le mantra de la « renégociation des Traités européens » qui aurait permis d’en « modifier durablement les règles incompatibles avec notre ambition sociale et écologique légitimée par le peuple ». Une proposition destinée d’avance à rester incantatoire, l’unanimité des Etats-membres étant, comme chacun sait, requise pour changer ne serait-ce qu’une virgule des traités en question.
D’ailleurs, une fois le contexte de la pandémie dépassé, les lois intangibles gravées dans le marbre des traités ont aussitôt repris le dessus, et même sous une forme aggravée. En fait, le processus était engagé depuis la crise de l’eurozone des années 2010-2015. L’adoption d’un ensemble de dispositifs – appelés dans la novlangue de l’UE « Six Pack », « Two Pack » et « semestre européen » – a permis d’accroître la surveillance des politiques budgétaires par les autorités de Bruxelles, en renforçant notamment l’automaticité des sanctions et en systématisant la mise en place de plans d’ajustement structurel pour les pays qui font face à des difficultés financières, sur le modèle de ce qui a été fait pour la Grèce.
L’instauration d’un régime de « surveillance renforcée » est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes jusqu’à remboursement de 75% de la dette. Début 2024, l’adoption du « pacte de stabilité et de croissance réformé » a sonné pour de bon la fin de la parenthèse « dépensière » des années Covid et le retour de l’austérité : les pays avec un déficit budgétaire supérieur à 3 % devront le réduire d’au moins 0,5 point de pourcentage de PIB par an. De plus, les Etats-membres dont la dette est comprise entre 60 et 90 % du PIB devront la réduire de 0,5 point par an, et ceux dont la dette excède les 90 %, de 1 point par an.
Certes, formellement, les traités et pactes de l’UE ne s’opposent pas à la hausse de la fiscalité du capital et des plus riches. Néanmoins, en vertu des fameuses « libertés » qui guident l’intégration européenne dès sa fondation[9], ils sanctuarisent la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Dans la pratique, cela signifie que si le gouvernement d’un Etat-membre augmente les impôts sur le capital, celui-ci peut (menacer de) partir dans le pays voisin sans perdre l’accès le marché du pays dont il s’apprête à partir (du fait de la libre circulation des biens et des services). Ainsi, la combinaison des règles budgétaires et des principes de la « concurrence libre et non faussée » aboutit à une situation qui ne laisse pas d’autre option pour l’ajustement budgétaire que la baisse des dépenses. Les traités et pacte de l’UE institutionnalisent donc la paralysie de la fiscalité, en mettant en place des mécanismes qui s’appliquent de façon permanente, même en l’absence de pression des marchés financiers[10].
A l’instar de l’oiseau de Tex Avery, l’UE est condamnée à répéter sans fin le « Bip-Bip » de l’austérité et de l’orthodoxie néolibérale inscrit dans ses traités fondateurs. Sauf qu’ici, loin d’être vide de sens, cette répétition est au service non pas d’un mécanisme psychique inconscient mais d’intérêts de classe parfaitement identifiables. Et elle entraîne des conséquences bien plus graves que les plongées fracassantes dont le Coyote se sort toujours indemne, à savoir sur la sanction des « marchés » et de leur relais interne à l’UE, la BCE de Francfort.
La Grèce en a été l’illustration la plus dramatique, mais rappelons-le, c’est une grande part de la périphérie européenne (Espagne, Portugal, Irlande, Chypre) qui en a également fait les frais. La récente déclaration de Christine Lagarde, en sa qualité de présidente de la BCE, est à cet égard tout à fait claire pour qui sait décoder ce type de langage : « Les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Ce que j’ai pu observer depuis six ans [à ce poste], c’est que les développements politiques, la survenance de risques politiques, ont un impact évident sur l’économie, sur l’appréciation par les marchés financiers des risques pays et par conséquent sont préoccupants pour nous ». La France d’aujourd’hui n’est sans doute pas la Grèce de 2015, elle n’est pas pour autant un cas à part, exemptée par on ne sait quel miracle de sa « grandeur » des contraintes dans lesquelles sa classe dominante et le personnel politique qui s’est mis à son service l’ont soumis depuis des décennies.

La course austéritaire de Barnier et de Bayrou
Vue sous cet angle, la séquence française de cette dernière année apparaît sous un jour nouveau. Le fait a été peu commenté, il est pourtant essentiel : pour asseoir son déni du résultat des élections législatives de juin-juillet 2024, Macron a nommé successivement à Matignon deux personnalités de droite, Michel Barnier et François Bayrou, qui partagent une fidélité absolue au cadre européen. Le premier est un ancien membre de la Commission de Bruxelles et son représentant dans les négociations sur le Brexit avec le gouvernement britannique.
Le second, un zélote du projet européen, a fait de la radicalisation de l’orthodoxie budgétaire maastrichienne sa marque de fabrique, en proposant, dès sa campagne présidentielle de 2007, l’inscription dans la Constitution de l’interdiction pour tout gouvernement de présenter, hors période de récession, un budget déficitaire. Il a ainsi anticipé de deux ans la constitutionnalisation de cette prétendue « règle d’or » par l’Allemagne, qui en avait déjà énoncé le principe dans la « Loi fondamentale » qui lui sert de Constitution depuis 1949, et sa reprise au niveau de l’UE tout entière dans le pacte budgétaire européen (TSCG) de 2012.
Le choix de ses personnalités ne peut se comprendre que si l’on prend en compte la décision, annoncée dès juin 2024, de la Commission européenne d’engager, conformément aux prescriptions du pacte de croissance réformé, une procédure contre la France pour dépassement des seuils de déficit budgétaire et d’endettement public. Comme le précise le document officiel du gouvernement de décembre 2024, « la Commission européenne a fixé une trajectoire de référence exigeante : un ajustement structurel qui représente 0,6 point de PIB par an en moyenne sur la période ».
Avant même la nomination de Michel Barnier, Macron avait assuré la continuité de la politique économique en maintenant aux manettes le trio de hauts fonctionnaires de Bercy, proches du secrétaire de l’Elysée Alexis Kohler, qui relaient les grandes lignes de la politique économique depuis le début de son premier mandat. La relation avec l’Union européenne et son régime de consolidation budgétaire sont au cœur de cette continuité.
Selon des propos d’un ancien ministre rapportés par Le Monde en septembre 2024, « leurs invariants [de ces hauts fonctionnaires] tiennent en deux points : rassurer Bruxelles et placer la dette à de bonnes conditions, quels que soient les aléas. Ils savent faire, ils ont tous les réseaux et contacts pour cela ». Belle illustration de la thèse marxiste classique de la continuité de l’appareil étatique par-delà les changements de gouvernement, et même de régime politique, qui caractérise l’Etat capitaliste[11] !
La course à la conformité au carcan austéritaire renforcé de l’UE est donc au cœur de la crise politique française. On peut raisonnablement penser que cette donnée est entrée en ligne de compte dans la décision de Macron de dissoudre l’Assemblée suite à la débâcle de son camp aux élections européennes de juin 2024. L’éventualité d’un gouvernement RN, à ses yeux la plus probable au moment de la dissolution, qui n’aurait pas d’autre choix que de mettre en œuvre le choc austéritaire préconisé par Bruxelles, pour en payer le prix par la suite, pouvait paraître comme un calcul rationnel en vue de 2027.
Le résultat des élections législatives, avec l’arrivée en tête à l’Assemblée du NFP, a obligé à un changement d’approche. Il n’a bien sûr jamais été question de confier un mandat pour Matignon à la personnalité proposée par l’alliance de gauche arrivée en tête (en nombre de sièges) à l’Assemblée. L’objectif était de gagner du temps, d’assurer la continuité d’un macronisme devenu nettement minoritaire, et, pour cela, s’efforcer de casser l’alliance de la gauche, « obtenir le scalp du NFP » comme l’avait bien vu Olivier Faure en août 2024, avant de lui apporter lui-même le scalp en question six mois plus tard, en refusant de voter la censure contre le gouvernement Bayrou.
Davantage que des porteurs d’un véritable mandat de gouvernement, qui aurait impliqué a minima un programme digne de ce nom, une ligne politique cohérente et approuvée par l’électorat (rappelons que, contrairement au NFP, le mal-nommé « socle commun » ne s’est jamais présenté aux urnes comme tel), Barnier et Bayrou sont en fait de simples chargés de mission. Celle-ci consiste à mettre en œuvre au plus vite la thérapie austéritaire prévue par le cadre européen, aggravée par la course à la militarisation lancée par l’UE depuis le début de la guerre en Ukraine.
Pour mener à bien cette « sale besogne », des personnalités sans véritable légitimité politique, ni même assise parlementaire, sont de loin préférables à des gouvernements devant rendre des comptes à des électeurs. Les précédents de la Grèce et de l’Italie de 2011, lorsque l’UE a directement organisé la chute de Georges Papandréou et de Silvio Berlusconi, remplacés par deux banquiers (respectivement : Lucas Papademos et Mario Monti) à la tête de coalition hétéroclites et chancelantes, est à cet égard instructif.
Depuis l’été dernier, et la mise sous surveillance renforcée de la France, sa politique budgétaire ne fait que se conformer au « pilotage automatique » prévu par le « pacte de croissance » de l’UE, à savoir une « trajectoire » de coupes budgétaires équivalentes à une réduction du déficit d’au moins 0,5% du PIB. Les « rapports d’avancement annuel » envoyés en avril de chaque année par le gouvernement français à Bruxelles n’ont pas pour seul objet que de de détailler l’avancement du Plan budgétaire et structurel à moyen terme (PMST) pour 2025-2029, soit, comme l’annonce le document officiel d’avril dernier, de « présenter une trajectoire budgétaire qui respecte les exigences des nouvelles règles budgétaires européennes ainsi que des réformes et investissements sur la durée, justifiant un allongement de la période d’ajustement budgétaire de quatre à sept ans ».
Mais il y a des nuances entre les deux équipes qui se sont succédées à Matignon : comme l’expliquent les études (ici et ici) de l’Institut Avant-Garde, Michel Barnier a voulu faire du zèle, en prévoyant un « ajustement plus ambitieux que ce qu’exigeaient strictement les règles budgétaires européennes et [qui] comprenait un effort important en début de période visant à ramener le déficit public à 5 % en 2025 ». Le plan de Bayrou signale un retour à la « normale » stipulée par les pactes : il « supprime la concentration des efforts en début de période prévue initialement et se rapproche davantage de la structure d’ajustement linéaire définie par les règles budgétaires de l’UE.
L’ajustement total sur la période de sept ans allant de 2025 à 2031 demeure toutefois inchangé ». L’objectif de réduction du déficit budgétaire pour 2025 est ramené par Bayrou de 5,4% à 5% – soit de 1,4% à 0,8% de point de PIB – mais il est supérieur à celui de Barnier pour l’année suivante (0,9% au lieu de 0,6%). On peut penser que Bayrou était convaincu que cet « assouplissement » pouvait suffire pour renouveler, moyennant quelques concessions cosmétiques (sur la suppression des jours de congé en particulier), le quitus du PS qui lui a permis d’accéder à Matignon. Serait alors confirmée une recomposition politique qui verrait le bloc bourgeois s’adjoindre une nouvelle composante, renouvelant ainsi l’opération fondatrice de l’ « extrême-centre » macroniste : la convergence sous le signe de la réforme néolibérale et de l’allégeance européenne du « social-libéralisme » et de la droite libérale. Mais, aux yeux du pouvoir actuel et de ses alliés, il semble que cet objectif puisse être atteint par d’autres voies, i.e. sans un Bayrou usé et à court de cartouches.
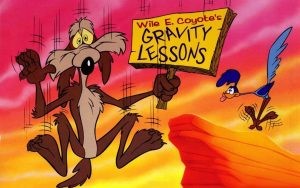
Un Coyote relooké : vers une recomposition du bloc bourgeois ?
S’exprimant le 26 août dans le quotidien des milieux patronaux, Patrick Martin, le président du Medef, a eu le mérite de la clarté et d’une certaine lucidité : « Ce qui est certain, c’est que le Parti socialiste reste le pivot dans cette affaire ». La suite lui a donné raison, et tort à celles et ceux qui pensaient (et font semblant de croire) que l’accord entre le PS et le bloc macronien de février n’était qu’une incartade passagère, que de lyriques rappels « unitaires » permettraient rapidement de surmonter.
Comme le rapporte Le Monde, la ligne que Macron a présenté devant les représentants des formations qui le soutiennent est claire : il s’agit « de « travailler avec les socialistes » pour préparer l’après-Bayrou ». Gabriel Attal, secrétaire général du parti macroniste Renaissance, abonde dans le même sens : « Quelle que soit l’issue du 8 septembre, on doit impérativement se mettre autour de la table avec les forces politiques qui sont prêtes à travailler à un compromis ». Or, comme le précise le même article, « l’initiative présidentielle a reçu un accueil favorable d’Olivier Faure. (…) A Blois [où s’est tenue l’université d’été du PS en août dernier], lors d’un déjeuner avec la presse, le patron du PS avait ainsi tendu la main au bloc central : ‘Nous ne cherchons pas à faire le programme de nos rêves. Nous avons à chercher à bâtir un projet qui peut trouver une majorité’ ».
L’objectif partagé est donc d’éviter une dissolution, en cherchant des « compromis » qui iraient plus loin dans la voie des « assouplissements » envisagés par Bayrou sans remettre en cause l’ajustement structurel en tant que tel. Raphaël Glucksmann a été encore plus clair que Faure à la sortie de son entretien avec Macron : il s’agit d’ouvrir un « véritable processus de négociation » que « l’annonce du vote du 8 septembre » a malheureusement rendu impossible.
La maire de Nantes Johanna Rolland, s’exprimant dans Mediapart en tant que première secrétaire déléguée du PS, est sur la même longueur d’onde : « laisser à penser que l’hypothèse qui réglerait la situation du pays serait la dissolution est illusoire ». Il s’agit de « gouverner maintenant », avec une équipe qui irait « de Glucksmann à Ruffin », et qui chercherait des « majorités au cas par cas ». Les chances que l’actuel locataire de l’Elysée accepte ce type de scénario sont nulles. Mais l’objectif réel n’est pas tant de permettre à un tel gouvernement de voir le jour que d’inciter à une recomposition politique « centriste » qui puisse tenir jusqu’à la prochaine présidentielle.
C’est le but du « budget alternatif » présenté par le PS (sans la moindre référence, faut-il le préciser, au programme du NFP, ni discussion préalable avec toute autre formation de gauche, y compris celles avec lesquelles il affirme vouloir gouverner) : diviser par deux le niveau de l’ajustement structurel revient à peu de choses près à placer la barre au niveau du seuil-plancher prévu par le pacte budgétaire européen (soi un demi-point de PIB par an), et à demander un délai d’une année supplémentaire (2032 au lieu de 2031) pour ramener le déficit sous la barre fétiche des 3%. Dans la conférence de presse à l’issue de l’université d’été du PS, Faure a été très précis sur ce point : « Les équilibres sont inamendables sauf à dire qu’on ne peut pas gouverner ».
Même son de cloche chez la sénatrice du Val-de-Marne Laurence Rossignol : « L’esprit de ce plan (…) est de proclamer que‘oui, nous adhérons à l’idée qu’il faut une trajectoire de réduction du déficit’ ». Quelques mesures largement symboliques du type taxe Zucman – dont certains cadres du parti laissent déjà entendre que son montant pourrait être revu à la baisse – , ou le toilettage de certaines niches fiscales pour les entreprises, mais au bénéfice des « TPE et PME innovantes » (la start-up nation n’est pas très loin), donnent l’illusion de justice fiscale.
Rappelons ici que cette taxe Zucman à 2% est censée rapporter 15 milliards – à mettre en parallèle avec les 153 milliards de profits, les quelque 70 milliards de dividendes distribués aux actionnaires et les 30 milliards de rachats d’actions réalisés par les entreprises du CAC 40 pour la seule année 2023, des « montants inégalés » comme le relève Le Monde. De même, les 7,5 milliards de recettes supplémentaires attendues par la « refonte de la fiscalité sur les dividendes et les plus-values », la « révision des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises » et la « contribution GAFAM », sont à comparer aux plus de 200 milliards d’aides publiques annuelles aux grandes entreprises, selon les chiffrage effectué dans le rapport des sénateurs Fabien Gay (PCF) et Olivier Rietmann (LR), soit, pour l’année 2023, milliards de subventions, 75 milliards d’allègement de cotisations et 88 milliards de niches fiscales. Autant dire que l’ « autre budget » du PS ne rompt en rien avec la logique de détaxation du capital mise en place par les gouvernements successifs – et garantie par les traités européens – depuis plusieurs décennies.
Quant aux mesures d’apparence plus audacieuse, elles relèvent davantage d’un effet d’annonce : la « suspension » de la réforme des retraites ne vise qu’à relancer le « dialogue entre partenaires sociaux » pour « trouver les conditions pérennes à son financement ». En d’autres termes, il s’agit de réitérer l’opération du « conclave », l’alibi principal invoqué par le PS pour justifier son refus de censurer le gouvernement Bayrou. Conclave qui a abouti au fiasco que l’on sait, mais qui a permis au macronisme de gagner un temps précieux, avec l’appui des directions syndicales.
Autre pseudo-mesure « de gauche », la soi-disant « augmentation des bas salaires », elle est censée se faire par une baisse de la CSG, soit un assèchement des ressources de la protection sociale, dans une logique typiquement néolibérale. Selon les déclarations répétées des responsables socialistes, rapportées par Les échos, « ce n’est pas un plan d’affreux gauchistes ». Comme le relève Julie Cariat dans Le Monde « l’ ‘autre projet pour la France’du PS ressemble déjà à un outil pour l’après-Bayrou et ses futures négociations gouvernementales ».

Un point de convergence supplémentaire, et fondamental, entre le pouvoir macronien et le PS doit être également souligné : c’est celui de l’augmentation des budgets militaires, engagé dès le premier mandat de Macron mais qui s’accélère de façon proprement vertigineuse depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle est boostée par l’adoption par la Commission européenne du plan ReArm Europe, qui prévoit des dépenses supplémentaires de 800 milliards d’euros d’ici 2030. Pour y parvenir les Etats sont même autorisés à déroger à la règle des 3% de déficit budgétaire, à hauteur de 1,5% de leur PIB pour une durée de 4 ans : l’austérité ne saurait toucher le complexe militaro-industriel.
Concernant la France, deuxième exportateur mondial d’armement et dont l’industrie de défense est à peu près tout ce qui reste de significatif dans un tissu industriel en lambeaux, les chiffres donnent le vertige : entre le début du mandat de Macron et l’année en cours, les dépenses militaires (hors pensions) sont passées de 32 à 50 milliards, soit une augmentation de plus de 55% (et une hausse de 1,8% à 2,06% du PIB), et l’équivalent de 80% des économies prévues par le budget alternatif du PS. Selon la loi de programmation militaire d’un montant de 413 milliards adoptée en juillet 2023 par l’ensemble des partis représentés à l’Assemblée, à l’exception de LFI et du PCF, qui ont voté contre, et des Ecologistes, qui se sont abstenus, il est prévu de porter ses dépenses à 68 milliards en 2030 (soit 2,6% du PIB). Mais il est question de revoir ce chiffre à la hausse pour atteindre un « poids de forme budgétaire » de 90 milliards d’euros, et l’objectif de 3%, du PIB, comme l’a évoqué Sébastien Lecornu en mars dernier.
Or, sur ce terrain, le consensus est réel dans l’ensemble du camp atlantiste, qui va du RN aux Verts. Après avoir voté l’augmentation vertigineuse des budgets militaires, le PS a chaudement applaudi le plan ReArm Europe, Olivier Faure déclarant « se retrouve[r] parfaitement » dans les propos d’Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sur la défense européenne. Plus hésitants, et divisés, sur l’augmentation des budgets de défense, les Verts n’en ont pas moins – par une décision de leur Conseil fédéral – chaleureusement applaudi au plan ReArm Europe et à l’idée d’une défense, et même d’une armée, européenne. De son côté, Marine Tondelier a fait la preuve qu’elle savait manier un langage martial lorsqu’elle a appelé à rejoindre l’unanimité (supposée) derrière Macron pour faire face à la menace russe et défendre l’Ukraine.
La donne a donc changé. « L’Europe, nous assurait-on, c’est la paix ». Maintenant on sait qu’au verrouillage des politiques néolibérales et à la dépossession démocratique, il nous faut ajouter la militarisation et le bellicisme.
Les conditions politiques de la riposte
On perçoit mieux dès lors le sens de ses appels à « l’unité », pour un « gouvernement [allant] de Ruffin à Glucksmann » dans les mots du secrétaire du PS. Il s’agit tout simplement d’une unité fondée sur l’exclusion de LFI et dont le véritable enjeu n’est pas tant la (fort improbable) candidature « unitaire » de la gauche (et même de cette partie de la gauche) en 2027 que d’enterrer toute politique de rupture.
Comment croire dès lors à une possible reconstitution du NFP quand l’une de ses composantes – la deuxième par la taille de son groupe parlementaire – a rompu cette alliance pour permettre à un macronisme minoritaire de s’accrocher au pouvoir et s’affirme prête à poursuivre sur cette voie ? Comment justifier l’appellation « Front populaire 2027 », présentée publiquement lors d’une réunion publique à Bagneux début juillet, et avalisée peu après par une résolution du bureau national du PS, alors qu’elle repose sur l’exclusion de la force qui est en tête des groupes élus sous l’étiquette « Nouveau Front Populaire » à l’Assemblée ? Après l’éclatement de la NUPES et celui du NFP, quelle crédibilité politique peut avoir un n-ième rafistolage électoral « unitaire » qui, aux yeux des dirigeants du PS s’est révélé être un calcul cynique qui a permis à gagner des sièges pour tourner casaque aussitôt après et servir de béquille à un pouvoir agonisant ?
Alain Bertho a fort justement appelé à se tenir « loin d’initiatives ‘unitaires’ qui démultiplient les unités partielles et les anathèmes ciblés, dans le temps suspendu des stratégies présidentielles ». Pour autant, le problème stratégique posé à la gauche, et tout particulièrement à la gauche de rupture regroupée au tour de LFI, est évident et, autant le dire clairement, aucune solution ne semble actuellement à portée de main.
Cette panne stratégique renvoie à une question de fond : que peut signifier un « programme de rupture » qui n’assume pas de rompre avec le cadre des pactes européens et du régime de « surveillance renforcée » par la Commission de Bruxelles ? Que sens peut avoir la prétention « unitaire » à un programme « de rupture » si l’on s’aligne sur la militarisation, l’atlantisme et le bellicisme ? On peut comprendre qu’au cours de l’automne de l’an dernier, les groupes parlementaires du NFP, LFI en tête, aient voulu faire œuvre de pédagogie et montrer qu’une hypothèse de gouvernement NFP était légitime, exposant ainsi le déni de démocratie perpétré par Macron. Ils ont ainsi mis en avant le vote à l’Assemblée d’amendements fiscaux qui auraient permis de rapporter 50 ou 60 milliards, soit l’équivalent des coupes budgétaires prévues par le budget Barnier. Le projet de « budget alternatif » du PS reprend du reste certaines des propositions pour lesquelles la gauche a bataillé à l’Assemblée, notamment la taxe Zucman. On avait pu parler ainsi d’un « budget NFP-compatible », selon les mots du président LFI de la Commission des finances Eric Coquerel. Mais, comme c’était entièrement prévisible, budget dont le volet recettes a été très largement rejeté par l’Assemblée. Le problème avec ce genre d’exercice pédagogique est toutefois qu’à trop oublier leurs limites on risque de perdre l’essentiel, à savoir l’impossibilité de mettre en œuvre des politiques de rupture avec le cadre néolibéral dans le cadre du carcan de l’orthodoxie budgétaire, et plus largement des traités – auxquels ils faut désormais ajouter les plans de militarisation – dont l’UE est la promotrice et la gardienne sourcilleuse.
Toute la question se ramène en fin de compte à celle de la « désobéissance » à ces traités. Les négociations en vue de l’élaboration du programme de la NUPES de 2022, qui s’étaient pourtant déroulées – du fait des rapports de force établis à gauche lors du 1er tour de l’élection présidentielle – dans les conditions les plus favorables aux positions « rupturistes » défendues par LFI, avaient montré que la ligne de démarcation au sein même de la gauche passaient bien par là. Les contorsions des formulations finales du programme en témoignent. Il est ainsi précisé que « si certaines règles européennes sont des points d’appui, chacun constate aujourd’hui à quel point d’autres, et non des moindres, sont en décalage avec les impératifs de l’urgence écologique et sociale et constituent de sérieux blocages à la mise en œuvre de notre programme ».
La liste qui suit est longue et touche à la quasi-totalité des axes du programme : traités de libre-échange, application de la « concurrence libre et non-faussée » aux services publics et aux biens communs, modèle productiviste et agro-industriel de la PAC, statuts de la BCE et règles budgétaires d’austérité du « semestre européen », libre circulation des capitaux qui « nous empêche de maîtriser un secteur financier de plus en plus agressif et nocif ». Que faire alors pour ne pas se laisser enfermer dans cette cage de fer ?
L’une des formulations les plus âprement débattues de cet accord a été celle qui a consisté à dire qu’« il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles [souligné dans le texte]. Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif : être en capacité d’appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous auront donné les Français ». « Désobéissance » ou « dérogation transitoire », au-delà de la terminologie, les mesures concrètement envisagées s’inscrivent pour l’essentiel dans le cadre d’une impossible « renégociation » des traités ou d’une plus utopique encore « Convention européenne pour la révision et la réécriture des traités européens, construite avec les Parlements nationaux et le Parlement européen », dont les conclusions seraient par la suite soumises à référendum à l’échelle des Etats-membres.
On s’imagine aisément les sarcasmes que de tels propos hallucinatoires susciteraient chez des gouvernants européens de l’heure s’ils parvenaient à leurs oreilles. Plus sobre, le programme du NFP réitère le même type d’acrobaties, en affirmant, d’une part, « refuser le pacte de stabilité budgétaire », tout en dressant, de l’autre, une longue liste de « plans » et de dispositifs (« pour l’urgence sociale et climatique », de « réindustrialisation de l’Europe », de « protectionnisme écologique et social aux frontières de l’Europe », de taxation des riches « au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l’UE ») conçus pour n’être réalisables qu’à l’échelle de l’UE. Autant dire qu’il ne peut s’agir que d’incantations vides de sens.
Pourtant, ce chapitre « Europe » se conclut par un engagement modeste mais qui a le mérite d’une certaine clarté : « nous refuserons, pour l’application de notre contrat de législature, le pacte budgétaire, le droit de la concurrence lorsqu’il remet en cause les services publics et nous rejetterons les traités de libre-échange ». Minimal, cet engagement s’est pourtant révélé inacceptable pour le PS, qui, comme l’indique son projet de « budget alternatif » (et avant cela son accord de non-censure avec Bayrou) s’est empressé de montrer sa volonté de se conformer au pacte budgétaire ici rejeté – un pacte dont les contraintes, nous l’avons montré, se sont entretemps renforcées davantage encore.
Faut-il donc se résigner à cette panne d’alternative stratégique ? Non, car, même si elle ne saurait s’en abstraire, la lutte sociale et politique déborde la logique des programmes et des rapports de force électoraux. L’ issue n’est pas à chercher ailleurs que dans le réveil populaire qui s’annonce pour les semaines qui suivent. L’expérience l’a montré : c’est la mobilisation populaire qui est décisive pour ouvrir une brèche dans les situations qui paraissent sans issue positive. A condition bien sûr de s’inscrire dans la durée, et de construire pour cela les formes adéquates. Le défi pour le mouvement qui se dessine est de faire preuve à la fois de souplesse et d’inventivité.
Le chantier qui s’ouvre est celui d’une véritable auto-organisation populaire, d’une articulation – qui assurément ne va pas sans tension et difficultés – entre formes existantes et formes nouvelles, initiatives locales ou sectorielles et structures souples de coordination. Ce processus ne part pas de rien, car il prolonge l’expérience riche des mouvements très importants de ces dernières années. Des mobilisations qui n’ont certes pas remporté de victoires mais ont permis à une intelligence collective et une volonté de combat de se déployer parmi de larges secteurs sociaux.
La capacité créatrice surgit du peuple quand il se lance dans l’action de masse mais elle demande également à être fécondée par des propositions cohérentes et structurées. Parmi celles-ci, les forces de la gauche de rupture, et tout particulièrement LFI, portent une responsabilité particulière : celle de clarifier les conditions politiques et programmatiques d’un affrontement victorieux avec l’adversaire de classe, aujourd’hui avec le bloc bourgeois, c’est-à-dire avec le pouvoir macroniste et ses alliés, déclarés ou honteux, et avec l’Union européenne, qui en est l’expression politique d’autant plus redoutable qu’elle s’affirme comme la condensation de la force coalisée de l’ensemble des bourgeoisies européennes.
Le 4 septembre 2025.
Notes
[1] Parmi les rares exceptions signalons cet article stimulant de Noam Drif, « L’Union européenne, tabou de la gauche à l’ère de la servitude », Le vent se lève, 12 août 2025.
[2] Cf. la tribune de 5 économistes membres d’ATTAC publiée le 31 août 2015 dans Le Monde.
[3] Lire le démontage minutieux d’Eric Berr dans sa note de blog sur Mediapart.
[4] Wolfgang Streeck, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Londres et New York, Verso, 2014.
[5] Sur ce sujet voir l’ouvrage classique de l’économiste marxiste et théoricien de l’écosocialisme James O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, Abingdon, Routledge, 2001 (1ère édition 1973).
[6] Cf. notamment Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Marseille, Agone, 2004.
[7] Wolfgang Streeck, The Rise of the European Consolidation State, Max Planck Institute for the Study of Societies, Discussion Paper, No. 15/1, Cologne, 2015, p. 17.
[8] Par exemple, l’eurodéputé macroniste Pascal Canfin qui déclarait en mai 2022 : « La Commission a longtemps privilégié l’orthodoxie budgétaire sur l’investissement public. Sa décision d’aujourd’hui prouve qu’elle a effectué un renversement de doctrine. On est dans une autre Europe », Le Monde, 23 mai 2022.
[9] Les « quatre libertés » sur lesquelles repose l’intégration européenne depuis le traité fondateur de Rome (1957) sont la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes. Conformément aux principes de l’ordolibéralisme, elles sont censées garantir la « libre concurrence », en empêchant la constitution de situations de monopole ou de rentes, et assurer ainsi le jeu du marché, que l’Etat se doit de garantir.
[10] Je remercie Benjamin Bürbaumer pour ces remarques sur ce point essentiel. Cf. son étude co-écrite avec Nicolas Pinsard Benjamin « The corporate welfare turn of state capitalism in France: Reassessing state intervention in the French economy, 1945–2022 », Economy and Society, n° 54. 2, 2025, p. 283–309.
[11] Dans le même article du Monde, le sociologue spécialiste des élites de l’Etat Pierre Birnbaum constate que « Le macronisme, c’est le triomphe de la haute fonction publique, qui prend en charge toutes les fonctions de l’Etat, y compris les fonctions politiques ».