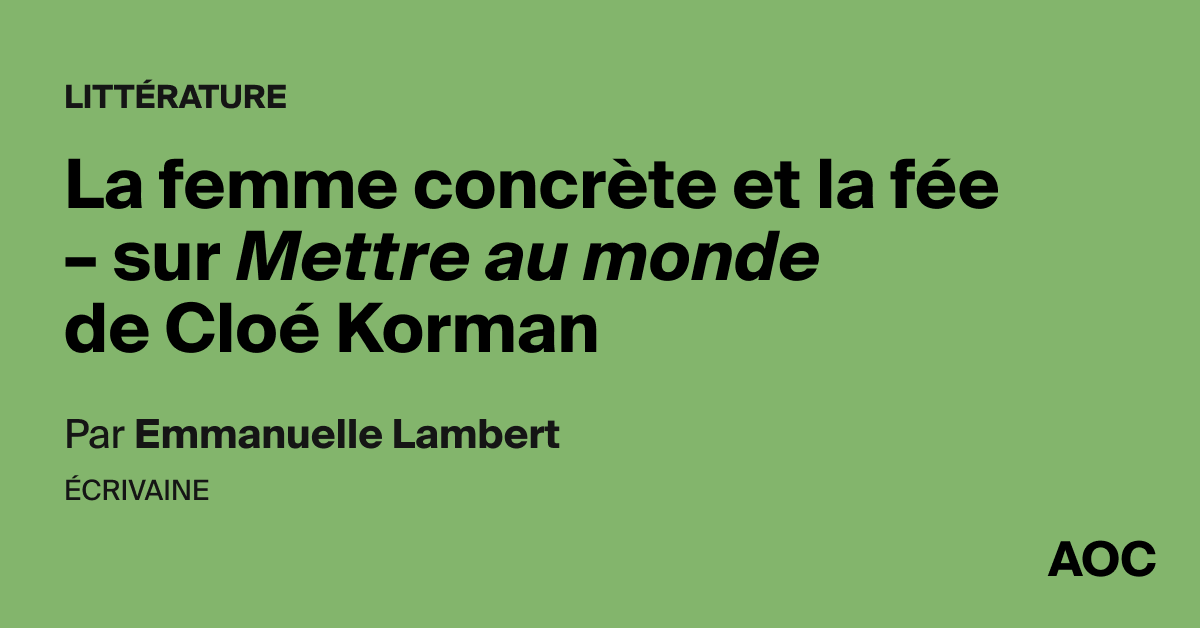La femme concrète et la fée – sur Mettre au monde de Cloé Korman
« Toutes les catégories sont également impuissantes à enfermer une femme concrète » rappelle Simone de Beauvoir à l’oreille du personnage de Mettre au monde. C’est ce que Cloé Korman nous conduit à éprouver, par son écriture du réel à la fois poétique et politique, en conjuguant le récit de l’intime et de la chair à celui d’une histoire collective : celles des femmes qui mettent au monde – ou qui choisissent de ne pas le faire.
«Mettre au monde » est une action que deux personnes peuvent dire avoir accomplie : la mère qui a donné la vie, et le ou la soignante qui l’a accompagnée. Cette double origine fournit la charpente du roman de Cloé Korman.
Mettre au monde alterne en effet les chapitres consacrés à l’une ou à l’autre de ses deux héroïnes : une femme qui va donner la vie pour la première fois, Marguerite, et une sage-femme, Jill. La première a quarante ans, est universitaire, prépare un colloque sur l’anniversaire de la loi Veil autorisant l’IVG et « tombe » enceinte, comme on dit. De qui, elle ne sait pas, le livre ne le dit pas, et nous ne le saurons pas plus qu’elle, même si nous faisons la connaissance de ses trois amants. Face à elle, la sage-femme avec qui s’ouvre et se ferme le livre : Jill est mère de deux petits garçons qu’elle élève seule, et fille de Jeanne, une ancienne infirmière qui l’aide en prenant soin des enfants pendant ses gardes. Elles habitent toutes deux Paris et pourraient se croiser à bien des occasions dans le livre. Affaire de génération, de géographie et de centre d’intérêt, puisque l’une aurait pu entrer dans le champ d’étude de l’autre. Elles ne s’y croiseront qu’à la fin.
On les suit pas à pas, dans un quotidien qui porte le sceau d’une féminité à la fois archaïque et moderne. Où les faits et gestes les plus anciens sinon ancestraux comme donner la vie, prendre soin des bébés puis des enfants, rejoignent notre contemporanéité pour laquelle la loi Veil, l’objet d’étude de Marguerite, appartient déjà au passé. Celui d’une société où les femmes mouraient déchirées, hémorragiques, abandonnées et préféraient prendre ce risque plutôt que de vivre une vie qui n’était pas ou plus la leur.
Pour la génération de Cloé Korman (et la mienne), c’est aussi et plus précisément le passé de nos mères, ce qui n’est pas anodin : dans ce livre sans narrateur ou narratrice identifiés, chaque ligne saute aux yeux comme trempée dans un bain féminin, celui de l’ex
Rayonnages
LivresLittérature