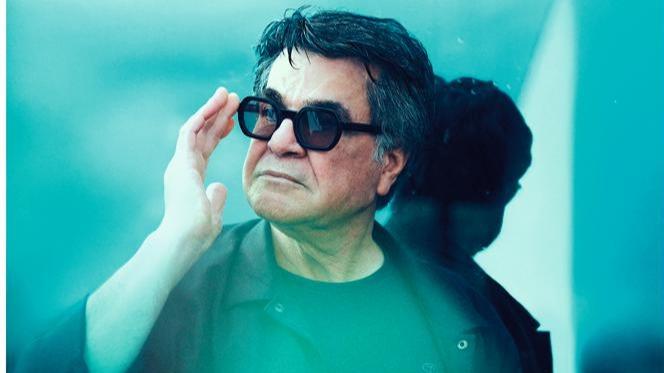INTERVIEW – Le réalisateur iranien a remporté, en mai dernier, la Palme d’or au Festival de Cannes pour Un simple accident. Rencontre avec un combattant de la liberté qui se met en danger pour filmer les réalités de son pays.
«Faisons en sorte qu’arrive le moment où personne ne nous dira ce que nous avons le droit de porter, de dire et de faire.» Le 24 mai dernier, en recevant sa Palme d’or au Festival de Cannes pour Un simple accident, le cinéaste Jafar Panahi appelle son peuple et la communauté internationale à œuvrer pour que l’Iran devienne une démocratie. Ce rêve, il le défend film après film depuis trente ans. Dans Le Ballon blanc (Caméra d’or à Cannes en 1995), Taxi Téhéran ou Trois visages, l’ancien assistant d’Abbas Kiarostami a raconté l’absence de libertés, la condition des femmes et les injustices sociales dans un pays sous régime totalitaire. Dans Ceci n’est pas un film ou Aucun ours, c’est aussi la place des artistes, le danger qu’ils représentent pour la dictature et les risques qu’ils encourent, qu’il a mis en lumière. Ces risques, il les connaît mieux que personne. Il en a payé le prix.
En mars 2010, il est condamné à six ans de prison pour «propagande contre le régime». On lui interdit alors de réaliser, d’écrire des scénarios, d’accorder des entretiens à la presse et de quitter son pays pendant vingt ans. Il passe quatre-vingt-six jours à la prison d’Evin puis, suite à une grève de la faim, est libéré sous caution. Mais rien n’altère sa détermination et son désir de cinéma, échappatoire qui lui permet depuis l’enfance de supporter la précarité, les menaces et la terreur. Dès sa sortie de prison, il reprend ainsi sa caméra – ou son iPhone, plus discret –, pour tourner dans le plus grand secret. Interdits dans son pays, ses films dissidents sont sélectionnés et récompensés dans les plus grands festivals internationaux, mais ce sont ses proches qui reçoivent en son nom le Lion d’or à la Mostra de Venise (Le Cercle, 2000) ou l’Ours d’or à Berlin (Taxi Téhéran, 2015). Les autorités iraniennes ne le lâchent pas : en juillet 2022, quand il demande des explications suite à l’arrestation de son ami cinéaste Mohammad Rasoulof, Jafar Panahi est jeté en prison. Il n’en sort que sept mois plus tard, là encore après une grève de la faim, et retrouve enfin son droit de circuler et de travailler.
Mais cette expérience le marque profondément et, après une période de cicatrisation, nourrit le scénario d’Un simple accident : un ouvrier y croise par hasard un père de famille qu’il pense être son ancien geôlier et tortionnaire. Malgré le doute, lui et d’anciens camarades de cellule kidnappent l’homme pour se venger, le tuer peut-être, ou seulement réclamer réparation, lui arracher des aveux, des regrets… Ils ne savent que faire de cette situation et le public tremble et doute avec eux. Thriller psychologique autant que tragicomédie humaine, le long-métrage du cinéaste de 65 ans a conquis Juliette Binoche et son jury cannois. Et, une fois n’est pas coutume, il est venu lui-même recevoir sa Palme d’or. Une récompense qui, aux yeux du monde entier, fait de son regard d’artiste et de citoyen une arme indestructible contre l’obscurantisme.
Madame Figaro. – Un simple accident pose cette question : comment rompre le cycle de la violence ? Avez-vous aujourd’hui des éléments de réponse ?
Jafar Panahi.– Nous fabriquons nos films avec nos idéaux et nos imaginaires, mais qui peut savoir la façon dont il réagirait s’il avait, un jour, l’occasion de se venger de son bourreau ? Il n’y a alors sans doute que la vérité du moment qui compte. Pour moi, la frontière entre fiction et réalité est très nette et je ne confonds jamais les deux. Lorsque j’étais emprisonné, par exemple, je ne pensais pas au cinéma, à ce film. Mon temps était pleinement dédié au quotidien, à mes codétenus, à nos conversations. Quand j’ai été libéré après ma grève de la faim, j’étais perdu : soulagé d’être sorti, mais lié à ceux que j’avais laissés derrière moi. Le désir de cinéma est revenu quand j’ai réalisé que ce que j’avais connu ou entendu dans ma cellule se reproduisait à l’échelle de la société iranienne. Chacun des personnages du film représente une figure ou un groupe d’opposition au régime et une façon de réagir face aux questions que je soulève : que faire lorsque l’homme qui vous a torturé ou humilié est à votre merci ? Que ferons-nous des tortionnaires quand le régime sera renversé ? Il y a ceux qui veulent répondre par la violence, ceux qui veulent oublier, ceux qui refusent d’agir comme l’oppresseur, ceux qui sont tétanisés par la peur… Et où se situe la frontière entre soumission et non-violence ? Il n’y a pas de réponse définitive, mais ce que disait Gandhi résonne en moi : si un homme tente de tuer votre fils devant vous, ne pas agir n’est pas le reflet d’une pensée non-violente mais d’un manque de courage.
L’humour permet de supporter l’insupportable. Il augmente notre capacité à affronter la tragédie
Le réalisateur iranien Jafar Panahi
Il y a aussi du rire dans le film. L’humour est-il, selon vous, la politesse du désespoir ?
Je n’ai pas cherché à faire rire en l’écrivant, cela s’est imposé au fil du tournage. L’humour permet de supporter l’insupportable. Il augmente notre capacité à affronter la tragédie. Être cinéaste, c’est jouer avec le baromètre émotionnel du spectateur, ajuster sa température pour que le thermomètre n’explose pas.
Votre imaginaire vous a-t-il aidé à supporter l’emprisonnement ?
On ne peut pas échapper à l’imagination même si, pendant ces sept mois derrière les barreaux, le principe de réalité l’emportait. Il y avait tellement d’autres priorités, comme trouver des solutions aux problèmes concrets de chacun. Moi, je pensais à ma famille, en particulier à ma mère, qui est âgée et malade. Je ne voulais surtout pas qu’elle apprenne mon arrestation : aussi, je passais des heures à élaborer des stratagèmes avec la complicité de mes codétenus pour le lui cacher. Ma famille lui avait dit que je tournais dans des montagnes reculées et que j’étais difficilement joignable. Comme elle s’impatientait et se plaignait de ne pas me voir, on «jouait la comédie» avec mes amis en cellule. Quand, enfin, j’avais l’autorisation de téléphoner, l’un d’eux prenait le combiné et lui disait : «Dites à votre fils de nous donner un peu de temps libre pour aller voir nos familles.» Je voulais juste qu’elle y croie, qu’elle n’ait pas peur pour moi. Et puis, quand le mouvement Femme, Vie, Liberté a éclaté après la mort de Mahsa Amini, la fausse excuse a été plus simple à trouver : en venant la voir en ville dans un tel contexte, je risquais l’arrestation.
Vous tournez vos films clandestinement. Votre notoriété rend-elle le secret de plus en plus difficile à garder ?
Au contraire, je pense que c’était plus difficile au début de ma carrière. En 2010, j’ai été arrêté. Ma femme et mes enfants aussi. Je n’avais pas su l’éviter, je manquais de vigilance, d’expérience. Et puis, j’ai appris. J’ai, par exemple, créé des leurres avec de fausses équipes de tournage… Au début, les gens nous croyaient fous, inconscients, mais d’autres cinéastes nous ont emboîté le pas et contournent désormais la censure. De l’extérieur, les régimes totalitaires ont l’air d’être tout-puissants et veulent donner l’impression qu’ils maîtrisent entièrement les situations. Mais la réalité est plus nuancée. De l’intérieur, nous trouvons des moyens de les duper.
N’avez-vous pas peur ?
Si, bien sûr. Nous travaillons sous pression, avec un degré d’angoisse parfois très élevé pour nous et nos équipes. Avant la fin du tournage d’Un simple accident, des policiers nous ont localisés et sommés de remettre les rushs. Mais nous les avions soigneusement cachés. Ils ont alors menacé d’arrêter l’ensemble de l’équipe et nous avons tout mis en pause alors qu’il restait deux jours de tournage. Nous avons repris un mois plus tard, en équipe encore plus réduite, et avons filmé ce qui manquait en un jour pour limiter les risques. S’adapter, c’est la clé.
Je ne suis pas un militant mais un passionné : le cinéma est tout simplement ma vie !
Le réalisateur iranien Jafar Panahi
Mais pourquoi risquer sa vie pour le cinéma ?
Je ne peux pas répondre à cette question par des slogans : «Pour défendre la liberté», «Pour contrer l’obscurantisme»… Je ne suis pas un militant mais un passionné : le cinéma est tout simplement ma vie et je ne sais rien faire d’autre ! Et, en l’occurrence, j’aime le cinéma social, qui ne peut souffrir aucune censure. Mais mon idéal n’est pas politique, il est humaniste. Mon cinéma essaie de refléter la réalité de nos quotidiens, à la manière de Vittorio De Sica quand il réalisait Le Voleur de bicyclette.
Considérez-vous l’art comme un sacerdoce ?
Pas du tout, c’est une source de plaisir. Ce qui me rend le plus heureux. Je ne sacrifie rien au cinéma. C’est lui qui me donne la force de continuer à vivre.
Et comment s’est-il imposé à vous ?
J’étais très jeune. Je vivais dans un quartier défavorisé de Téhéran et le cinéma était mon unique échappatoire. Je séchais l’école pour aller dépenser les quelques pièces durement gagnées. Avant la révolution islamique de 1979, il y avait aussi des centres culturels pour les jeunes qui proposaient des livres, des activités créatives et artistiques… Alors que j’avais 9-10 ans, une équipe de tournage qui y travaillait m’a demandé si je voulais participer. Ils cherchaient un gamin potelé, comme moi, pour jouer une scène face à un enfant très maigre. J’ai immédiatement été fasciné par la caméra, je me suis tout de suite demandé comment on percevait le monde de l’autre côté. Alors, dès que j’ai commencé à gagner un peu d’argent, en travaillant pendant les vacances, je me suis acheté un appareil photo. Le début de tout… Quand il a fallu choisir des études à l’université, le cinéma s’est imposé. Mais je ne suis pas né cinéaste. Ce sont les circonstances qui m’ont poussé dans cette voie : la classe sociale à laquelle j’appartenais, ce centre que je fréquentais, l’envie de découvrir le monde sous un autre prisme…
Être artiste en Iran, c’est accepter qu’il peut y avoir un prix à payer
Le réalisateur iranien Jafar Panahi
Vous avez remporté la Palme d’or en mai. Pensez-vous qu’elle puisse vous garantir une forme de protection contre le régime ?
Dès mon arrivée à Cannes, j’ai déclaré que je repartirais dans mon pays, quelle que soit la réception du film. Après la projection, les gens me trouvaient inconscient de vouloir rentrer. Mais ne pas assumer les conséquences aurait été trahir mon équipe, mes convictions et mes codétenus à qui je dédie ce film. Être artiste en Iran, c’est accepter qu’il peut y avoir un prix à payer, et en allant à Cannes, j’ai mis mon sort entre les mains du régime. Mais depuis la Palme, jusqu’à présent, ni moi ni mes acteurs n’avons été inquiétés. Le Festival de Cannes a une résonance internationale, bien au-delà des seules frontières du cinéma et, à notre retour en Iran, nous avons été acclamés. Le régime n’a alors eu qu’une idée en tête : minimiser l’événement et faire en sorte que ni nous ni notre film ne restons au cœur des conversations.
Vous avez tourné votre premier film en 1995. Que retenez-vous du chemin parcouru ?
J’ai mûri et gagné en confiance. Mon regard est plus perspicace : je crois mieux cerner la réalité de mon pays, de ma condition d’artiste. J’ai aussi changé d’approche dans mon travail. À l’université, mes profs voyaient déjà un cinéaste en moi. Alors quand j’ai filmé Le Ballon blanc, j’ai surtout cherché à être digne de cette conviction. J’ai réalisé ce film pour eux. Aujourd’hui, je fais des films pour moi. Avant de satisfaire les autres, il faut être satisfait soi-même. Croire en soi est le meilleur moyen pour que les autres croient en votre cinéma.
«Un simple accident», de Jafar Panahi. Sortie le 1er octobre.