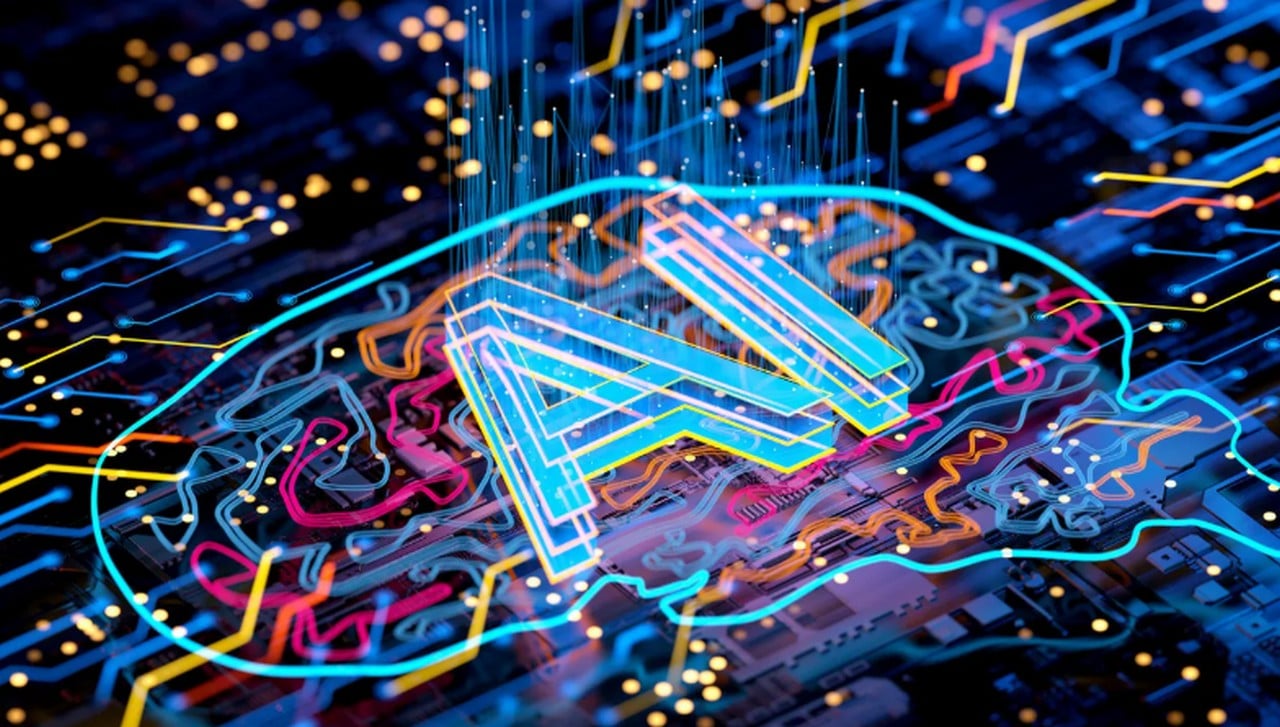En matière d’IA générative, la ville et la Métropole de Rennes n’entendent pas “céder à l’effet de mode”. Elles revendiquent au contraire un plan d’action lucide et responsable. “Nos collectivités ont voulu poser un cadre clair, garant des valeurs du service public et de l’intérêt général”, résume le directeur général adjoint chargé du pôle ressources, Johan Theuret.
Définir ce cadre, c’était l’objectif de la mission IAG dont le rapport vient d’être rendu public. “Il ne s’agit pas seulement d’explorer des usages techniques, mais d’interroger les enjeux démocratiques, éthiques et sociaux que soulève cette technologie.”
Des usages, mais aussi des impacts divers associés
C’est la raison pour laquelle la mission souligne, par exemple, l’envolée des émissions de CO2 liées à ces technologies. Ainsi, rappelle-t-elle, la consommation électrique mondiale des datacenters devrait atteindre 1050 térawatts d’ici 2026.
Pour tenir compte des impacts de l’IAG, Rennes prévoit de soumettre tout projet à la Commission du Numérique Responsable. L’usage de l’IA doit par ailleurs être envisagé dans une optique d’assistance pour les agents, et non comme un outil de remplacement.
En ce qui concerne les applications, le rapport cible trois catégories d’usages génériques à fort potentiel : la rédaction et synthèse de documents, la traduction, et l’accès à la connaissance via agent conversationnel.
L’enjeu clé des compétences et des impacts sur les métiers
La mission IAG note que la technique n’est qu’un volet d’un projet d’intégration de l’IA générative. La véritable problématique porte sur l’évolution des compétences et l’impact sur les métiers (GPEC).
Pour identifier et maîtriser les risques, Rennes peut s’appuyer sur des plateformes comme RAGaRenn de l’université rennaise. L’expérimentation doit aussi occuper une place centrale dans la stratégie d’adoption de la métropole.
Grâce à un « espace sûr et de confiance », la collectivité estime pouvoir recueillir des données réelles sur les usages, les compétences requises et les pièges potentiels. Cette approche est perçue comme centrale pour bâtir des politiques de formation fondées sur des preuves plutôt que sur la spéculation.
Formation et acculturation constituent par ailleurs la principale défense contre des risques majeurs identifiés dans le rapport, tels que la « fuite de données sensibles » ou la « perte de savoir-faire » (« Atrophie »).
Priorité aux hébergements souverains ou coopératifs
Sur le plan technique cette fois, la mission recommande de converger vers des solutions d’IA frugale et de donner la priorité aux hébergements souverains ou coopératifs. Cette orientation vise ainsi à traiter l’IA comme un assistant sous contrôle public, et non comme un substitut externalisé à des géants technologiques.
Compte tenu de la rapide évolution des outils et des usages, les auteurs plaident pour la création d’un observatoire permanent. Celui-ci se verrait confier plusieurs missions, dont une veille technologique, réglementaire et des usages.
L’observatoire fournirait également une expertise mobilisable pour les projets. Ses autres missions : maintenir une base de connaissances et mettre à jour la future « Charte des usages du numérique – IAG » de la métropole.
Enfin, plus qu’une simple stratégie interne, l’intention affichée par la mission est de partager cette méthodologie dans une logique de « création de biens communs » au profit des autres acteurs de l’écosystème public.