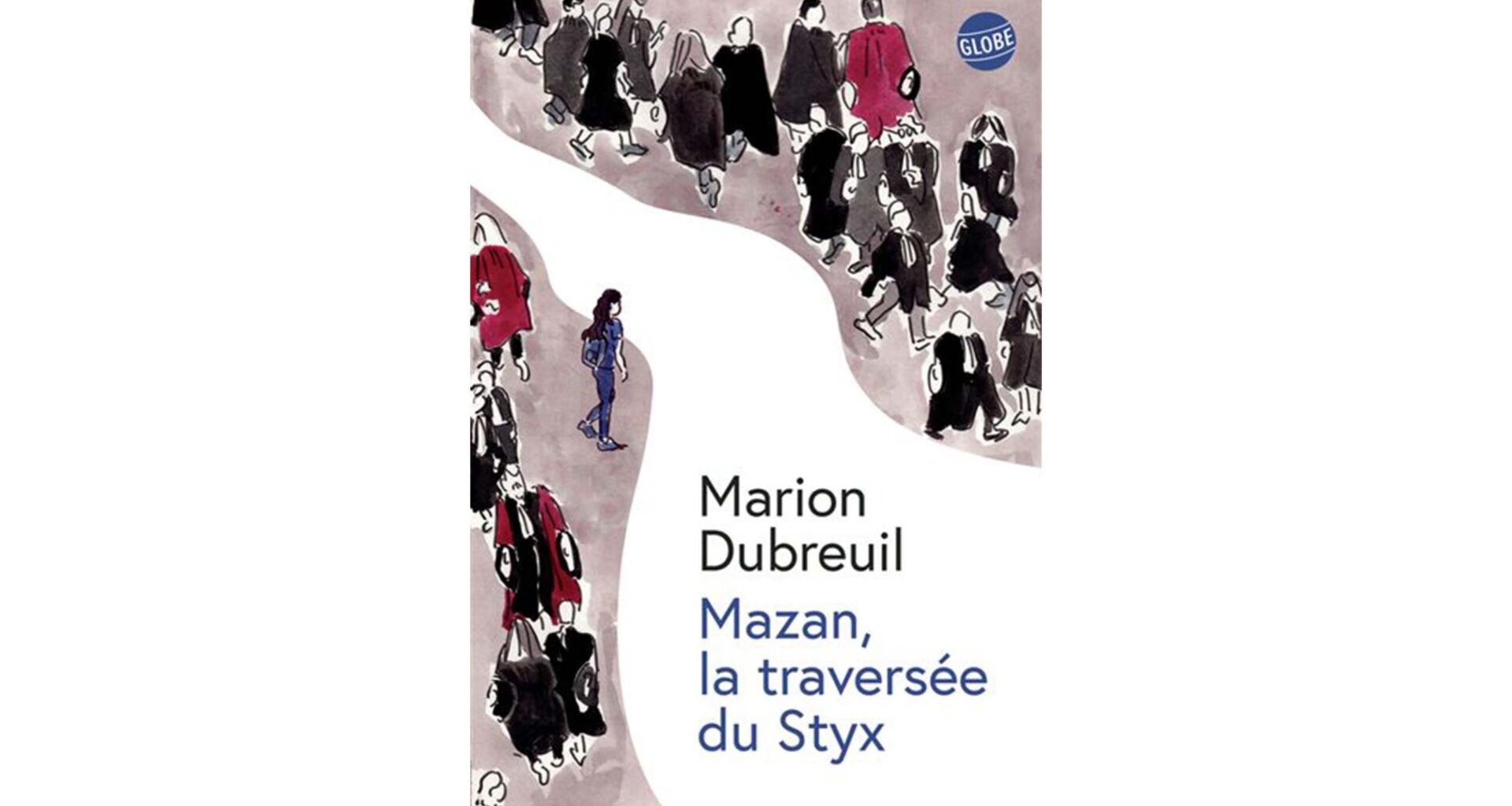Titre : Mazan, la traversée du Styx
Auteur.ice : Marion Dubreuil
Edition : Globe
Date de parution : 20 août 2025
Genre du livre : Essai
Dans Mazan, la traversée du Styx, Marion Dubreuil ne se contente pas de relater un procès : elle compose un texte d’une puissance rare, à la fois enquête, essai, témoignage et manifeste. À partir de l’affaire Mazan — centrée sur les violences extrêmes subies par Gisèle Pelicot — l’autrice interroge les rouages de la justice française et les mécanismes sociaux qui perpétuent les violences sexistes et intrafamiliales. Mais ce qui distingue profondément cet ouvrage, c’est la qualité exceptionnelle de son positionnement.
Loin des récits sensationnalistes ou des pamphlets à charge, l’autrice revendique une posture déontologique : informer, c’est documenter, contextualiser, expliquer. Elle revient sur son propre parcours, entre passion pour les récits policiers et pratique du fait divers, pour affirmer une exigence : ne plus se contenter de relater, mais témoigner d’une réalité systémique.
Pour se faire, elle déploiera pour cela une langue précise, épurée, toujours au service de la compréhension. La métaphore du Styx, choisie par l’autrice, illustre parfaitement sa démarche : il ne s’agit pas de sombrer dans l’horreur, mais de traverser le fleuve pour en observer les contours.
Une violence banale
L’un des constats les plus accablants du livre est d’ordre sociologique : l’affaire Mazan ne relève pas de l’exception. Elle est le reflet d’un système. La diversité des profils d’accusés — âges, professions, origines sociales — révèle une banalisation des violences, leur enracinement profond et leur dispersion silencieuse. Marion Dubreuil, avec la retenue d’une observatrice lucide, dresse le portrait d’hommes porteurs de ces violences : contrôle insidieux, instrumentalisation des enfants, déni, pornographisation des rapports intimes, refus de verser les pensions, menaces, brutalité. Elle convoque l’histoire du petit Tony, trois ans, mort sous les coups de son beau-père — un drame qui met en lumière l’abdication collective des voisins, de l’école, des institutions, face à des signaux pourtant criants. Elle évoque aussi Julie Douib, victime de son ex-compagnon violent, dont le procès incarne à lui seul les défaillances de la justice.
Tant d’affaires, et toujours les mêmes constats : une justice qui arrive trop tard, qui regarde ailleurs. Pire encore, censée protéger, elle devient parfois le théâtre d’une violence institutionnelle. Interrogatoires culpabilisants, attaques sur la moralité des victimes, exploitation de rumeurs et de messages privés : autant de mécanismes qui réactivent la douleur au lieu de la réparer. Elle illustre ce phénomène par des exemples concrets, comme le procès de Pontoise (novembre 2022), où les échanges privés ont été utilisés contre une victime mineure. Le procès, conçu pour protéger, peut devenir un lieu de violence plus insidieuse encore que celle qu’il juge.
La révolte, l’indignation, parfois même la haine, semblent inévitables. À travers de nombreuses affaires, l’autrice met en lumière une réalité difficilement supportable. Dans l’affaire Mazan, les preuves sont accablantes : enregistrements, photos, séquelles médicales attestent des souffrances de Gisèle Pellicot. Pourtant, la mécanique judiciaire déploie des stratégies de défense bien rodées : minimisation, insinuations sur la vie privée, mise en doute systématique. Ces postures, loin d’être anecdotiques, traversent les milieux sociaux et culturels, révélant une culture de la déresponsabilisation.
Et que dire des stéréotypes persistants autour de la « bonne victime » — brisée, silencieuse, sans résilience — et du « bon viol », souvent associé à une agression par un inconnu ? À travers les témoignages de Virginie Despentes et Giulia Foïs, l’autrice montre comment la résilience des victimes ou le statut social de l’agresseur (père de famille, citoyen irréprochable) sont utilisés pour décrédibiliser la parole. « Ma survie en elle-même est une preuve qui parle contre moi », écrit Despentes, victime d’un viol en réunion — soulignant l’absurdité des critères sociaux de crédibilité.
L’autrice remonte aux fondements historiques de la justice française. L’héritage napoléonien, centré sur la préservation de la cellule familiale, pèse encore lourdement. Elle montre comment certaines alertes d’inceste sont requalifiées en conflits parentaux, notamment via l’usage abusif du concept d’aliénation parentale. Ce glissement prive les enfants et les mères protectrices de la protection attendue, au nom d’une unité familiale sacralisée.
Une démarche déontologique exemplaire
Pour nous aider à tenir la haine et la misandrie à distance, Marion Dubreuil s’appuie sur une éthique journalistique irréprochable. Comprendre, contextualiser, sourcer : tel est son credo. Chaque affirmation est rigoureusement documentée, chaque terme juridique est clarifié, chaque procédure replacée dans son contexte. Elle explore la genèse des concepts pour offrir au lecteur les outils nécessaires à l’exercice de son esprit critique.
Son style, à la fois limpide et rigoureux, lui permet d’aborder des sujets complexes sans jamais céder à la simplification excessive. Elle restitue les émotions sans pathos mal placé, expose les faits sans froideur, et transmet les enjeux sans lourdeur didactique. Cette maîtrise stylistique confère à l’ouvrage une densité rare, rendant la lecture à la fois pénétrante et intéressante.
Mazan, la traversée du Styx dépasse largement le cadre du récit judiciaire : c’est une œuvre littéraire, éthique et politique. Elle transforme l’indignation en interpellation, et invite à repenser les équilibres fragiles entre présomption d’innocence et protection des victimes. Par son écriture exigeante, sa rigueur documentaire et sa posture déontologique, Marion Dubreuil livre un texte majeur, qui devrait figurer parmi les lectures essentielles de toute personne soucieuse de justice, de vérité et de transformation sociale.