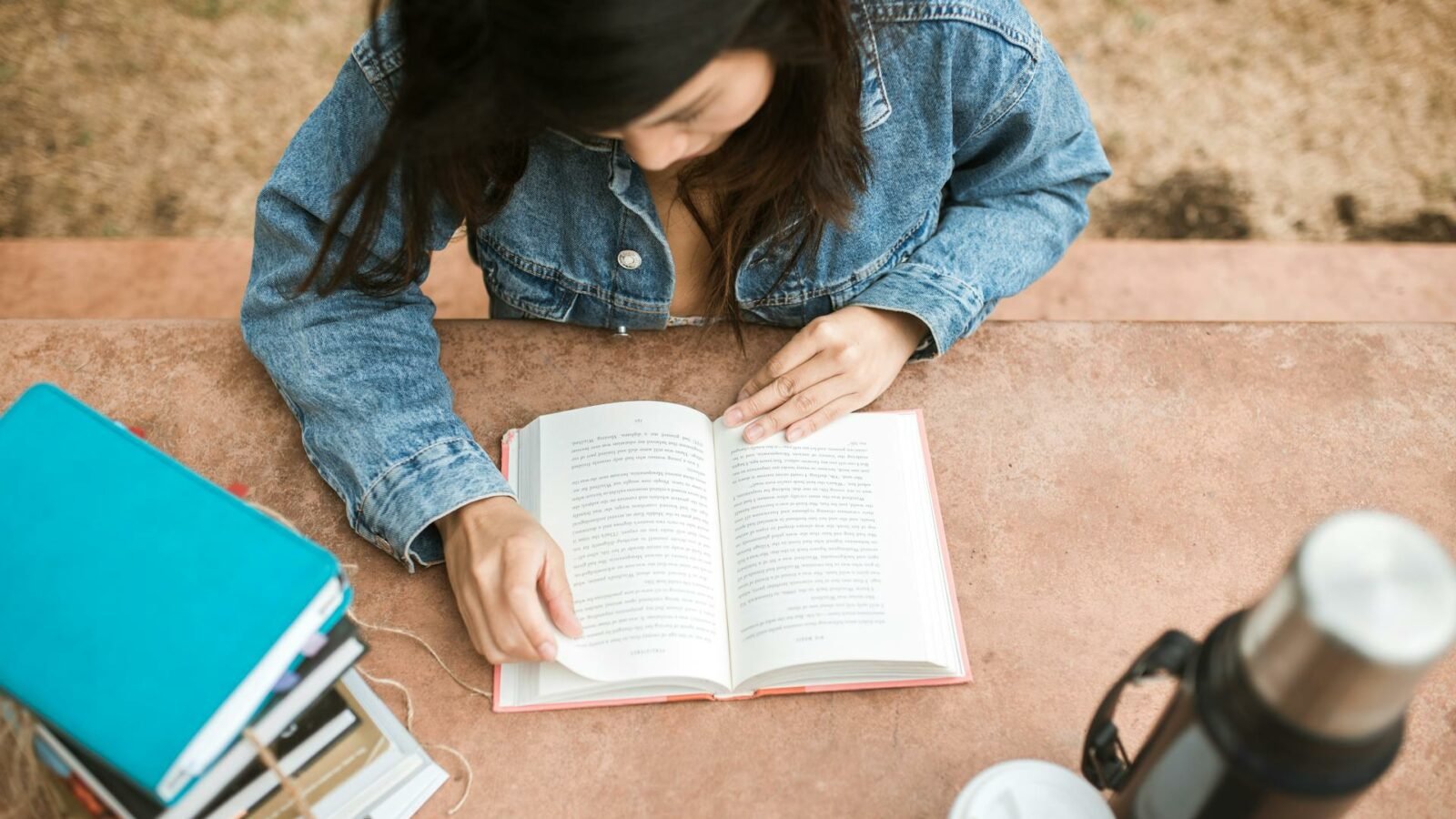La dyslexie est l’un des troubles de l’apprentissage les plus fréquents, puisqu’on estime qu’il affecte 5 à 10 % de la population mondiale. On la détecte souvent assez tôt à l’école, lorsqu’un enfant présente des difficultés à lire, écrire ou orthographier correctement des mots. Des symptômes qui peuvent parfois s’accompagner d’autres écueils, un peu moins connus, comme la difficulté à suivre des consignes données à l’oral ou à distinguer des sons (déficit phonologique).
Décrite en 1881, elle ne sera reconnue qu’en 1991 comme un handicap par l’Organisation mondiale de la Santé. De nombreux enfants en ont donc souffert, puisqu’on les accusait de « retard scolaire » ou pire, de « retard mental », mais elle est aujourd’hui considérée officiellement comme une différence neurodéveloppementale. Une étiquette officielle, qui, cependant, n’éclaircissait pas ses origines biologiques.
Ce mystère fut en partie élucidé au mois d’août, lorsqu’une équipe internationale de chercheurs a mené la plus vaste étude jamais réalisée sur le sujet. Publiée dans la revue Translational Psychiatry, celle-ci a analysé les données génétiques de plus d’un million de personnes. Leur objectif était de parvenir à confirmer par la génétique ce que l’on soupçonnait depuis des décennies : que l’origine de ce trouble est en grande partie inscrite dans notre patrimoine génétique.
Dyslexie : la preuve génétique d’une différence cérébrale
Voilà plusieurs dizaines d’années que les chercheurs pressentaient que la dyslexie avait une forte composante héréditaire. Les études familiales et sur des jumeaux allaient toutes dans le même sens : si un enfant est dyslexique, alors la probabilité que son frère ou sa sœur le soit aussi est bien plus élevée que dans le reste de la population. Toutefois, ces travaux n’avaient jamais permis d’identifier précisément les régions du génome (sections spécifiques de l’ADN contenant des informations génétiques) impliquées.
Une impasse, que l’équipe de Hayley Mountford (généticienne moléculaire à l’université d’Édimbourg) a souhaité franchir en mobilisant d’immenses bases de données génétiques. Pour les analyser, ils ont employé une méthode baptisée GWAS (Genome-Wide Association Study), qui consiste à comparer des millions de profils ADN.
Plus de 1,2 million de génomes (la plus grande cohorte réunie à ce jour) ont été analysés sous ce prisme, en comparant l’ADN de personnes dyslexiques à celui de personnes non concernées par ce trouble. L’idée était de repérer les petites variations plus fréquentes dans le premier groupe : des mutations génétiques qui désignent des zones de l’ADN influençant le développement du cerveau et la manière avec laquelle il traite le langage écrit ou oral.
Au total, 80 régions du génome se sont révélées associées à la dyslexie. Parmi elles, 36 n’avaient encore jamais été reliées à ce trouble, et 13 étaient totalement inconnues des scientifiques. Preuve que la dyslexie n’apparaît pas au moment de l’apprentissage de la lecture, mais bien avant, aux premières étapes de la construction cérébrale ; pendant la grossesse donc.
Certaines de ces régions sont aussi impliquées dans le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Cela signifie que les mêmes variations génétiques peuvent influencer à la fois les circuits cérébraux de l’attention et ceux de la lecture. Voilà pourquoi il est fréquent qu’une personne dyslexique présente aussi certains symptômes attribués au TDAH, les deux troubles partageant une partie de leur ancrage biologique (comorbidité génétique).
Fait assez étonnant : les chercheurs ont aussi découvert que certaines régions de l’ADN liées à la dyslexie coïncident avec des marqueurs génétiques déjà associés à une plus grande sensibilité à la douleur chronique. Pour l’instant, les chercheurs ne s’avancent pas sur ce point. « Le mécanisme sous-jacent reste encore mal compris ; toutefois, le chevauchement génétique entre les phénotypes liés à la douleur et les traits neurodéveloppementaux pourrait suggérer une base biologique commune », expliquent Mountford et son équipe.
Bien sûr, on ne peut réduire la dyslexie à sa seule dimension génétique, mais la démonstration est faite : une part très importante de ce trouble a une origine biologique. Une grande découverte, certes, mais qui ne doit pas nous conduire à un déterminisme simpliste ; ce serait une grosse erreur d’appréciation. Dans le contexte de cette étude, la génétique fournit un cadre de lecture essentiel, mais ne prétend pas élucider totalement ses origines. Un cadre qui doit être mis en relation avec de nombreux autres facteurs : environnement social, ressources cognitives ou expérience individuelle. Une partie du phénomène a au moins trouvé son explication. Cependant, il reste encore une gigantesque montagne à gravir pour le comprendre pleinement : l’épigénétique, soit l’influence de l’environnement sur l’expression de ces gènes. De nombreuses années de recherche nous attendent encore, mais cette reconnaissance scientifique vient déjà corriger des décennies d’erreurs d’interprétation.
- Une étude génétique sans précédent a passé au crible plus de 1,2 million de profils pour mieux comprendre la dyslexie.
- Elle a révélé 80 régions du génome associées au trouble, dont 36 nouvelles et 13 totalement inédites pour la science, confirmant son origine génétique.
- Ces résultats confirment un ancrage biologique clair et révèlent même des recoupements inattendus avec le TDAH et la douleur chronique.
📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.