Il n’est pas certain qu’il faille lire le dernier livre de Christophe Fourvel comme un « roman noir ». On reconnaîtra le style qui lui est propre, qui caractérise l’ensemble des autres livres qu’il publie maintenant depuis plus de vingt-cinq ans. Lorsqu’on l’interroge, il répond que son écriture « réside à son insu dans une unité qui l’autoriserait à aborder tous les champs littéraires ; qu’il creuserait d’une certaine façon un unique sillon et ce, quoi qu’il entreprenne ».
Sont ainsi parus récemment des essais sur le peintre Jean-Pierre Schneider (L’Atelier contemporain, 2024) et sur Stig Dagerman (La Fosse aux ours, 2023), ou à nouveau chez Médiapop, Chroniques des années d’amour et d’imposture, un autre « roman », inclassable, qui expliquerait en partie pourquoi on ne lirait peut-être pas encore suffisamment Fourvel à sa juste valeur. « La culture de masse est machine à montrer le désir, écrivait Barthes. Voici qui doit vous intéresser, dit-elle, comme si elle devinait que nous étions incapables de trouver tout seuls qui [ou quoi] désirer. » Les rentrées romanesques successives et hégémoniques en sont un des exemples, l’arbre qu’on exhibe exagérément cachant la forêt que la littérature s’obstine à obscurcir.
Les quelques secondes qui manquent à ma mémoire ne se contente pas de raconter une histoire, fût-elle habilement ficelée ; on devine hors cadre une vérité qui est celle de l’auteur, et qui s’écrit. Un homme, Herner, devenu presque malgré lui tueur à gages, exécute froidement les missions qu’on lui confie jusqu’à ce que déraille en lui quelque chose qui va lui être fatal. Si Fourvel maîtrise, ou s’amuse à jouer avec les codes du « roman noir », le livre fourmille de références. Herner ne se lasse pas d’écouter et de réécouter le Köln Concert de Keith Jarrett qui règle tel un métronome les crimes à répétition qu’il orchestre. Il est encore fait hommage à Manchette et à La position du tireur couché (bien que nous pensions davantage à American psycho de Bret Easton Ellis en raison de la description prosaïque parfois d’un menu, de l’ameublement ou d’un détail vestimentaire). Mais la référence la plus évidente est cinématographique, le thriller sur grand écran d’avant les séries, Quelques secondes, avec des allusions au Parrain de Coppola ou à Kill Bill de Tarantino, pouvant se lire comme une « adaptation » du Samouraï de Jean-Pierre Melville.
Comme Fourvel, Herner a grandi à Marseille, une ville qui sert d’arrière-plan à l’intrigue. On comprend qu’enfant sa relation avec son père, Roberto, un ancien malfrat, fut conflictuelle, funèbre, et qu’elle détermina son destin. Un soir, alors que le fils et sa mère regardaient Le Samouraï à la télévision, le père rentré tard a éteint le téléviseur les empêchant de voir la fin du film de Melville… quatre minutes vingt-trois secondes avant la conclusion. Le fait de résumer la situation de ce chapitre charnière ne suffit pas à expliquer la façon dont Fourvel réussit à l’écrire, à écrire les « quelques secondes qui manquent à sa mémoire » pour tenter de raconter pourquoi l’enfant est devenu un tueur à gages, un double de Jef Castello interprété par Alain Delon et qu’il a l’impression de retrouver dans le chat qui rôde en bas de chez lui.
Lui-même ensuite va être père en faisant un enfant à une jeune prostituée lettone, Jelena. À travers les conversations à Riga qu’il a avec sa fille Zane, nous entrons progressivement dans les méandres mélancoliques de sa conscience. Il se reproche de ne pas avoir tué le seul homme qu’il aurait dû éliminer, le proxénète qui battait sa mère. Betty, l’entremetteuse par laquelle il a rencontré Jelena, lui dit qu’elle est sa « rédemption ». En elle, dans sa fille Zane, « il se perd dans son visage comme on se perd dans le visage peint de Marie, d’une rescapée viet après une tempête de Nalpam, d’une reine dans une miniature du XVIIe siècle ». Il lui raconte que son père l’avait obligé de l’aider à étouffer sous un oreiller sa grand-mère, c’est-à-dire sa mère à lui, qui était en train de mourir à l’hôpital. Le matricide, insoutenable, déplace la noirceur du roman et d’un fait hélas divers, Fourvel démasque l’envers du décor à l’image de ce bar de la pègre marseillaise où Herner a ses habitudes et qui s’appelle « L’Endroit ».
L’enjeu est politique, un des ressorts du polar, avec le crime ou le sexe dont ne manque pas le livre, deux ou trois « beautés singulières » qui n’arrivent pas à démélancoliser Herner. Par moments, il a des hallucinations et il voit les 1,81 morts par minutes sur la planète se mélanger dans les rues aux tonnes d’excréments que les vivants ne cessent de produire chaque jour. L’axe que suit Fourvel partirait des étranges et nostalgiques années 1980, du monde d’avant la révolution numérique, et viendrait buter contre une impasse, la nôtre. Il aurait pu choisir de privilégier la crise écologique ou financière, mais il a préféré prendre appui sur les questions que soulève le terrorisme, en particulier le radicalisme islamique depuis les attentats de 2015. Herner, qui est un tueur professionnel, se demande comment on peut tuer non pas pour de l’argent mais au nom d’une croyance religieuse. L’ironie philosophique de Tambo, le colosse qui fait office de vigile à L’Endroit, victime lui-même du fanatisme, ne semble pas suffire. Dans un rêve, ou un cauchemar dont il ne parvient plus à se réveiller, il se met à dialoguer avec Mohamed Abrini, un des terroristes qui a participé aux attentats de Paris et de Bruxelles,
Trois parties composent le roman que rythment de brefs chapitres. Dans la première, la plus longue, Herner sait ce qu’il doit faire : tuer. Dans la seconde, la plus courte, après les attentats de 2015, il ne sait plus trop ce qu’il peut savoir. Enfin, dans la troisième, l’épilogue, le futur désormais le terrorise. Sa mort, ce qu’il lui est permis d’espérer, ressemble à celle de Jef Costello, les quatre minutes vingt-trois secondes avant la fin du film qui manquaient à sa mémoire. La seule différence est qu’il n’écoute pas Caty Rosier jouer la musique de François de Roubaix, mais les premières notes du Köln Concert que nous lisons en ouverture du roman, sol, ré, do, sol, la…
Post-scriptum : À la question « Pourquoi Herner tue ? », Christophe Fourvel m’a adressé le message suivant que je me permets de retranscrire : « La cause, comme toujours, est un maillage abscons, composé de fils biographiques et de l’expérience sociale et politique. Il tue parce que son père a fait de lui un tueur, parce qu’il est fort de la certitude de ne pas être un agent du mal aussi important que les États, les entreprises polluantes, ceux qui bâtissent égoïstement un territoire à eux. Il tue parce qu’il pense que ceux qu’il élimine cessent par là-même d’être toxiques. Parce que le cinéma a fait des tueurs, comme lui, d’une classe, d’une mélancolie et d’une beauté inégalables… Mais ce que je retiens, c’est ce que lui a appris son histoire intime : l’homme qui lui a fait le plus de mal (le proxénète de la mère de Zane) est celui qu’il n’a pas éliminé. J’aime ce constat : tous ses malheurs viennent du seul homme qu’il a choisi d’épargner… Il tue à cause de ce délire narcissique qui le conduit à s’identifier à un pianiste de jazz… Il tue par nihilisme. L’époque pousse de plus en plus au nihilisme. Mais là, surgit des tueurs “de foi” venus d’un autre horizon… Et cette effraction du sens dans un monde qui, lui, en semble dépourvu, crée un nihilisme plus puissant encore, qui le convaincra d’accepter sa propre mort. »
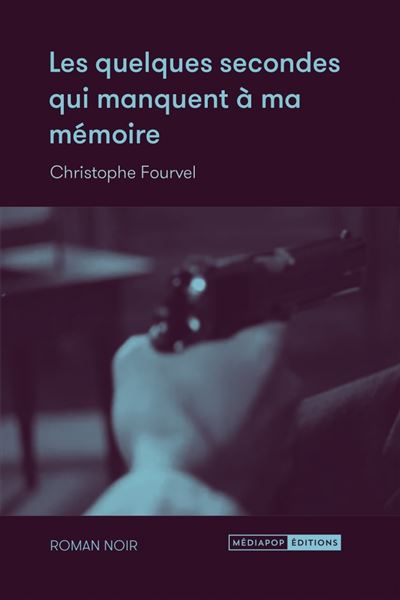
Christophe Fourvel, Les quelques secondes qui manquent à ma mémoire, Médiapop, 2025, 187 p., 14 €
Similaire
