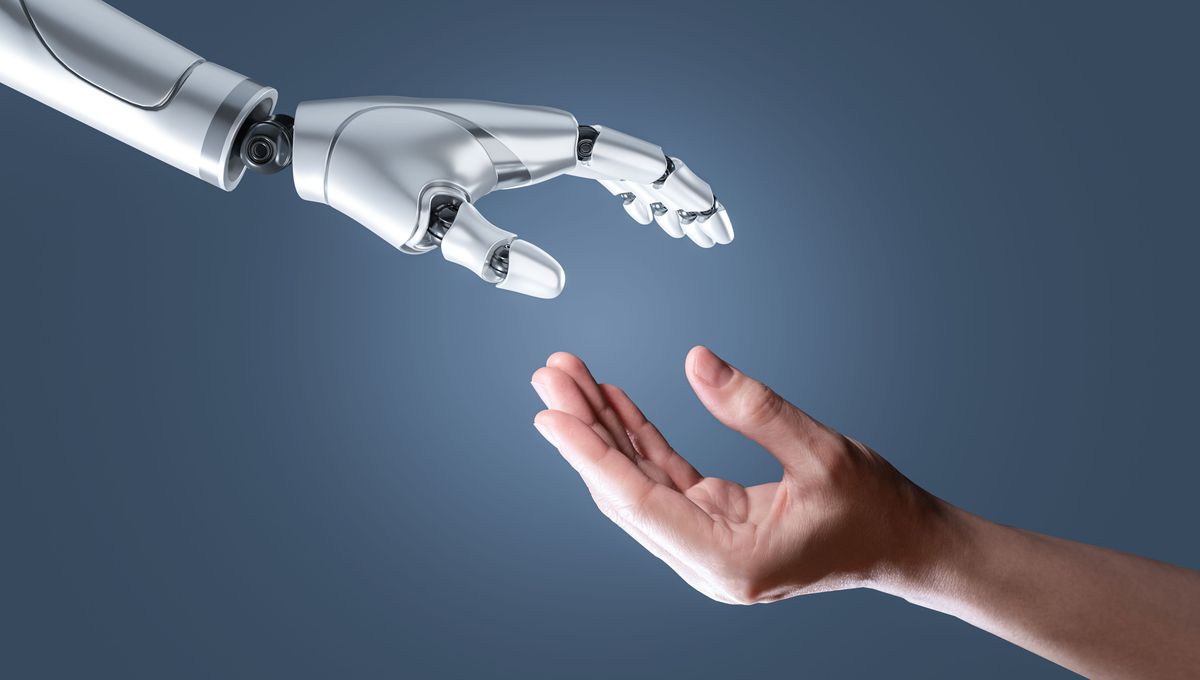Depuis la mise en ligne de ChatGPT en novembre 2022, l’IA n’a cessé d’étonner – y compris les chercheurs ! – par ses prouesses. Des résultats stupéfiants dont certains craignent l’impact dans le monde du travail. Mais que nous apprennent ces actions que l’IA parvient à imiter ? Quelle part de l’intelligence humaine parvient-elle à mimer ? N’en est-elle qu’une pâle copie ? Nathan Devers en débat – Sans Préjuger – avec le philosophe et mathématicien Daniel Andler, la professeure en IA et chercheuse Laurence Devillers et le philosophe Valentin Husson.
Le match Hervé Le Tellier VS IA
En mars 2025, Le Nouvel Obs organise un concours littéraire entre Hervé Le Tellier – prix Goncourt 2020 –, et l’intelligence artificielle – ChatGPT. La consigne est simple : écrire une nouvelle, dont la première et la dernière phrase sont déterminées. Hervé Le Tellier lui-même se dit alors bluffé par la « créativité littéraire » de la machine. Que révèle ce match ? L’IA pourrait-elle battre l’esprit humain dans ce qu’il a de plus propre – la créativité ? Pour le mathématicien et philosophe Daniel Andler, il s’agit ici d’un « exercice de style ». « C’est au fond résoudre un problème de créativité », précise-t-il. Il compare cette expérience à la résolution d’un problème mathématique, qui est à distinguer avec l’activité de la recherche en mathématiques. Impressionnés par le résultat, nous oublions le processus qui dépend d’une motivation, de l’intention d’un artiste, selon Daniel Andler. Pour Laurence Devillers, il s’agit d’une expérience très machinique. La victoire était donc prévisible, selon elle. « C’est une optimisation dans un océan de documents. Et cela, la machine sait très bien le faire », affirme-t-elle. Ce n’est donc ni de l’art, ni de la créativité, selon la chercheuse spécialisée en IA.
Face à ces battles entre écrivains et IA, le philosophe Valentin Husson rappelle « l’angoisse fondamentale de l’être humain à l’égard de la machine, et cela depuis des siècles. » Freud évoquait trois blessures narcissiques de l’homme : « la première, c’est Copernic : nous ne sommes plus au centre de l’univers. La seconde, c’est Darwin : nous ne sommes plus les premiers dans l’ordre de la création. La troisième, c’est la psychanalyse : le moi n’est plus maître dans sa propre maison ». Valentin Husson en ajoute une quatrième : « avec l’intelligence artificielle, nous avons l’impression que notre conscience n’est plus maîtresse d’elle-même, que nous ne sommes plus les maîtres de notre intelligence. »
De quoi l’histoire de l’IA nous informe-t-elle ?
Ce parallèle entre intelligence humaine et intelligence artificielle n’est pas nouveau. Un retour à une généalogie de l’IA permet d’éclairer comment un discours autour de l’IA s’est façonné en parallèle de son invention. L’IA a une longue histoire, dont les premiers jalons débutent dans les années 1940. Dès les années 1970 apparaît le rêve prométhéen, c’est-à-dire l’idée de « voler au Dieu ou à la création, le secret de l’intelligence humaine – aussi bien , la conscience que le mental en général », explique Daniel Andler. Il y a alors deux directions de réflexion qui naissent. Une première philosophique et conceptuelle s’interroge sur cette machine « intelligente », sur ce que cela signifie, sur comment la tester. Une seconde branche – « plus proche du métier d’ingénieur – produit des machines, des algorithmes capables de faire des choses précises, de jouer aux échecs, de planifier, etc. », précise Daniel Andler. On questionne alors la possibilité de constituer une intelligence humaine, par l’addition de toutes ces solutions de mécanisation et d’automatisation de différentes tâches.
Daniel Andler poursuit cette plongée dans l’histoire de l’IA, mettant en évidence deux grandes périodes. Dans un premier temps, on tâche « d’analyser la manière dont nos pensées conscientes s’organisent, et s’enchaînent de manière à nous faire gagner aux échecs, etc. », afin de les traduire sous forme d’algorithmes. Si ces application algorithmiques ne se sont pas toujours montrées fructueuses, un nouveau paradigme rebattra bientôt les cartes : c ‘est l’arrivée du connexionnisme, ou « approche réseau, qui a conduit aujourd’hui au triomphe de l’intelligence artificielle ». Quelle est la différence d’approche ? Le connexionnisme ne s’intéresse plus « à ce qui se passe dans la pensée consciente, et pense plutôt à un processus dont l’image-type est la perception », explique le mathématicien.
Penser l’IA au sein d’une histoire matérielle
En 1948, dans la préface de son célèbre Cybernetics, Nobert Wiener revenait sur l’impact de la première révolution industrielle : « la première révolution industrielle, […] fut la dévaluation du bras humain par la concurrence de la machine. Le gagne-pain minimum d’un prolétaire américain ne sera jamais assez bas pour faire face au travail d’une excavatrice à vapeur. La révolution industrielle moderne est pareillement à même de dévaluer le cerveau humain, au moins dans ses décisions les plus simples et les plus routinières. » Faut-il être aussi alerte face à la révolution numérique ?
Le philosophe Valentin Husson rappelle l’importance de replacer l’émergence de l’IA dans un contexte plus large, celui des révolutions techniques de la communication : « Il y a eu l’invention de l’écriture, celle de l’imprimerie, et aujourd’hui, celle du numérique et de l’intelligence artificielle. » L’invention de l’écriture a permis la création du monothéisme en rendant possible la diffusion de croyances au-delà de sa tribu, et ainsi convertir. L’invention de l’imprimerie a été un rouage essentiel des révolutions des Lumières en offrant une puissance de diffusion nouvelle : la démocratisation des savoirs était enfin matériellement réalisable. Qu’en sera-t-il aujourd’hui avec l’IA ?, interroge en somme Valentin Husson, nous invitant vers une voie plus optimiste de réflexion.
Ouvrages de nos invités :
- Daniel Andler, Intelligence artificielle, intelligence humaine : la double énigme, Éditions Gallimard, 2023 :
- Laurence Devillers, L’IA, ange ou démon ?, Éditions du Cerf, 2025 ;
- Valentin Husson, Foules ressentimentales. Petite philosophie des trolls, Philosophie Magazine Éditeur, le 3 octobre 2025.