Le mystère est relancé ! Une nouvelle hypothèse vient d’être présentée concernant l’identité du modèle de la Jeune Fille à la perle (vers 1665), œuvre la plus célèbre de Johannes Vermeer (1632–1675) qui n’a cessé d’alimenter les spéculations. Selon l’historien de l’art britannique Andrew Graham-Dixon, qui a détaillé son idée dans un ouvrage à paraître le 23 octobre, Vermeer: A Life Lost and Found, la belle inconnue au regard envoûtant pourrait être la fille de ses principaux mécènes, associée à des significations religieuses particulières…
Lors de ses recherches menées dans des archives à Delft et Rotterdam, Graham-Dixon s’est plongé dans les liens étroits qui unissaient l’artiste et ses clients privilégiés : le couple fortuné formé par Pieter van Ruijven et Maria de Knuijt, qui lui a commandé ou acheté près de la moitié de ses 37 tableaux connus – la principale commanditaire étant Maria et non Pieter, selon une étude publiée en 2023 par les chercheurs Piet Bakker et Judith Noorman de l’Université d’Amsterdam.
À lire aussi :
« La Jeune fille à la perle » de Vermeer : un regard pour l’éternité
Une représentation allégorique liée à Marie-Madeleine ?
Marié en 1653, ce couple avait une fille, Magdalena van Ruijven, née en 1655 – et qui décédera à l’âge de seulement 27 ans, deux ans après avoir épousé l’imprimeur Jacob Dissius. Selon Graham-Dixon, celle-ci était âgée de douze ans au moment de la réalisation du tableau, qu’il situe vers 1667, et s’engageait alors sérieusement dans la foi chrétienne, en prévision de sa confirmation. Pour le chercheur, l’œuvre serait une représentation allégorique de la jeune fille, sous les traits (en référence à son prénom) de sainte Marie-Madeleine. Plusieurs éléments iraient dans le sens de cette disciple de Jésus, souvent associée à une prostituée repentie, ou « pécheresse pénitente » : les yeux levés, humides, presque implorants, mais aussi la tenue, et la fameuse perle.
Soit portées, soit retirées en signe de renoncement, des perles se trouvent ainsi dans plusieurs tableaux figurant Marie-Madeleine.
Si Marie-Madeleine est le plus souvent représentée avec des cheveux dénoués et accompagnée d’un crâne, d’un livre ou d’un flacon d’onguent, un autre élément lui est en effet parfois associé : la perle ! Cette concrétion de nacre de forme ronde, cachée au creux des huîtres, a une signification ambiguë : elle symbolise en effet la richesse, la sensualité et la séduction, mais aussi le Royaume des cieux, la pureté virginale, la valeur spirituelle cachée et la transformation intérieure. Soit portées, soit retirées en signe de renoncement, des perles se trouvent ainsi dans plusieurs tableaux sur le sujet, comme Sainte Marie-Madeleine lisant de Piero di Cosimo (vers 1490–1495), Marie-Madeleine de Jan van Scorel (1530), Marie-Madeleine pénitente de Caravage (1597), et Marie-Madeleine retirant ses bijoux de Juan Correa (XVIe siècle).
La théorie selon laquelle la Jeune Fille à la perle serait une Madeleine avait déjà été avancée par le passé. Mais Graham-Dixon la lie plus précisément à la fille de Ruijven et aux croyances de cette famille. L’historien rappelle en effet que Vermeer, Pieter van Ruijven et son épouse Maria faisaient partie du cercle des « remontrants », partisans de l’arminianisme – un courant protestant anti-calviniste fondé au début du XVIIe siècle sur la base des idées de Jacobus Arminius, défenseur du rôle du libre arbitre dans le salut de chacun.
À lire aussi :
Le pouvoir d’attraction de « La Jeune Fille à la perle » de Vermeer percé à jour par des scientifiques ?
Un modèle qui ne cesse de nourrir toutes les spéculations
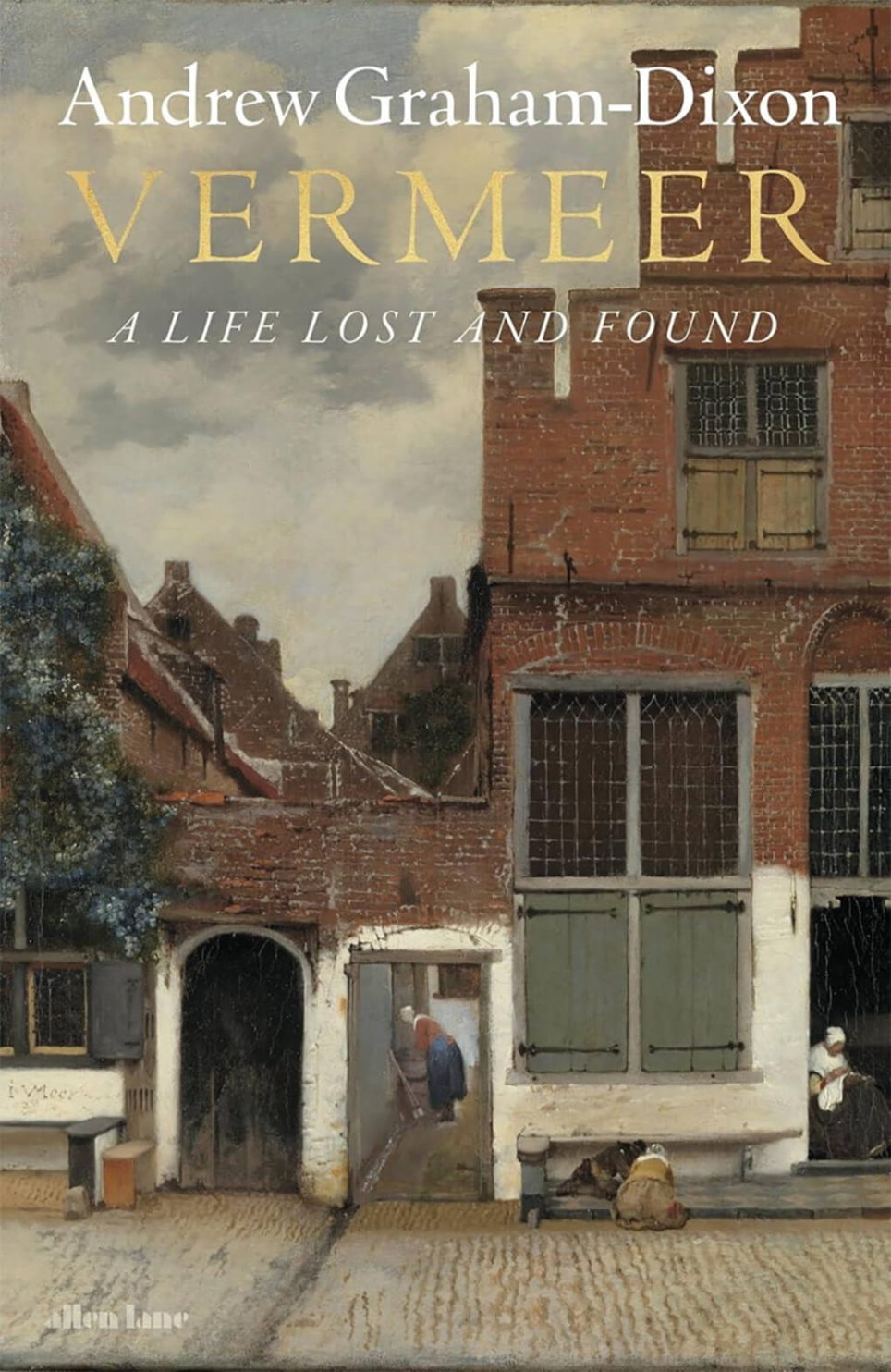
Couverture de « Vermeer: A Life Lost and Found » d’Andrew Graham-Dixon, 2025
Tous trois étaient également membres d’un autre mouvement pro-tolérance et antidogmatique: la « secte » des Collégiants, association fondée par les arminiens qui prônait une libre interprétation de la Bible, et comptait dans ses rangs de nombreuses femmes – un fait inhabituel pour l’époque. Selon le chercheur, les toiles de Vermeer, centrées sur des personnages féminins aux pensées secrètes, servaient à décorer les pièces où se retrouvaient chaque semaine les membres de cette fameuse secte.
Cette piste s’ajoute aux nombreuses autres avancées au fil des siècles. La belle serait-elle la fille de Vermeer, Maria ? Une simple tronie (étude de visage idéalisé) ? Une anonyme qui aurait un lien secret avec l’artiste ? Ce séduisant mystère a inspiré en 1999 un best-seller à la romancière Tracy Chevalier, adapté au cinéma en 2003 par Peter Webber. Dans cette fiction, le modèle est une jeune servante dont le peintre s’est épris, et que le mécène Pieter van Ruijven harcèle sexuellement. Une tout autre vision de ce portrait, décidément sujet à de multiples interprétations et fantasmes !
À lire aussi :
Un autoportrait de Vermeer caché dans une œuvre de New York ?
