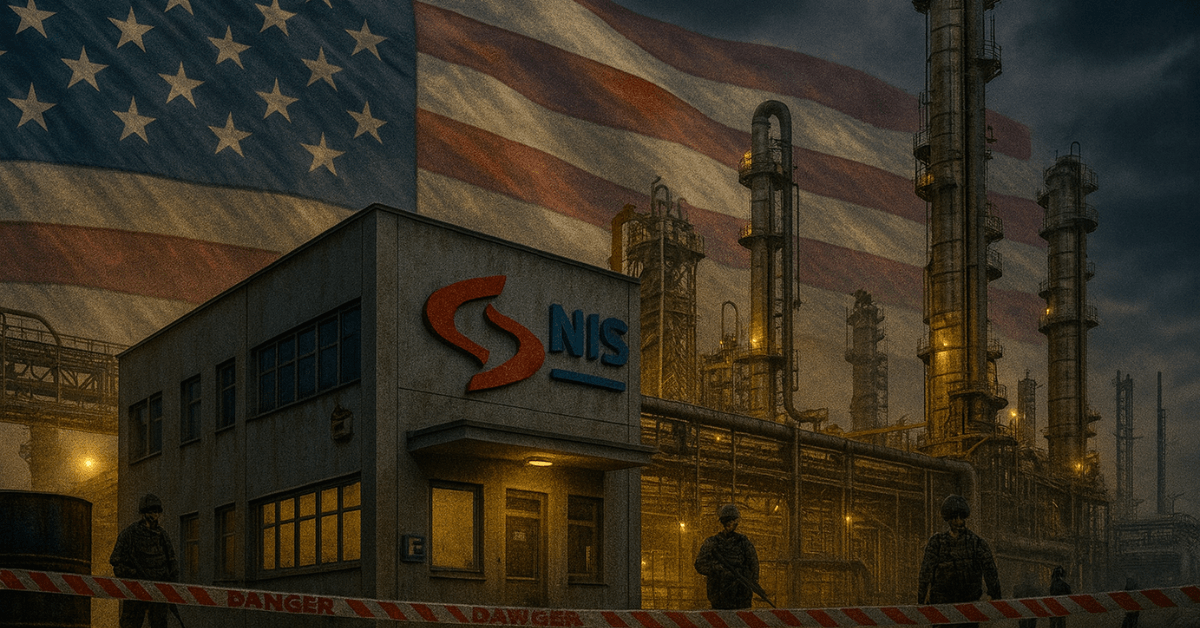![]() Imprimer l’article
Imprimer l’article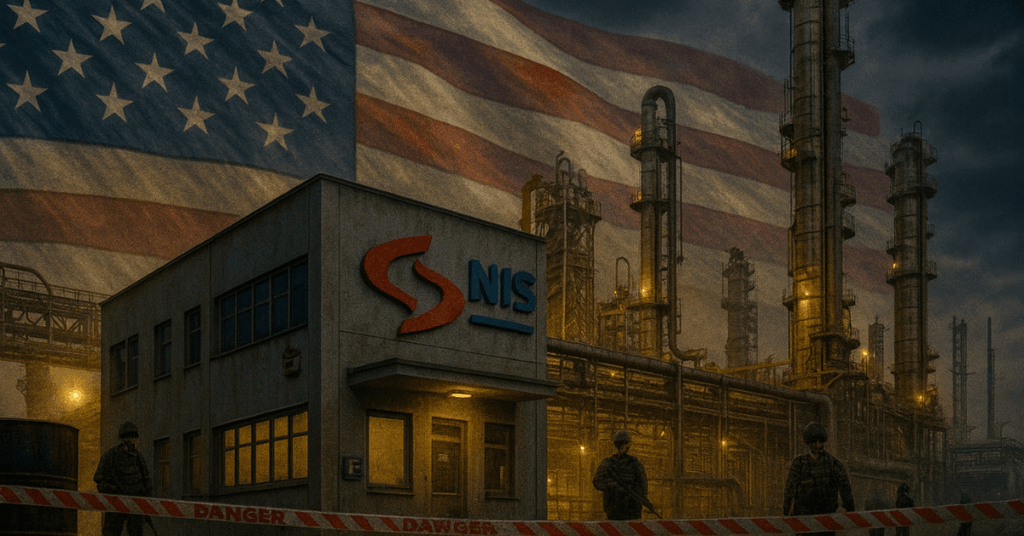 Réalisation Le Lab Le Diplo
Réalisation Le Lab Le Diplo
Par Giuseppe Gagliano, Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)
À lire aussi : ANALYSE – Manifestations et crise politique en Serbie : Analyse et implications internationales
Les sanctions économiques ne sont jamais de simples outils juridiques. Elles sont des armes stratégiques qui redessinent des équilibres géopolitiques entiers. C’est exactement ce qui se joue aujourd’hui dans les Balkans, où Washington a décidé de frapper directement la compagnie pétrolière Naftna Industrija Srbije (NIS), détenue majoritairement par la Russie, en l’excluant de ses circuits commerciaux.
Cette décision, prise le 9 octobre, a immédiatement conduit la Croatie à couper ses livraisons de brut via l’oléoduc JANAF, mettant en péril l’unique raffinerie serbe. Un choc énergétique qui dépasse largement la seule économie nationale.
Un choc énergétique aux conséquences politiques
Pour Aleksandar Vučić, président de la Serbie, le message est clair : le pays entre dans une zone de turbulences qui pourrait affecter toute son économie. Sans approvisionnement régulier, la raffinerie de Pancevo risque de s’arrêter dès début novembre. Cette installation, d’une capacité annuelle de 4,8 millions de tonnes, fournit plus de 80 % des besoins nationaux en diesel et en essence, et 90 % du carburant pour avions. Le choc n’est donc pas sectoriel : il est systémique. Il touche les transports, l’aviation civile, la logistique militaire et les recettes publiques.
Cette situation est d’autant plus sensible que NIS représente près de 12 % des revenus budgétaires de l’État. La dépendance énergétique de la Serbie à la Russie est structurelle : la quasi-totalité de son gaz provient de Moscou. En ciblant NIS, Washington ne frappe donc pas seulement une entreprise mais toute une architecture de dépendance énergétique et politique construite depuis deux décennies.
À lire aussi : Visite de Macron en Serbie, la France tente de se faire une place dans les Balkans
L’énergie, champ de bataille géopolitique
La structure actionnariale de NIS explique l’ampleur de la crise : Gazprom Neft détient 44,9 % de la compagnie, le gouvernement serbe 29,9 %, et une filiale d’investissement de Gazprom environ 11,3 %. Dès janvier, les États-Unis avaient annoncé leur intention de sanctionner NIS, mais des dérogations temporaires avaient retardé l’échéance. Le 9 octobre, cette fenêtre s’est fermée. Et avec elle, c’est tout le système d’importation de brut par le terminal croate de l’Adriatique qui s’est bloqué.
La Croatie, qui par l’intermédiaire de JANAF assurait 30 % de son chiffre d’affaires grâce au contrat avec NIS, a cessé ses livraisons. Ce choix a été interprété comme une réponse coordonnée avec les États-Unis : il ne s’agit pas d’un incident bilatéral, mais d’un geste stratégique visant à couper Belgrade d’un de ses rares poumons énergétiques.
Les alternatives limitées de Belgrade
Officiellement, Belgrade assure disposer de stocks suffisants pour tenir jusqu’à la fin de l’année. Dans les faits, les solutions alternatives sont précaires. L’importation de carburant par barge sur le Danube ou par rail ne compenserait pas les flux perdus via l’oléoduc. Les opérateurs régionaux doutent aussi de pouvoir fournir les volumes nécessaires dans des délais courts.
Le ministre croate de l’Économie, Ante Susnjar, a même proposé que la Croatie rachète NIS pour débloquer la situation. Une offre qui a la valeur d’un ultimatum : soit Belgrade prend ses distances avec Moscou, soit elle assume l’asphyxie progressive de son approvisionnement énergétique.
À lire aussi : ANALYSE – Mouvement étudiant serbe : Causes, développement et effets
L’équation européenne : Alignement ou isolement
Cette crise arrive dans un moment délicat pour Belgrade. La Serbie est officiellement candidate à l’adhésion à l’Union européenne, mais elle a toujours refusé d’appliquer les sanctions occidentales contre la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Elle reste un des rares pays européens à entretenir des liens étroits avec Moscou, notamment dans le secteur gazier.
Les sanctions contre NIS constituent donc un signal clair : l’alignement stratégique devient une condition implicite de rapprochement avec Bruxelles. En d’autres termes, la neutralité énergétique n’est plus tolérée. Pour Washington et Bruxelles, faire plier la Serbie sur ce dossier équivaut à affaiblir un point d’ancrage russe au cœur de l’Europe.
L’énergie comme arme silencieuse
Cette affaire illustre une fois de plus comment, dans la géopolitique contemporaine, l’énergie est devenue une arme silencieuse mais redoutable. Plutôt que d’imposer des contraintes militaires, il suffit de couper les robinets de pétrole et de gaz pour créer une pression politique interne. Le gouvernement serbe, conscient du danger, tente de rassurer sa population et de maintenir la stabilité économique. Mais la dépendance au pétrole russe laisse peu de marges de manœuvre.
La pression pourrait s’accentuer avec la montée des tensions régionales : si l’hiver est rude ou si les flux alternatifs sont insuffisants, Belgrade devra choisir entre l’économie nationale et son partenariat avec Moscou. C’est précisément ce choix que Washington veut forcer.
À lire aussi : ANALYSE – Balkans et Ukraine : Armes, Affaires et Contradictions Géopolitiques
Un nœud stratégique dans les Balkans
Cette crise énergétique dépasse la Serbie. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire l’influence russe dans les Balkans, région historiquement perçue comme une zone tampon stratégique entre les sphères d’influence occidentale et orientale. Contrôler les flux énergétiques, c’est contrôler les dépendances politiques.
Pour la Russie, perdre la Serbie sur le plan énergétique signifierait voir s’éroder l’un de ses derniers leviers sur le continent. Pour les États-Unis, au contraire, cela représenterait un succès stratégique majeur, sans déployer une seule troupe.
Le temps des décisions
La direction de NIS, par la voix de Bojana Radojevic, affirme que les stations-service continueront à fonctionner normalement. Mais cette communication cache mal l’ampleur des défis. Si aucune solution structurelle n’est trouvée, Belgrade devra redéfinir toute sa politique énergétique : diversification accélérée des sources, accords avec de nouveaux partenaires, et peut-être, une prise de distance politique avec Moscou.
En somme, cette crise énergétique agit comme une loupe sur les fractures stratégiques des Balkans : entre fidélité historique à la Russie et ambitions européennes, entre dépendance économique et autonomie politique. Un jeu dangereux où chaque baril de pétrole devient un levier de pouvoir.
À lire aussi : Nikola Mirkovic : « Les États-Unis sont divisés et débordés »
#Serbie, #Russie, #ÉtatsUnis, #Washington, #Balkans, #Énergie, #Pétrole, #Gaz, #Sanctions, #Géopolitique, #NIS, #Gazprom, #NaftnaIndustrijaSrbije, #Croatie, #JANAF, #AleksandarVucic, #UE, #UnionEuropéenne, #Moscou, #Belgrade, #Pancevo, #CriseÉnergétique, #Diplomatie, #RussieEurope, #Trump, #Ukraine, #OTAN, #Hydrocarbures, #StratégieÉnergétique, #Souveraineté, #TransitionÉnergétique, #Puissance, #GuerreÉconomique, #Embargo, #CommerceInternational, #Économie, #SécuritéÉnergétique, #BlocEst, #Occident, #PressionPolitique, #RelationsInternationales,