Guerres en Ukraine et au Proche-Orient, rivalités économiques et technologiques exacerbées entre la Chine et les États-Unis, augmentation des budgets militaires, tensions autour de Taïwan et du nucléaire iranien, cyberattaques contre des infrastructures et relais d’information, massacres de masse à l’est de l’Afrique : face à ce climat géopolitique anxiogène, sommes-nous pour autant à l’aube d’un nouvel ordre mondial ? USA, Russie, Chine, Europe : quelles sont les armes et les faiblesses de chacune des grandes puissances pour pousser ses pions sur l’échiquier international ? Et quelles sont les bonnes raisons de rester optimiste ? Eléments de réponse.
« Les droits de douane annoncés par les USA pourraient coûter 0.25 % de croissance à l’Europe […] tout le monde va perdre à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, mais en 1e lieux les Etats-Unis. L’ordre international et les alliances sont bouleversés, le commerce mutuellement gagnant et la croissance mondiale sont menacés et tout cela accroit partout de l’incertitude économique. Ces mesures protectionnistes marquent aussi le renoncement à un leadership américain et sans doute, le retour à un isolationnisme économique » prévoyait le Gouverneur de la banque de France François Villeroy de Galhau, dans un entretien accordé au Monde en avril 2025. Parallèlement, l’équilibre commercial entre la Chine et les pays émergents vacille, l’expansion industrielle du géant asiatique finissant par saper l’économie de ses proches alliés. En 2024 en effet, l’OMC a reçu un nombre inédit d’enquêtes commerciales pour pratiques de dumping ou subventions illégales (198, soit le double de 2023). Sachant que la moitié d’entre elles provenaient de pays en voie de développement, avec lesquels la Chine entretient officiellement de bonnes relations. On dit l’Europe – cette fédération d’Etats-Nations comme l’appelait Jacques Delors, ce lieu d’échange misant sur l’entente mutuelle pour prospérer – en passe d’être dominée par ces nouveaux empires que sont la Chine de Xi Jinping, l’Amérique de Trump et la Russie de Poutine. Mais l’Union européenne ne serait-elle pas en réalité en position de profiter de cette période tumultueuse pour s’affirmer comme un modèle de référence ? Car on l’oublie trop souvent mais les pays européens pèsent 22 % du PIB mondial et représentent un marché de 450 millions de consommateurs. De fait, l’Europe dispose de nombreux leviers pour s’illustrer comme un pôle de résistance… mais si et seulement si ses membres agissent ensemble en faisait valoir leurs leaderships individuels au service du collectif. Alors que les cartes du monde sont en train d’être redistribuées, faut-il pour autant craindre l’avènement d’un nouvel ordre mondial, voire d’une nouvelle guerre mondiale ?
Les grandes puissances en jeu
Si comme l’explique Frédéric Encel dans son dernier ouvrage, la guerre mondiale n’aura pas lieu, un nouvel ordre mondial est-il en train de se dessiner de façon durable, voire définitive entre des (nouvelles ?) grandes puissances en jeu ?
« Oui un nouvel ordre mondial se met en place, mais rien n’est jamais définitif. On assiste à une recomposition des forces géopolitiques. La montée en puissance de la Chine et les affrontements entre la Chine et les Etats-Unis mettent en cause l’unité du monde occidental et l’existence d’un monde dominé par les pays occidentaux. Mais cette profonde refonte internationale se fait de manière progressive et non brutale. C’est un process long dans lequel on ne peut pas déterminer un avant et un après. Mais il est certain que des interrogations sur l’unité du monde occidental sont posées par la politique de Donald Trump » analyse Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et fondateur d’IRIS Sup’, l’école d’enseignement supérieur de géopolitique appliquée de l’IRIS. De fait, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque puissance dans ce monde en pleine restructuration ?
USA : amis ou ennemis ?
Commençons par les Etats-Unis. Comment cet allié d’hier est-il devenu en quelques mois seulement une menace potentielle pour l’Europe et le reste du monde ? « J’aime les pays d’Europe. J’aime tous ces pays, vraiment, tous différents. Mais l’Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. C’était l’objectif et ils y sont parvenus » avait déclaré Donald Trump en février 2025, brandissant la menace de l’augmentation drastique des droits de douane qu’il allait mettre en œuvre quelques mois plus tard. « Si les pays européens ont alors déclaré leur volonté d’autonomie, l’Union européenne a finalement cédé face aux Etats-Unis en acceptant de faire monter ses dépenses militaires à 5 % du PIB et en acceptant de payer (et non de partager avec les USA) l’aide accordée à l’Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Européens ont peur de Poutine et qu’ils pensent que seuls les Etats-Unis peuvent les protéger face à la menace russe. » Ce qui revient à constater un partage tacite des rôles entre les présidents russe et américain ? « Poutine menace l’Europe et Trump peut ainsi imposer aux Européens des conditions qu’ils n’auraient pas accepté à une autre époque » estime Pascal Boniface.
Pour autant, les Etats-Unis ne se désengagent pas de l’Europe. « Ils utilisent beaucoup l’arme idéologique pour diviser les Européens, détourner leur attention et ainsi leur faire oublier leurs intérêts économiques et surtout financiers. Les Etats-Unis n’aspirent pas à nous convaincre. Ils nous affaiblissent » analyse Nicolas Ravailhe, avocat, spécialiste du droit du marché intérieur européen et enseignant-chercheur à l’Ecole de Guerre Economique. A titre d’exemple,« les revendications de Donald Trump envers l’Ukraine et ses richesses économiques sont éloquentes. Une consultation des investissements directs étrangers en Ukraine depuis des années révèle que les Etats-Unis y sont très présents, même s’ils ne sont pas les seuls : l’Allemagne a initié le mouvement. La décision européenne d’abandonner les droits de douane sur ce qui est produit en Ukraine et importé vers l’Union européenne, en résulte. Et il s’agit là d’une arme de destruction économique massive de l’industrie française. De fait, l’objectif des Etats-Unis est de dépenser moins en Europe, notamment en réduisant la présence de soldats, tout en forçant les Européens à acheter davantage américain pour assurer leur défense. Il ne s’agit pas d’un désengagement américain. La dépendance évolue. Elle devient technologique – les armes vendues aux Européens sont contrôlées par les Etats-Unis, même à distance – au profit d’un rééquilibrage financier en faveur des Américains » ajoute-t-il dans une tribune publiée en juillet 2025.
Europe : l’union fait-elle vraiment la force ?
Au-delà d’une vision géopolitique, adopter une vision géoéconomique s’avère donc essentielle pour comprendre la place, les enjeux, les atouts et les risques encourus par l’Europe dans ce nouvel ordre mondial en construction. « Sur la question européenne, nous sommes trop pollués par des débats politiques qui affectent la lucidité économique. On se positionne toujours pour ou contre l’Union européenne, alors que ce n’est pas le sujet. Concernant les entreprises françaises par exemple, il est essentiel qu’elles s’émancipent de ce débat bipolarisé pour se concentrer sur la question essentielle, à savoir : comment se servir de l’Europe. Halte au fantasme que nous vivons depuis 30 ans : non l’UE n’est pas un moyen de garder cette puissance que la France n’a plus toute seule. L’UE c’est un cadre, des règles communes, un écosystème où celui qui crée la norme, crée le marché. Ce sont des entreprises performantes et conquérantes dans le monde, les meilleures, qui vont rendre l’Europe performante. » Mais alors qu’en est-il de l’autonomie européenne ? La création d’une défense européenne ou d’un marché intérieur européen de la défense a-t-elle vraiment un intérêt ? « Oui si on s’en sert bien, non si la France fait comme d’habitude ! poursuit Nicolas Ravailhe. Nous n’avons pas de vision offensive de conquête et de sécurisation des marchés. Alors même que la priorité de l’Union européenne, drivée par l’Allemagne et les Pays Bas est de sécuriser les excédents commerciaux aux Etats-Unis notamment. Et ce alors même que les Pays-Bas font le contraire de l’Allemagne exportatrice. Ils s’illustrent comme des « complices » des Chinois et des Américains pour importer en Europe et attaquer les entreprises européennes. Ce qui explique l’absence de réaction d’une Europe qui gagne à l’appui de ceux qui exportent et de ceux qui importent. Il s’agit là de deux modèles économiques opposés mais qui engendrent une convergence d’intérêts et font que l’Europe ne veut pas se protéger, optant pour des accords de commerce offensifs, avec comme première arme son droit » explique Nicolas Ravailhe

Impossible donc pour l’Europe de pouvoir prétendre à devenir indépendante des Etats-Unis et s’illustrer comme un vrai pôle de résistance ? « En matière de défense, on ne voit pas de volonté commune émerger en Europe. Tout simplement parce que l’Union européenne ne s’est bâtie que sur une dimension philosophique de puissance économique, et non sur une dimension de puissance globale incluant la politique et la stratégie militaire » rappelle Frédéric Encel. « L’Europe pourrait y parvenir mais estime qu’elle ne le peut pas du fait de la menace russe. Mais cette menace ne devrait pas la pousser à éviter de prendre de la distance face aux Etats-Unis lorsqu’ils mènent une politique trop brutale à son égard. Les Européens sont tétanisés par la crainte de la Russie, mais une population et un marché de 450 millions de personnes peuvent résister aux menaces économiques américaines et à la menace militaire russe » en est convaincu Pascal Boniface.
« Les Chinois sont très forts de notre faiblesse »
Autre puissance incontournable sur l’échiquier mondial : la Chine. « Si son ralentissement démographique s’impose comme une vraie faiblesse pour la Chine, sa vision à long terme s’illustre comme une force. Par ailleurs, la brutalité de Trump à son égard l’a fait apparaitre comme une puissance stable et fiable, un partenaire qui respecte les règles internationales et sur lequel on peut compter. Finalement, on pourrait dire que la politique de Trump qui vise à lutter contre la montée en puissance de la Chine l’a, in fine, facilité » ajoute le directeur de l’IRIS. Preuve en est, le rapprochement (de façade ?) entre ces ennemis historiques que constituent la Chine et l’Inde, lors du dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin. « Donald Trump pense que tout le monde cède à la brutalité : ça a marché un peu avec les Européens, mais pas avec les géants asiatiques qui ne veulent pas se montrer faibles par rapport à la puissance américaine » analyse-t-il.
Ce sommet a d’ailleurs été l’occasion pour le régime de Xi Jinping, de faire une démonstration de force, à grand renfort de défilé militaire à Pékin, censé démontrer la puissance économique, diplomatique et militaire chinoise. Et ce alors même que ce pays agit généralement via des voies non militaires. « La Chine s’inscrit de façon multiséculaire et millénaire dans une projection de son influence et de sa puissance par des voies commerciales, économiques et diplomatiques. Pour autant, son objectif est très clair : redevenir la première puissance mondiale. Avec cette parade militaire hallucinante de septembre dernier, la Chine a voulu nous montrer sa détermination pour tenter de nous faire peur. Les Chinois sont très forts de notre faiblesse » considère Frédéric Encel.
Et les BRICS+ ?
Dans cet objectif, pourra-t-elle profiter de l’appui des partenaires de l’Organisation ou des autres BRICS+, ce groupe de dix pays (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Egypte, Emirats arabes unis, Indonésie et Ethiopie) ayant pour but de rivaliser avec le G7 ? « Qu’on parle de l’Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS+ ou du Sud global, il ne s’agit pas d’alliances mais bien de partenaires qui agissent en commun pour augmenter leur marge de manœuvre. Ils ne souhaitent pas s’inscrire dans une alliance singulière et bilatérale, mais dans un multi alignement leur permettant de développer des partenariats, des relations privilégiées sujet par sujet, afin de ne plus avoir à accepter que les Etats-Unis gèrent seuls l’agenda international » constate Pascal Boniface. « La cohésion et les moyens économiques mis en commun par ces Etats sont bien trop faibles. L’état de guerre technique qui règne entre certaines de leurs puissances principales et l’affaiblissement considérable de plusieurs de ses Etats (Afrique du Sud et Ethiopie, notamment) font qu’en termes de nouveau pôles de puissance, il ne s’agit pas d’un acteur sérieux » ajoute Frédéric Encel.
Oui la voix de la France est encore audible… mais moins
Et au milieu de toutes ces grandes puissances, la France a-t-elle encore les moyens de s’illustrer en irréductible gauloise ? Parmi ses atouts : la diversification de son tissu industriel et des géants industriels nationaux dans tous les secteurs, qui lui permettent d’être polyvalente et résiliente en temps de crise. C’est aussi une nation innovante qui maîtrise des technologies clés et qui dispose d’une main d’œuvre très bien formée, très qualifiée (mais qui coûte cher) et qui témoigne de sa volonté d’investir dans des domaines stratégiques, comme l’énergie, l’IA ou le quantique, pour ce citez qu’eux.

Obstacle de taille toutefois : « la France n’a pas de stratégie offensive en matière géoéconomique dans le marché intérieur européen. Rien ne changera tant que Paris ne remettra pas en cause les déséquilibres économiques en matière civile dans le marché intérieur européen, à savoir une France en déficit des échanges commerciaux face aux autres États en excédents. Dans sa relation avec les autres États européens, la France devrait faire compenser ses déficits en matière civile par des acquisitions des autres États européens de matériels militaires fabriqués en France comme le font les Etats-Unis. S’il ne s’agit pas d’une logique de Frexit, un rapport de force est nécessaire en vue d’une renégociation au sein de l’UE pour rééquilibrer un déficit commercial abyssal. La France s’endette pour servir les succès économiques de ses partenaires européens. Ce n’est plus tenable pour notre pacte social. Nos partenaires et concurrents européens doivent l’entendre et acheter ce que nous produisons, des matériels de défense » précise Nicolas Ravailhe dans une tribune publiée en juillet 2025. « Même si je suis partisan de la pluridisciplinarité, il faudrait peut-être enseigner un peu moins la géopolitique et introduire un peu plus de géoéconomie en France. Une discipline qui permet de définir des stratégies d’innovation technologiques appuyées par des stratégies politiques, du droit positif, des financement publics mais aussi privés. La France doit créer une symbiose plus forte entre opérateurs économiques publics et privés et il faudrait que ces opérateurs privés soient plus stratèges dans ce qu’ils demandent à l’Etat. Je le rappelle, nous ne sommes pas un pays qui dépense trop, mais un pays qui dépense mal et qui ne gagne pas assez. Nous n’avons pas compris le marché intérieur européen : le rôle de l’Union européenne c’est d’aider les meilleurs à réussir, et la France a beaucoup de qualités non mobilisées » estime Nicolas Ravailhe.
Outre cet aspect économique absolument central, la voix de la France est-elle encore audible et crédible au niveau diplomatique ? « Prenons notre relation avec l’Allemagne : si la France y est desservie par rapport à l’état de son économie, elle reste une puissance nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Pour autant, on perçoit un relatif déclin : oui la voix de la France continue de compter, mais elle compte moins qu’avant. Sa recherche de cohérence au sein de l’Union européenne a conduit la France à être moins originale. Elle est entrée dans le rang alors qu’elle était un pays qui se distinguait par une position plus forte et plus singulière (sur le conflit Israélo-palestinien par exemple). La recherche de cohérence européenne et la montée en puissance des autres nations relativisent la puissance française » analyse Pascal Boniface. « La France est le pays le plus en pointe dans la volonté d’accéder à ce qui me parait fondamental pour ne pas disparaitre du radar des puissances et garder son destin en main : une Europe puissante. Mais ça ne suffit pas ! La montée des populismes européo-sceptiques est une épée de Damoclès qui pèse sur une Europe puissante. Si dans les années 50, le moteur de la création d’une Europe économique était franco-allemand, je pense que la constitution d’une Europe puissante sur le plan politico-militaire passe aujourd’hui par un tandem franco-britannique, les deux seules puissances globales européennes qui se présentent comme telles et qui en ont encore les moyens » pondère Frédéric Encel.
Mais alors qui gagne la partie mondiale ?
Si en géopolitique rien n’est jamais définitif, de grandes tendances semblent donc se dessiner pour les prochaines années. « La Russie va gagner des territoires mais le prix de la guerre à payer va peser lourd sur son avenir. La Chine bénéficie et va bénéficier du caractère brutal, impétueux et court-termiste de Trump. Quant à l’Union européenne elle sera perdante si sa timidité persiste vis-à-vis des Etats-Unis » résume Pascal Boniface. Un point de vue partagé par Frédéric Encel. « Soit l’Europe parvient très vite à démontrer, à tout le moins, une réponse politico-identitaire commune à même de lui faire poursuivre des objectifs cohérents et ambitieux avec en fer de lance un tandem franco-britannique très soudé, soit elle disparaitra du radar des grandes puissances et ne pourra plus garantir la sauvegarde de ses intérêts et de ses valeurs. » Il considère par ailleurs que « les Etats-Unis vont rester de loin la première puissance mondiale, même si la Chine s’affirme comme une nouvelle grande puissance, en dépit de problèmes structurels gravissimes. Je crois aussi beaucoup à la montée en puissance de l’Inde et du Vietnam (qui suivent la trajectoire chinoise des années 80/90), du Maroc et du Rwanda. L’Australie et le Canada, s’ils le souhaitaient, pourraient aussi devenir d’authentiques puissances globales. Et ce pour plusieurs raisons : un très haut niveau d’ingénierie, des ressources énergétiques quasi inépuisables, des espaces maritimes importants (sachant que l’avenir énergétique de la planète passe par les mers), et l’absence d’ennemis directs à leurs frontières » conclut-il.
Apprendre la géopolitique à l’école ce n’est pas un +, c’est un must have
Vous l’avez compris, impossible donc d’évoluer dans ce nouvel écosystème mondial sans en comprendre les enjeux. Et pour comprendre, il n’y a rien de mieux qu’appendre ! Si la géopolitique a fait son apparition au lycée avec la réforme du bac, elle est depuis une des spécialités les plus plébiscitées. Et à raison.
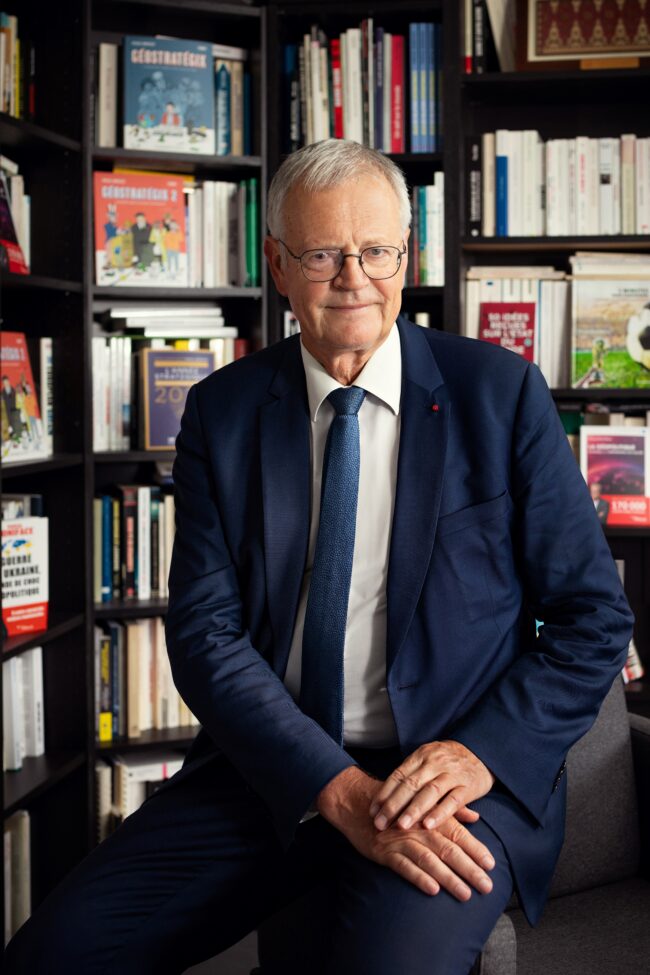
Mais ça n’a pas toujours été le cas. « Il est certain que lorsque j’ai commencé la géopolitique dans les années 80, elle était perçue comme une matière austère réservée à des spécialistes. Et il faut reconnaitre qu’en dehors du 7e arrondissement de Paris, on s’y intéressait peu. Mais aujourd’hui elle a conquis le grand public qui a compris que, dans un monde aussi globalisé, on ne pouvait plus parler d’affaires étrangères au sens classique du terme, tant les conflits internationaux ont des répercussions directes sur le national » se rappelle Pascal Boniface. Preuve de cet engouement, les réseaux sociaux se sont à leur tour emparés de ces questions et le directeur de l’IRIS fait d’ailleurs partie des géopolitologues les plus suivis sur TikTok. Mais la popularisation de cette discipline autrefois réservée à quelques initiés ne serait-elle pas à même de la dévoyer ? « On peut très bien simplifier sans simplification. Penser que la géopolitique ce sont des mots compliqués et un savoir détenu par une poignée d’experts, c’est se tromper. C’est au contraire un enjeu citoyen auquel tout le monde doit avoir accès. Avec mes ouvrages Géostrategix ou La géopolitique, 50 fiches pour comprendre l’actualité, je permets, aux étudiants notamment, de se doter d’un socle de compétences de base… ce qui ne les empêche pas bien sûr d’aller plus loin. D’autant que tous les professeurs d’histoire-géographie que je rencontre sont unanimes : l’introduction de la géopolitique a modifié leur relation avec leurs élèves. Ça les passionne, ça suscite plus de débat et d’interrogations et ça a remis l’enseignant en position de personne ressource. »
Géopolitique ET business
Un engouement qui ne s’arrête pas au lycée. De nombreuses grandes écoles de commerce se sont en effet emparées du sujet, mettant en exergue le lien de plus en plus prégnant existant entre géopolitique et business. C’est notamment le cas de l’ESSEC qui a inauguré son Institut Géopolitique & Business cette année, et qui bénéficie d’ailleurs d’une certaine antériorité sur le sujet. « Ça fait 30 ans qu’on a introduit la géopolitique dans nos formations et nous avons aujourd’hui trois filières en lien avec ces enjeux, tient en effet à rappeler Aurélien Colson, co-directeur académique de l’Institut. Quand j’ai lancé la filière consacrée aux enjeux de défense en 2020 (soit avant le conflit en Ukraine), certains de mes collègues ont pu être sceptiques : c’était du jamais vu dans une école de commerce. Mais aujourd’hui c’est une de nos filières qui a le plus de succès. Il faut dire qu’elle offre des expériences assez inédites. Nous avons notamment noué un partenariat avec le porte-avion Charles de Gaulle, qui permet à nos étudiants d’aller visiter le bâtiment et à des officiers de suivre, à l’ESSEC, des cours ou des briefings en géopolitique. » Parallèlement, l’école forme chaque année à la négociation internationale l’ensemble des diplomates recrutés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que des hauts responsables de la Commission européenne. « On ne peut plus concevoir la vie économique sans regarder de près l’impact des soubresauts géopolitiques sur nos entreprises. Notre mission c’est de former des dirigeants d’entreprise geopolitics proof, résilients et vigilants face à ces impacts. » Cela se traduit en quatre axes : la recherche bien sûr (avec un groupe de 25 enseignants-chercheurs), des réflexions avec des responsables d’entreprise en mode think tank, la formation initiale avec de nouveaux cours concentrés sur cette connexion entre géopolitique et business, et la formation executive. « Cet engouement global pour la géopolitique me rassure, notamment quant à la lucidité de nos étudiants sur le désordre du monde et à leur envie d’être équipés des outils et savoir-faire qui les aideront, en tant que responsables d’entreprise, à avoir cette vigilance et cette résilience face aux chocs » conclut Aurélien Colson.
