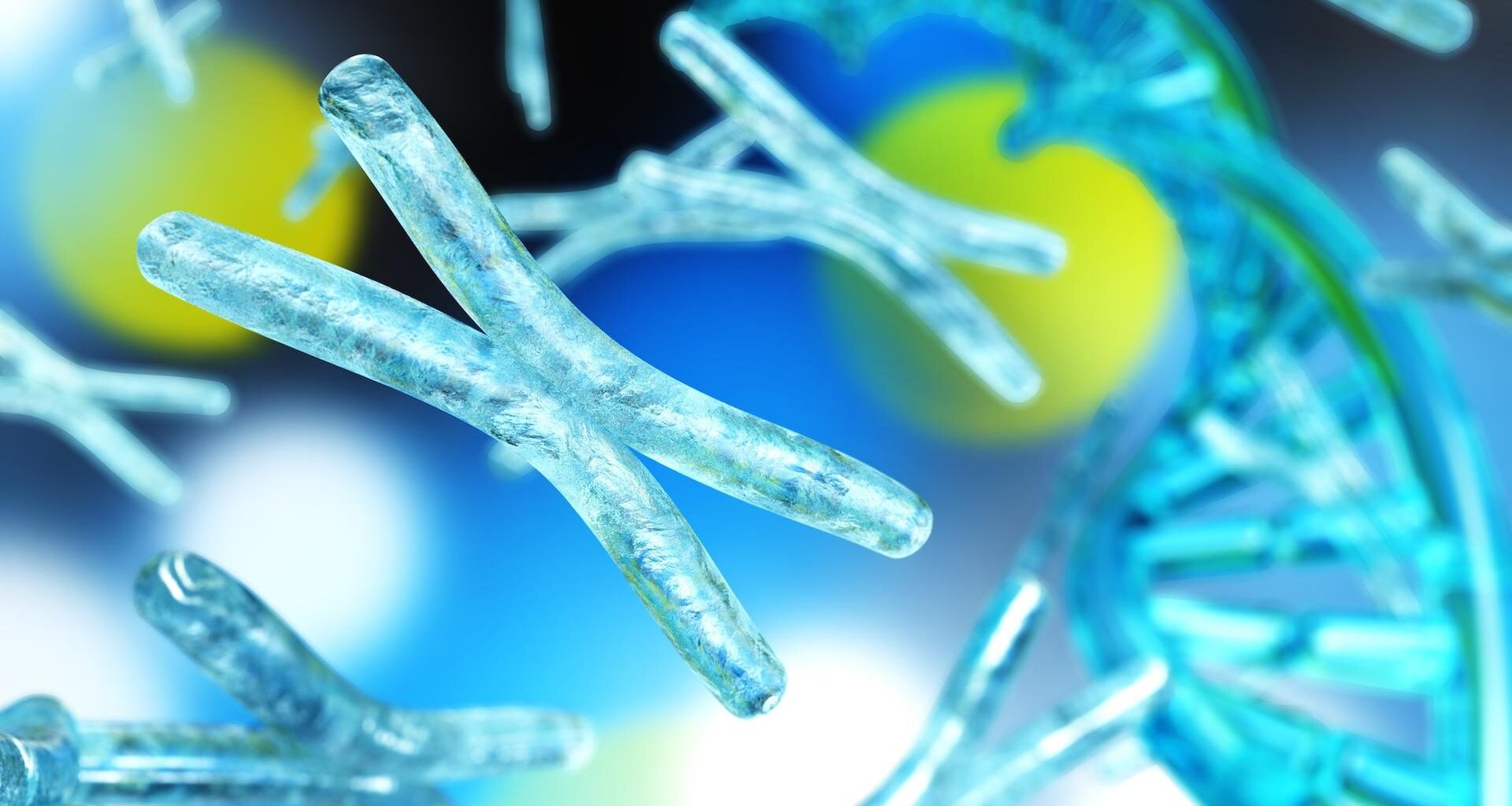Les femmes sont deux à trois fois plus touchées que les hommes par des maladies comme la sclérose en plaques ou Alzheimer. Depuis longtemps, la science observe cette inégalité sans parvenir à l’expliquer complètement. Les hormones ? Le mode de vie ? Le hasard biologique ?
Une étude récente publiée dans Science Translational Medicine par des chercheurs de l’Ucla Health, le 14 octobre 2025, vient lever une partie du mystère. Les chercheurs pointent du doigt un gène situé sur le chromosome X, qui pourrait bien jouer un rôle clé dans cette vulnérabilité féminine.
Un gène du chromosome X qui enflamme le cerveau
L’équipe dirigée par la neurologue Dr Rhonda Voskuhl s’est intéressée à un gène nommé Kdm6a, présent sur le chromosome X. Ce gène influence l’activité des microglies, les cellules immunitaires du cerveau chargées de le protéger. Lorsqu’elles s’emballent, elles déclenchent une inflammation chronique susceptible d’endommager les neurones.
Chez les femmes, qui possèdent deux chromosomes X, l’activité du gène Kdm6a est naturellement plus importante que chez les hommes. Ce « double effet X » entraîne une production accrue de molécules inflammatoires. En d’autres termes, le cerveau féminin reçoit deux fois plus de signaux pro-inflammatoires, ce qui le rend plus vulnérable aux maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer.
« Cela concorde avec l’idée que les femmes ont plus de cellules à bloquer en raison de la présence de deux copies du gène lié à l’X », précise le Dr Rhonda Voskuhl.
Dans leurs expériences sur des souris, les chercheurs ont montré que désactiver le gène Kdm6a permettait de réduire les signes de type sclérose en plaques et de calmer cette inflammation cérébrale.
Un médicament du diabète comme espoir de traitement
Pour aller plus loin, l’équipe de l’Ucla a utilisé un médicament bien connu : la metformine, prescrite depuis des décennies pour traiter le diabète. Cette molécule a la capacité de bloquer la protéine produite par Kdm6a et ainsi de freiner la réaction inflammatoire.
Les résultats sont encourageants : la metformine a atténué l’inflammation cérébrale et amélioré les symptômes chez les souris femelles, tandis que les mâles n’en ont presque pas bénéficié.
Ce constat souligne l’importance de prendre en compte les différences biologiques entre les sexes dans les recherches et essais cliniques, un domaine où la médecine reste encore trop « neutre ».
Quand les hormones perdent leur rôle protecteur
Selon le Dr Voskuhl, les œstrogènes permettent normalement de compenser l’inflammation provoquée par le chromosome X. Mais à la ménopause, la chute de ces hormones fait disparaître cette protection, laissant l’inflammation s’installer. Ce déséquilibre pourrait expliquer à la fois la hausse du risque de maladies neurodégénératives et le « brouillard cérébral » souvent rapporté par les femmes à cette période de la vie.
Ces travaux ouvrent une piste prometteuse pour mieux comprendre le rôle des gènes et des hormones dans la santé cérébrale des femmes. Si la metformine a montré des effets encourageants chez les souris femelles, des recherches complémentaires seront nécessaires avant d’envisager une application chez l’être humain.