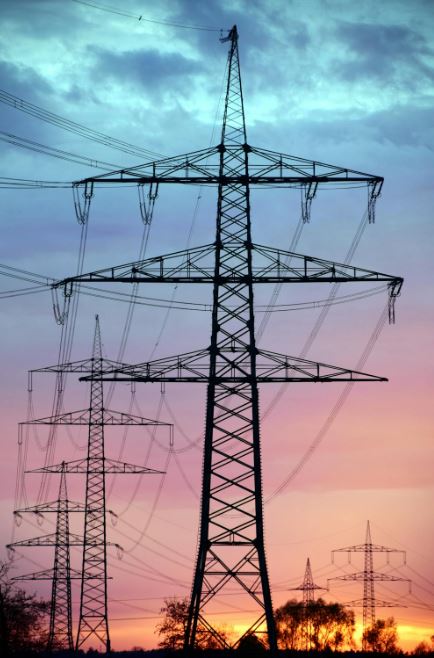« L’énergie n’est plus une ressource. Aujourd’hui, c’est une arme. Et l’Europe n’a plus la mainmise sur la gâchette. »
L’Europe est définitivement entrée dans une zone de fragilité énergétique, non plus temporaire, mais structurelle. Son image de puissance organisatrice mondiale s’effondre face à une réalité brutale : elle dépend de décisions extérieures pour s’éclairer. Des décennies de pari sur l’énergie étrangère (gaz russe bon marché, nucléaire français vieillissant, pétrole arabe restreint et énergies renouvelables toujours insuffisantes) ont créé la tempête parfaite. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de prix ou d’inflation. Il s’agit d’une perte stratégique de souveraineté. Pour la première fois depuis l’après-guerre, l’Europe ne prend pas en main son destin énergétique. Elle réagit, elle ne décide pas. Et le risque n’est pas une panne technique, mais géopolitique.
1. L’Europe entre dans une phase de vulnérabilité énergétique ouverte
Avant la guerre, l’Europe consommait plus de 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par an, soit 45 % de son approvisionnement total. En 2024, ce chiffre était tombé à moins de 25 milliards, non pas parce qu’elle n’en avait plus besoin, mais parce qu’elle avait été contrainte de le remplacer en payant trois fois plus cher le GNL américain, à plus de 50 dollars le MWh, contre 15 dollars pour le gaz russe livré par gazoduc. Il ne s’agissait pas d’un ajustement économique, mais d’un effondrement stratégique instantané. Privé de sa propre énergie, le continent a découvert que son autonomie n’était qu’un mirage, entretenu par la géographie, et non par la souveraineté.
La France tire 63 % de son électricité du nucléaire, mais 28 de ses 56 réacteurs ont présenté des signes de corrosion ou de fissures dans des systèmes critiques en 2023. L’Allemagne, après la fermeture de ses dernières centrales nucléaires, a dû importer de l’énergie en pleine crise. La demande industrielle européenne en gaz n’a pas diminué ; elle a simplement été délocalisée. Plus de 90 milliards de dollars US d’investissements dans les industries de la chimie, de l’acier et des engrais ont migré ou migrent vers les États-Unis et l’Asie entre 2023 et 2025 pour des raisons purement énergétiques.
Le coup symbolique a été le retour au charbon. L’Europe a brûlé 30 % de charbon de plus en 2023 qu’en 2020, remettant en marche des centrales qui avaient été fermées en grande pompe. L’Allemagne, à elle seule, a augmenté sa consommation de charbon de 11 millions de tonnes supplémentaires. Le continent qui se présentait comme un leader climatique est soudain devenu otage énergétique. Il ne s’agit pas d’un problème technique ou passager. C’est le début du black-out géopolitique européen.
2. L’Allemagne à ses limites et les usines du monde entier sont à court de moteurs
Avant la coupure de gaz russe, 55 % de l’énergie industrielle allemande provenait directement du gaz naturel, à un coût moyen de 12 dollars par MWh. Aujourd’hui, ce même coût dépasse 38 dollars par MWh, même avec les subventions publiques, et en 2022, il a atteint des pics à 300 dollars sur le marché spot, entraînant la fermeture de lignes entières. Le résultat a été immédiat : BASF a annoncé la fermeture progressive de son usine de Ludwigshafen (19 000 emplois directs) et a transféré 10 milliards de dollars d’investissements en Chine.
L’industrie automobile, qui représente 13 % du PIB allemand et plus de 800 000 emplois directs, atteint les limites de sa rentabilité. Volkswagen a publiquement reconnu en septembre 2024 que la production d’un véhicule électrique en Chine coûte 35 % de moins qu’en Allemagne. Mercedes et BMW envisagent de délocaliser une partie de leur chaîne de production aux États-Unis, où Washington offre des subventions IRA pouvant atteindre 7 500 dollars par véhicule électrique produit.
L’hydrogène vert (promis comme solution stratégique) a échoué dès sa phase initiale. Produire un kilo d’hydrogène en Allemagne coûte aujourd’hui en moyenne entre 6 et 8 dollars américains, tandis qu’en Arabie saoudite et au Chili, le coût prévu d’ici 2026 est de 1,2 à 2,5 dollars américains. La Chine et l’Inde produisent déjà de l’acier et des batteries avec une énergie moins chère. L’Allemagne, qui fut pendant un demi-siècle l’usine de la planète, paie désormais plus cher sa propre énergie que ce qu’elle gagne à l’exportation. Le déficit silencieux a déjà commencé.
3. France, Italie, Espagne : un modèle énergétique fragmenté et non coordonné
La France possède toujours l’énergie nucléaire, mais la réalité est critique. 63 % de son électricité provient de 56 réacteurs, dont 28 ont dû être fermés ou limités d’ici 2023 en raison de la corrosion et de défaillances structurelles. La centrale nucléaire française, qui exportait auparavant plus de 50 TWh par an, a fini par importer de l’énergie d’Allemagne et d’Espagne en plein hiver. Son nouveau réacteur phare de Flamanville (promis en 2012), qui devait coûter 4 milliards de dollars, dépasse aujourd’hui les 15 milliards de dollars, bien qu’il ne soit pas opérationnel.
L’Italie vit dans une dépendance absolue. 95 % de sa consommation de gaz est importée et, après sa rupture avec la Russie, elle dépend désormais fortement de l’Algérie et de l’Azerbaïdjan. En 2024, elle a signé des contrats d’une valeur de 13 milliards de dollars avec la compagnie algérienne Sonatrach, mais les infrastructures sont instables et soumises aux pressions politiques de l’Afrique du Nord. Rome ne contrôle ni les prix ni les flux. Elle est sous séquestre énergétique.
L’Espagne est le cas le plus contradictoire. En 2024, elle est devenue le deuxième exportateur d’électricité d’Europe, grâce à son mix énergétique composé à 46 % d’énergies renouvelables. Elle a exporté plus de 20 TWh vers la France, mais a simultanément importé pour plus de 60 milliards de dollars de produits industriels fabriqués avec une énergie bon marché hors du continent. Elle possède de l’énergie, mais ne la transforme pas. L’Europe n’est pas fragmentée uniquement par sa stratégie : elle est fracturée par les inégalités énergétiques internes.
4. La Russie, le Qatar, l’Algérie et l’Arabie saoudite prennent le contrôle des flux énergétiques
La Russie a perdu des clients en Europe, mais pas son électricité. Elle a redirigé plus de 80 milliards de mètres cubes de gaz vers la Chine, l’Inde et la Turquie, et a signé avec Pékin le gazoduc « Power of Siberia II », qui garantira des ventes de plus de 400 milliards de dollars sur 30 ans. Poutine n’a plus qu’à déplacer des vannes, pas des réservoirs, et le gaz est déjà une arme de guerre. En 2022, la réduction de 70 % du débit de Nord Stream a suffi à propulser l’inflation énergétique européenne à son plus haut niveau depuis 40 ans. Il ne s’agissait pas d’une attaque militaire, mais d’un rappel de la dépendance.
Le Qatar, propriétaire de 20 % des réserves mondiales de gaz, a décidé de doubler sa production de GNL et a déjà signé des contrats de 27 ans avec la France, l’Allemagne et la Chine. Personne ne pourra le remplacer avant 2030. L’Arabie saoudite contrôle 11 millions de barils par jour et opère aux côtés de la Russie au sein d’une OPEP+ qui n’a plus de comptes à rendre à Washington. En 2023, elle a ignoré la pression de la Maison Blanche et a réduit sa production de 1,3 million de barils par jour afin de maintenir le prix du brut au-dessus de 85 dollars.
L’Algérie s’impose comme un acteur incontournable en Méditerranée. En 2024, elle a signé des contrats avec l’Italie pour un montant de 13 milliards de dollars, ainsi qu’un accord stratégique avec l’Allemagne pour exporter de l’hydrogène vert à partir de 2027. Mais l’Algérie obéit à sa propre logique, et non à celle de Bruxelles. Aujourd’hui, quatre capitales (Moscou, Doha, Riyad et Alger) peuvent déstabiliser l’Europe sans même tirer un seul missile. L’énergie ne se vend plus. Elle est utilisée.
5. Les États-Unis deviennent un fournisseur impérial, mais à un coût inabordable
Les relations énergétiques des États-Unis avec l’Europe ne sont pas commerciales. Elles sont géopolitiques. En 2021, l’Europe payait en moyenne 15 dollars par MWh pour le gaz russe de Nord Stream. En 2023, elle a dépassé les 50 dollars par MWh pour le gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Dans un moment de panique, le prix spot a dépassé les 300 dollars par MWh. L’écart n’était pas marginal et constituait une véritable taxe de guerre énergétique.
Rien qu’en 2023, les exportations de GNL des États-Unis vers l’Europe ont dépassé les 60 milliards de dollars, et des entreprises comme Cheniere Energy ont multiplié leurs profits. Washington est devenu le premier fournisseur de gaz du continent, supplantant discrètement Moscou. Mais ce remplacement a des conséquences.
Les industries européennes paient jusqu’à quatre fois plus cher leur énergie que leurs concurrentes américaines, ce qui a déjà provoqué une fuite massive des investissements industriels vers le Texas et la Louisiane, où l’électricité est payée 30 dollars par MWh contre 90 dollars en Allemagne.
La Maison Blanche ne vend pas de l’énergie. Elle vend une subordination stratégique. Chaque méthanier arrivant en Europe prouve que le continent a perdu sa capacité à négocier de manière autonome. Le coût ne se mesure pas en euros, mais en obéissance structurelle. L’Europe n’importe plus seulement de l’énergie. Elle importe de la dépendance.
6. Le coup d’État silencieux : la Chine achète de l’énergie bon marché et vend une industrie coûteuse à l’Europe
La Chine paie actuellement les prix de l’énergie les plus bas du système énergétique mondial. Elle importe du gaz russe par gazoduc pour moins de 10 dollars US par MWh, tandis que l’Europe le paie entre 50 et 90 dollars US. L’accord stratégique signé entre Gazprom et CNPC en 2024 garantit à Pékin plus de 98 milliards de mètres cubes de gaz par an à des prix préférentiels pendant trois décennies. Parallèlement, la Chine reçoit du pétrole saoudien à des prix réduits allant jusqu’à 5 dollars US le baril, via des contrats directs, hors dollar. Résultat : la production d’énergie en Chine coûte jusqu’à quatre fois moins cher qu’en Europe.
Forte de cet avantage, la Chine inonde le marché européen de voitures électriques, de batteries, d’acier vert et de machines industrielles. En 2024, les exportations chinoises vers l’Europe ont dépassé 660 milliards de dollars, tandis que l’Europe en a exporté moins de 260 milliards. L’écart se creuse de mois en mois. Et, plus grave encore, l’Europe subventionne sa propre défaite. Les gouvernements européens versent des millions d’aides à leurs industries pour qu’elles puissent faire face aux coûts de l’énergie… et ces mêmes industries achètent des intrants, des machines et des technologies fabriqués en Asie avec une énergie bon marché.
La Chine n’a pas besoin de confrontation. De froids calculs suffisent. Elle achète de l’énergie bon marché et vend une industrie coûteuse. Ce différentiel devient une puissance impériale. Et l’Europe, sans s’en rendre compte, finance l’essor stratégique de son principal concurrent.
7. Projection 2030–2035. L’Europe perd le siècle de l’énergie si elle ne rompt pas l’obéissance atlantique
Si l’Europe maintient sa dépendance actuelle, le continent paiera deux à quatre fois plus cher le gaz et l’électricité que ses concurrents asiatiques d’ici 2030. Avec des prix de gros maintenus au-dessus de 70 dollars par MWh, l’industrie électro-intensive perdra structurellement des marges.
Le résultat est mesurable aujourd’hui et projetable à plus grande échelle. Entre 2026 et 2030, l’Union pourrait perdre jusqu’à 1,5 point de PIB par an en raison des pertes d’investissement et de la baisse de productivité. Le solde commercial industriel avec la Chine dépasse déjà 400 milliards de dollars par an et pourrait atteindre 600 milliards de dollars d’ici 2030 si le déficit énergétique n’est pas comblé.
Dans ce scénario, la capacité de raffinage européenne serait réduite de 15 %, l’acier primaire fermerait entre 15 et 20 millions de tonnes de capacité, et la chimie lourde transférerait plus de 120 milliards de dollars d’investissements vers l’Asie et les États-Unis entre 2026 et 2035. La dépendance absolue n’est pas un chiffre. Il s’agit d’un solde courant négatif durable, financé par une dette coûteuse et un chômage industriel croissant.
Il existe une voie alternative. Elle nécessite une rupture stratégique avec l’obéissance atlantique en matière énergétique et financière. L’Europe devrait obtenir des contrats gaziers et pétroliers directs non dollarisés avec des fournisseurs diversifiés et fixer un prix plafond interne pour l’industrie entre 40 et 50 dollars par MWh pendant la transition. Parallèlement, elle devrait accélérer la mise en place d’une matrice verte à grande échelle et de chaînes locales complètes. Une capacité solaire installée d’au moins 600 GW en 2030 et de 850 à 900 GW en 2035. Une puissance éolienne totale de l’ordre de 350 GW en 2030, dont 110 GW en mer, et de 500 GW en 2035, dont 180 à 200 GW en mer.
Stockage par batterie supérieur à 200 GWh en 2030 et 500 GWh en 2035. Hydrogène vert avec une production nationale annuelle de 10 millions de tonnes d’ici 2030 et de 20 millions de tonnes en 2035, axé sur l’acier, les engrais et le transport lourd. Interconnexions électriques augmentant la capacité transfrontalière de 30 % d’ici 2030 pour acheminer l’excédent d’énergie solaire du sud vers le centre industriel ; et cadres de contenu local reliant les usines de panneaux, de turbines, d’électrolyseurs et de batteries au territoire européen avec des incitations de 50 milliards de dollars par an pendant cinq ans. Le renouveau civilisationnel vert n’est pas un slogan. C’est un budget et une politique industrielle.
La bifurcation 2030-2035 est flagrante. Avec l’obéissance atlantique et une énergie coûteuse, le chômage industriel européen pourrait dépasser les 15 millions d’emplois accumulés au cours de la décennie, et la part de l’industrie manufacturière dans le PIB pourrait tomber sous les 12 %. Avec la souveraineté énergétique et une politique verte financièrement musclée, l’Europe peut soutenir l’approvisionnement énergétique de son industrie entre 45 et 55 dollars par MWh et récupérer un point et demi de productivité annuelle dès 2031. Il ne s’agit pas de choisir un parti politique. Il s’agit de choisir qui fixe le prix de l’électricité qui alimente une usine. L’une des deux voies définit le siècle pour l’Europe. L’autre, c’est la rentabilité.
8. L’Europe face au miroir énergétique du siècle
L’Europe n’est pas confrontée à un risque. Elle est confrontée à une décision. La panne ne sera pas technique, mais politique. Les lumières ne s’éteindront pas sur les fils ; elles s’éteindront dans les centres de pouvoir qui refusent de décider. Si elle reste soumise aux prix fixés par Washington, Riyad ou Pékin, elle deviendra un marché de luxe pour consommateurs endettés, et non une puissance. Ce destin a déjà commencé, mais il n’y a pas de sirènes. Il s’accompagne d’usines silencieuses, d’importations record, d’une jeunesse qui regarde davantage vers Shanghai que vers Bruxelles.
Mais l’avenir n’est pas gagné d’avance. L’Europe dispose encore du capital humain, des infrastructures et de la légitimité historique nécessaires pour lancer une seconde révolution industrielle verte (cette fois souveraine, stratégique et énergétique) si elle décide de rompre avec son obéissance automatique. Installer simplement des énergies renouvelables ne suffit pas. Le prix, la technologie et la chaîne de valeur doivent être maîtrisés. L’énergie n’est pas une marchandise. C’est le sol invisible sur lequel évolue une civilisation. Et nul ne domine l’histoire en foulant le sol d’autrui.
Il est encore possible de faire des choix. Mais l’horloge énergétique ne s’égrène plus en décennies, mais en années.
Références :
- Agence internationale de l’énergie (AIE), Perspectives énergétiques mondiales 2023-2024
- Eurostat, Rapports sur la dépendance énergétique et la balance commerciale 2023-2024
- Banque centrale européenne (BCE), Impact du choc énergétique sur l’industrie européenne
- Commission européenne, Plan industriel Green Deal et loi sur l’industrie zéro émission nette 2024
- FMI, Perspectives de l’économie mondiale – Déséquilibres structurels UE-Chine-États-Unis
- Gazprom/CNPC, accords Power of Siberia I et II, 2023-2024
- Signature de contrats de gazoducs et de GNL entre Sonatrach, Eni et TotalEnergies (2022-2024)
- Bloomberg, EU Industrial Exodus Tracker – Coût de l’énergie 2022-2024
- Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), Projections des coûts solaires et éoliens 2030-2035