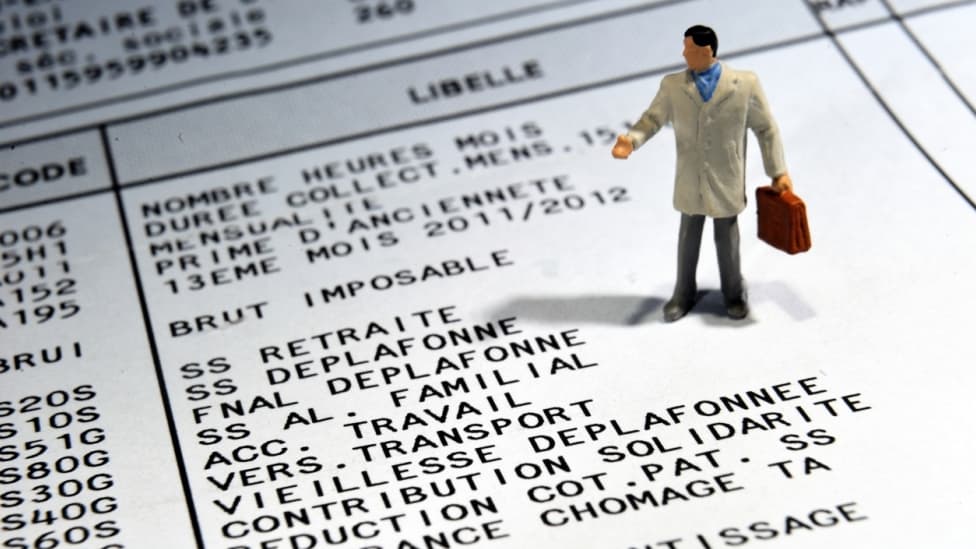Le Medef a lancé il y a quelques jours un simulateur afin d’alerter sur le poids des cotisations sociales sur les salaires en France par rapport à nos voisins. Si l’Hexagone se distingue par des cotisations patronales plus élevées, il ne remporte pas la couronne du pays qui taxe le plus le travail une fois tous les prélèvements pris en compte.
Ce devait être l’occasion pour les patrons de se rassembler et d’exprimer leur mécontentement. Organisé par le Medef pour dénoncer l’alourdissement de la fiscalité sur les entreprises dans le budget 2026, « l’énorme meeting » promis par l’organisation patronale le 13 octobre dernier a finalement été reporté afin de « contribuer à l’apaisement du pays », dans un contexte de crise politique inédite.
Mais la colère des grands patrons qui dénoncent régulièrement le poids des taxes et autres cotisations sur leur activité reste intacte. En témoigne le comparateur lancé il y a quelques jours par le Medef pour rendre compte de l’ampleur du coût du travail supporté par les entreprises tricolores par rapport à leurs homologues européennes.
Un coût du travail plus élevé en France…
À travers cet outil publié sur son site, l’organisation dit vouloir « illustrer une réalité structurelle: le coût du travail en France demeure significativement supérieur à celui observé en Allemagne, en Italie et en Espagne ».
Le Medef met ainsi en avant le cas d’un salarié payé 3.000 euros brut dans les quatre grands pays de l’UE. En France, il touchera 2.370 euros net (comme en Allemagne), mais 2.724 euros en Italie et même 2.806 euros en Espagne. L’écart, ce sont les cotisations salariales.
Mais l’écart le plus flagrant avec nos voisins concerne le « super-brut », le salaire avec les cotisations salariales et patronales. Toujours pour ce « 3.000 euros brut », le patron paiera 3.675 euros en Allemagne, 3.930 euros en Italie, 3.962 euros en Espagne et 4.071 euros en France. Un écart de près de 11% de coût du travail entre la France et le plus compétitif de ses voisins.
Autre exemple, pour verser un salaire net de 2.190 euros qui correspond au salaire médian dans le privé, une entreprise française doit débourser 3.619 euros (« super-brut ») selon la « calculette » du Medef. Une fois les cotisations patronales déduites (881 euros), le salaire brut s’élève à 2.738 euros auquel il faut ensuite retrancher les cotisations salariales (548 euros) pour obtenir le net.
Avec un salaire brut identique, un salarié allemand percevrait légèrement moins qu’un salarié français (2.163 euros net). Le net serait en revanche significativement supérieur en Italie (2.486 euros) et en Espagne (2.561 euros). Dans tous les cas, le coût total pour l’entreprise serait moins élevé chez nos voisins: 3.354 euros en Allemagne (-7,3%), 3.587 euros en Italie (-0,9%) et 3.616 euros en Espagne (-0,1%).
Et les écarts se creusent à mesure que l’on grimpe dans l’échelle des salaires. Prenons un cadre, qui perçoit un salaire brut de 4.000 euros par mois, l’entreprise française doit ainsi payer 5.668 euros, contre 4.900 euros en Allemagne (-13,5%), 5.240 euros en Italie (-7,6%) et 5.283 euros en Espagne (-6,8%).
…sauf sur les bas salaires
Un constat qui fait dire au Medef qu' »avec des prélèvements sociaux équivalents à ceux de ses voisins, la France afficherait des coûts salariaux plus faibles pour les employeurs et des salaires nets plus élevés pour les salariés ».
Le coût du travail sur les bas salaires est en revanche nettement supérieur chez nos voisins. Pour un salaire brut de 1.802 euros correspondant au Smic, une entreprise tricolore déboursera 1.877 euros, contre 2.207 euros en Allemagne (+17,8%), 2.361 euros en Italie (+25,8%) et 2.380 euros en Espagne (+26,8%).
« Cela est lié au fait qu’il y a beaucoup d’allègements de cotisations sur les bas salaires », rappelle François Ecalle, président de Fipeco.
C’est notamment le cas depuis la suppression du CICE en 2019, transformé en baisse de cotisations pour soutenir la compétitivité des entreprises.
Des cotisations sociales rapportées au PIB plus élevées en Allemagne
Au-delà du fait que cet outil ne rend compte que des cotisations sur les salaires du secteur privé, une autre de ses limites est qu’il « ne peut préciser les prestations auxquelles les cotisations ouvrent droit », prévient le Medef.
Or, « beaucoup de dépenses sociales sont mutualisées en France, là où elles sont assumées à titre individuel dans d’autres pays, ce qui explique leur niveau plus faible », reconnaît l’organisation patronale. L’Hexagone se caractérise en effet par une couverture sociale plus vaste, quand une partie plus importante des dépenses de santé ou encore de retraite sont prises en charge à titre privé chez certains de nos voisins.
Résultat, les cotisations sociales représentaient 14,7% du PIB en France en 2024 (428 milliards d’euros), contre 13,1% en moyenne au sein de l’Union européenne, d’après Eurostat. Cet écart vient principalement « des cotisations patronales plus élevées en France », observe François Ecalle, qui rappelle que les cotisations sociales sont payées aux deux tiers par les employeurs dans l’Hexagone, contre 57% en zone euro et 43% outre-Rhin.
Pour autant, si la France était encore en tête en 2018, c’est bien en Allemagne, où les cotisations salariales cette fois sont plus élevées, que les cotisations totales pèsent le plus lourd dans le PIB en Europe (16,4% du PIB). Mais « on serait hors concours s’il n’y avait pas tous ces allègements » sur les bas salaires, tempère encore François Ecalle. En 2023, le manque à gagner des allègements totaux de cotisations pour les comptes sociaux était estimé à 80 milliards d’euros.
Tous prélèvements confondus, la France n’est pas le pays qui taxe le plus le travail
Les cotisations sociales ne représentent d’ailleurs pas l’intégralité des prélèvements qui pèsent sur le travail. Le niveau de salaire qui va dans la poche du salarié dépend par exemple aussi du niveau de l’impôt sur le revenu ou d’autres taxes comme la CSG en France. En tenant compte que tous ces prélèvements, la taxation du travail dans l’Hexagone représentait 22,7% du PIB tricolore en 2023, soit 1,4 point de moins qu’en 2016, selon les chiffres de la Commission européenne relayés par le site Fipeco.
« On est dans le peloton de tête mais on n’est pas ceux qui taxent le plus » si l’on retient cet indicateur, résume François Ecalle. La France est en effet passée de la deuxième place en 2016 à la quatrième place en 2023 des pays européens taxant le plus le travail, derrière le Danemark (23,7% du PIB), la Suède (23,6%) et l’Autriche (23,6%). Elle est revanche devant l’Allemagne (22%) et au-dessus de la moyenne européenne (20%).
Notre pays se distingue encore malgré tout par « le poids des prélèvements dont les employeurs sont redevables (11,9% du PIB) malgré les allègements de cotisations patronales qui ont remplacé le CICE: [la France] est restée au premier rang, comme en 2016, loin devant l’Allemagne (6,8%) et les moyennes de la zone euro (8,2%) et de l’Union européenne (7,9%) », indiquait François Ecalle dans une note publiée sur Fipeco.
Une autre manière d’appréhender la taxation du travail est de regarder le « taux implicite de taxation du travail » qui n’est autre que le rapport entre les prélèvements sur le travail et l’ensemble des revenus du travail. Celui-ci s’élevait selon la Commission européenne à 39,3% du « super-brut » en France en 2023, soit plus que l’Allemagne (36,2%) et que la moyenne de la zone euro (37,5%) mais moins qu’en Italie (44%) ou en Belgique (40%).
L’OCDE observe de son côté le « coin socio-fiscal » pour une catégorie de ménages donnée, c’est-à-dire les prélèvements sociaux et fiscaux qui pèsent sur la rémunération en déduisant les prestations familiales. Pour un célibataire sans enfant percevant un salaire moyen, le taux de prélèvement global (cotisations patronales, salariales, impôts…) était ainsi le plus élevé en Belgique (52,6%), devant l’Allemagne (47,9%) et la France (47,2%).
Les prélèvements des couples percevant un salaire moyen avec deux enfants étaient néanmoins plus élevés en France que chez ses voisins (39.1%, contre 36.9% en Belgique, 36,1% en Espagne, 33.3 en Allemagne…).