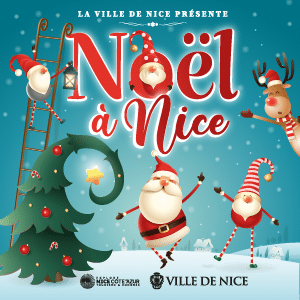La Cour de cassation doit trancher vendredi une question décisive sur l’indemnisation des victimes d’attentats, après avoir été saisie par des parties civiles des dossiers du Bataclan et de la promenade des Anglais, avec à la clé des conséquences financières potentiellement importantes.
Selon la haute juridiction, « Dans deux affaires d’attentats, la Cour de cassation devra dire si une personne dont la qualité de partie civile a été reconnue par la justice pénale doit nécessairement bénéficier de la procédure civile spécifique d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », résume la plus haute instance judiciaire française.
Ces dossiers ont été examinés le 10 octobre en assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, réunie lorsqu’il s’agit de trancher des questions majeures de jurisprudence.
À l’origine de ce débat se trouve le décalage entre l’appréciation des cours d’assises, qui jugent les attentats et admettent souvent largement les constitutions de parties civiles, et celle du juge d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (Jivat), une juridiction spécialisée créée en 2019 et connue pour appliquer des critères plus stricts.
Installé au sein du tribunal judiciaire de Paris, le Jivat est le juge exclusivement compétent en France pour trancher les litiges entre les personnes se considérant comme victimes et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), chargé de verser l’indemnisation financière des préjudices corporels liés à ces actes.
La procédure devant la Cour de cassation résulte du regroupement de deux affaires distinctes, dans lesquelles le FGTI a refusé d’indemniser des personnes pourtant reconnues comme victimes par la justice pénale.
Attentats du Bataclan et de Nice : une décision clé sur l’indemnisation des victimes
Dans le premier dossier, la Cour de cassation est saisie du recours d’une habitante du quartier du Bataclan, la salle de concert parisienne prise pour cible par un commando jihadiste le 13 novembre 2015. Son immeuble, situé face à l’établissement dans l’impasse voisine, a été visé par des tirs qui ont coûté la vie à un résident du premier étage.
Cette riveraine, installée au deuxième étage, a assisté à une partie de l’attaque depuis ses fenêtres avant de se réfugier dans sa salle de bains, sans être physiquement blessée. Admise comme partie civile au procès du 13-Novembre devant la cour d’assises, elle a cependant vu le FGTI puis le Jivat rejeter ses demandes d’indemnisation pour son préjudice psychologique.
Dans le second dossier, la Cour est saisie par deux familles qui se trouvaient à proximité, mais non au cœur de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, lorsque un Tunisien a lancé un camion sur la foule réunie sur la promenade des Anglais, faisant 86 morts et des centaines de blessés.
Elles aussi reconnues comme parties civiles par la cour d’assises, ces familles se trouvaient à environ 200 mètres au-delà du point où le camion a fini sa course meurtrière. Leurs demandes d’indemnisation ont également été rejetées par la juridiction spécialisée.
À l’audience du 10 octobre, le procureur général Rémy Heitz a défendu le maintien de la « totale autonomie » du Jivat afin de « préserver l’efficacité de notre dispositif ambitieux d’indemnisation ».
Selon le plus haut magistrat du parquet, « La solution prônée par les demandeurs constituerait une atteinte importante à cette compétence exclusive dès lors qu’elle permettrait de fait de remettre indirectement en cause devant la juridiction pénale un refus d’indemnisation décidé par le FGTI ».
Au-delà de l’aspect financier, alors que près de 1.500 parties civiles ont été reconnues lors du procès de l’attentat de Nice, la décision de la Cour de cassation devrait contribuer à préciser la définition même de la victime, qui varie aujourd’hui au gré de la jurisprudence.
- Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation doit dire si le statut de partie civile reconnu par la justice pénale ouvre automatiquement droit au dispositif spécifique d’indemnisation des victimes d’attentats. Deux affaires liées au Bataclan et à l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice illustrent les divergences entre le FGTI, le Jivat et les cours d’assises. La décision attendue pourrait avoir un impact financier important et clarifier durablement la définition juridique de la victime d’acte terroriste.
Avec AFP