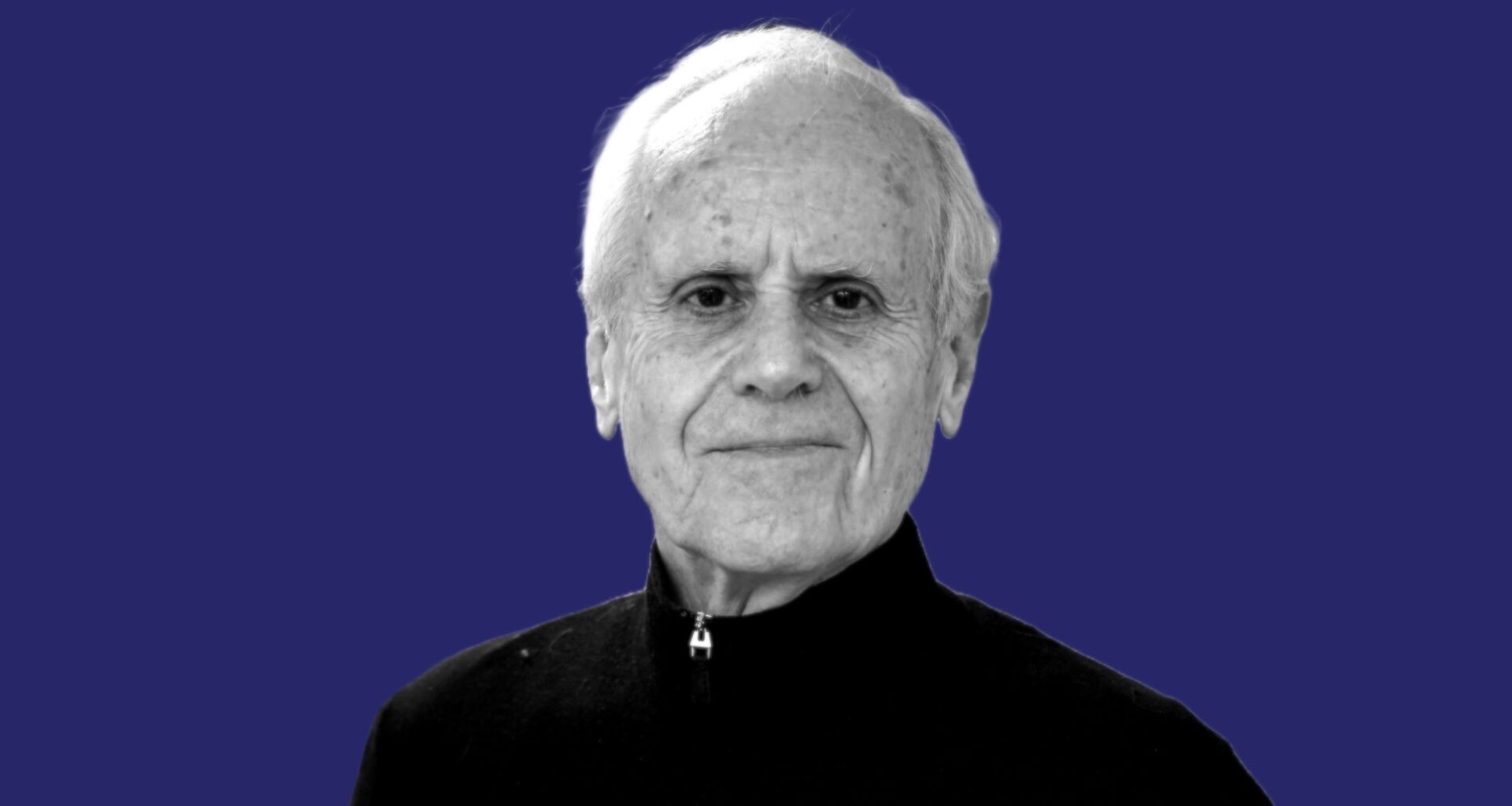Pour les républicains, la dynamique de l’innovation s’organise autour de deux éléments.
Le premier élément repose sur la séquence habituelle : innovation, gains de productivité, croissance, emploi. Par rapport à la période précédente, les droits de douane sont privilégiés pour accroître l’innovation au détriment de la politique industrielle, sans qu’il soit précisé si les deux lois votées en 2022 aux États-Unis, le CHIPS and Science Act et l’Inflation Reduction Act (IRA) seront maintenues, modifiées ou supprimées.
Le second élément est que la dynamique de l’innovation modifie les formes d’interaction entre les agents en faisant émerger une nouvelle culture qui oriente les comportements vers des objectifs légitimés par la société et validés par les élections. Ce processus d’«enculturation » peut être analysé comme une forme d’innovation conduisant à mettre à la disposition des agents économiques de nouvelles ressources culturelles sous forme de règles, de normes et de valeurs (D. Read, D. Lane et S. Van Der Leew, The Innovation Innovation, dans « Complexity Perspectives on Innovation and Social Change », Spinger Verlag, 2007). L’innovation est considérée comme un projet culturel.
Ce processus peut être orienté de deux façons. Négativement, si on subordonne l’innovation à des valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion, le prix à payer est très élevé : désincitation des investisseurs et ralentissement des innovations. Positivement, si se diffusent de nouvelles valeurs centrées sur l’America First, le rejet des élites politiques et la contestation des décisions juridiques concernant la santé (abrogation de la loi sur l’assurance-santé, dite Obamacare), l’énergie (forez, forez, forez !) et la fiscalité (réduction massive des impôts). De ce point de vue, on peut admettre que les crises (santé, pollution, environnement…) sont des sous-produits du projet culturel accompagnant le processus d’innovation. Et cela, quels que soient les coûts potentiels et les dangers pour la société d’un démantèlement des institutions qui constituent des entraves au progrès technologique.
En effet, les réglementations gouvernementales et l’« Etat profond » sont censées créer des problèmes sociaux et entraver le développement rapide des technologies. Les technologies numériques sont les plus décisives, en particulier l’IA : d’objet, elle est devenue agent de la définition de problèmes complexes et de leur résolution. L’IA permettra d’assurer le leadership technologique des Etats-Unis. « Nous abrégerons le dangereux décret de Joe Biden qui entrave l’innovation en matière d’IA et impose des idées de gauche radicale au développement de cette technologie. À la place, les républicains soutiendront le développement de l’IA fondé sur la liberté d’expression et l’épanouissement de l’être humain », d’après le programme républicain.
Pour diffuser cette culture techno-individualiste, il faut abaisser les barrières à l’entrée mentales de la population pour qu’elle adhère à une conception nouvelle du système politique de la société américaine. En filigrane, le projet est double. D’une part, il s’agit de gouverner les façons de penser et, selon la théorie du constitutionnalisme du bien commun, accepter que le gouvernement « aide à orienter les personnes, les associations et la société en général vers le bien commun…une forte autorité en faveur de l’atteinte du bien commun est tout à fait légitime ».
Proposition pour le moins confuse parce qu’il faut distinguer deux niveaux de réflexion. Une grande partie de la population critique les élites politiques et la distance qui s’est creusée avec la société civile dans le traitement de certains problèmes lorsqu’elles mettent l’accent par exemple sur le ralentissement de l’inflation tout en négligeant le niveau élevé des prix des biens de consommation depuis la crise du Covid-19, c’est-à-dire en privilégiant le flux par rapport au stock. De la même façon, une large majorité adhère à la vision semi-autarcique de la nation, synonyme d’une puissance retrouvée. Mais cela ne signifie pas que la majorité de la population adhère au rejet total de l’action publique ni à celle d’un saccage de la nature afin d’accroître la rente pétrolière.
D’autre part, La diffusion d’un nouveau cadre culturel repose sur la fusion entre les géants du numérique et le pouvoir politique. Le projet est de privatiser les politiques gouvernementales qui seraient progressivement façonnées par de puissants intérêts commerciaux. L’exemple le plus frappant est la nomination d’Elon Musk à la tête de la Commission pour l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), ce qui soulève la question du conflit d’intérêt. La défense de ses propres intérêts peut contrarier l’innovation des entreprises de la Tech. En tant que chef du DOGE, puis aujourd’hui conseiller, Elon Musk s’est servi de la Federal Trade Commission pour menacer les entreprises réticentes à faire de la publicité sur sa plateforme X. De plus, avec la création de son robot conversationnel Grok, Elon Musk dénature le capitalisme de marché. D’abord, en pratiquant une stratégie de last mover pour intégrer l’oligopole d’IA en s’appuyant sur des projets commerciaux (Grok est gratuit pour les 500 millions d’utilisateurs mensuels de X). Ensuite en disposant d’un pouvoir politique qu’il peut utiliser pour avantager ses propres entreprises ou pénaliser ses concurrents.
En somme, les techno-libertariens veulent épanouir l’individu par l’IA. Mais la majoration de l’individu par l’outil technologique risque d’aboutir à une homogénéisation asservissante des façons de penser.
(*) Bernard Guilhon est professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille ainsi que professeur à SKEMA Business School. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l’économie de la connaissance et de l’innovation, et publié de nombreux articles sur ce thème.