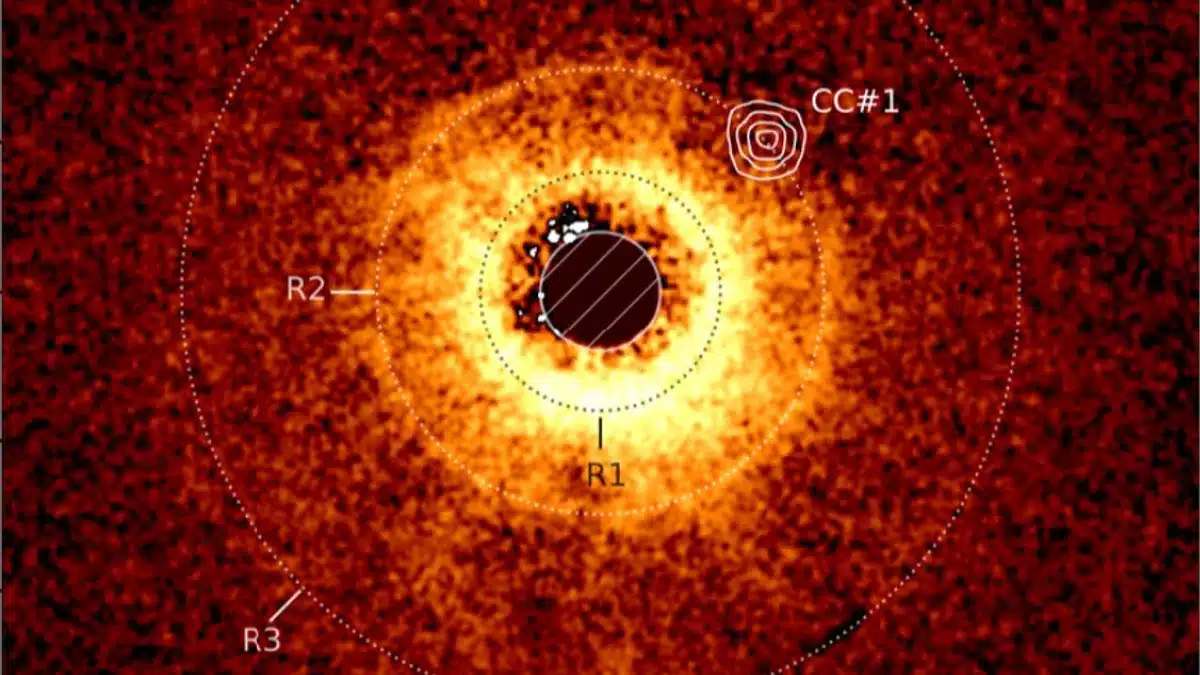C’est une première
mondiale qui éclaire un pan resté longtemps mystérieux de la
formation des systèmes planétaires. Le
télescope spatial James Webb (JWST) a capturé la toute première
image directe d’une exoplanète extrêmement légère, orbitant autour
d’une étoile jeune située à 110 années-lumière de la Terre.
Baptisée TWA 7b, cette géante gazeuse pourrait bien réécrire les
manuels d’astronomie.
Une exoplanète dix fois plus
légère que les précédentes
TWA 7b n’est pas une planète
comme les autres. Cette géante gazeuse, dont la masse est estimée à
environ 30 % de celle de Jupiter, est la planète la plus légère
jamais détectée par imagerie directe. Jusqu’à présent, les
instruments astronomiques ne permettaient de « voir » que
des exoplanètes massives, capables de résister à l’éblouissement de
leurs étoiles hôtes.
Mais TWA 7b, bien qu’à peine
plus massive que Saturne, a été photographiée grâce à la
sensibilité extrême du JWST dans l’infrarouge moyen, et à un outil
clé embarqué à bord : le coronographe de l’instrument MIRI
(Mid-InfraRed Instrument). Ce dispositif masque la lumière
aveuglante de l’étoile pour laisser apparaître des objets plus
faibles en orbite, comme les planètes.
Un monde jeune, encore
incandescent
TWA 7b évolue dans un système
stellaire nommé TWA 7, situé dans la constellation de l’Hydre.
L’étoile centrale n’a que 6 à 7 millions d’années, un âge
extrêmement jeune à l’échelle cosmique. Sa planète n’a donc pas
encore eu le temps de refroidir. Elle brille toujours de la chaleur
résiduelle de sa formation, ce qui la rend visible dans
l’infrarouge.
Autre fait remarquable : TWA
7b orbite à 52 unités astronomiques de son étoile (soit 52 fois la
distance entre la Terre et le Soleil), à l’intérieur d’un anneau de
débris poussiéreux et rocheux. C’est précisément sa position dans
cet anneau qui intrigue les chercheurs.
La première planète
« bergère » enfin observée
Depuis longtemps, les
astronomes soupçonnent que certaines planètes jouent un rôle de
« bergères » : elles sculptent les anneaux de débris en
créant des lacunes, à la manière des lunes bergères de Saturne.
Jusqu’à présent, ce rôle n’avait jamais été observé directement
chez une exoplanète.
TWA 7b change la donne. La
planète se trouve au cœur d’une ouverture nette dans un anneau
étroit de poussière, flanquée de deux bandes vides. Ce
positionnement indique fortement qu’elle a modelé son
environnement, confirmant ainsi pour la première fois le rôle actif
des planètes dans la structure des disques circumstellaires.
« Cela nous montre que les
planètes peuvent bien creuser des trous dans les disques, comme on
le supposait », explique l’astronome Anne-Marie Lagrange,
directrice de recherche au CNRS et première autrice de l’étude,
publiée dans Nature le 25 juin 2025. « C’est aussi une
première preuve directe que des structures de type troyen peuvent
exister dans des systèmes exoplanétaires. »
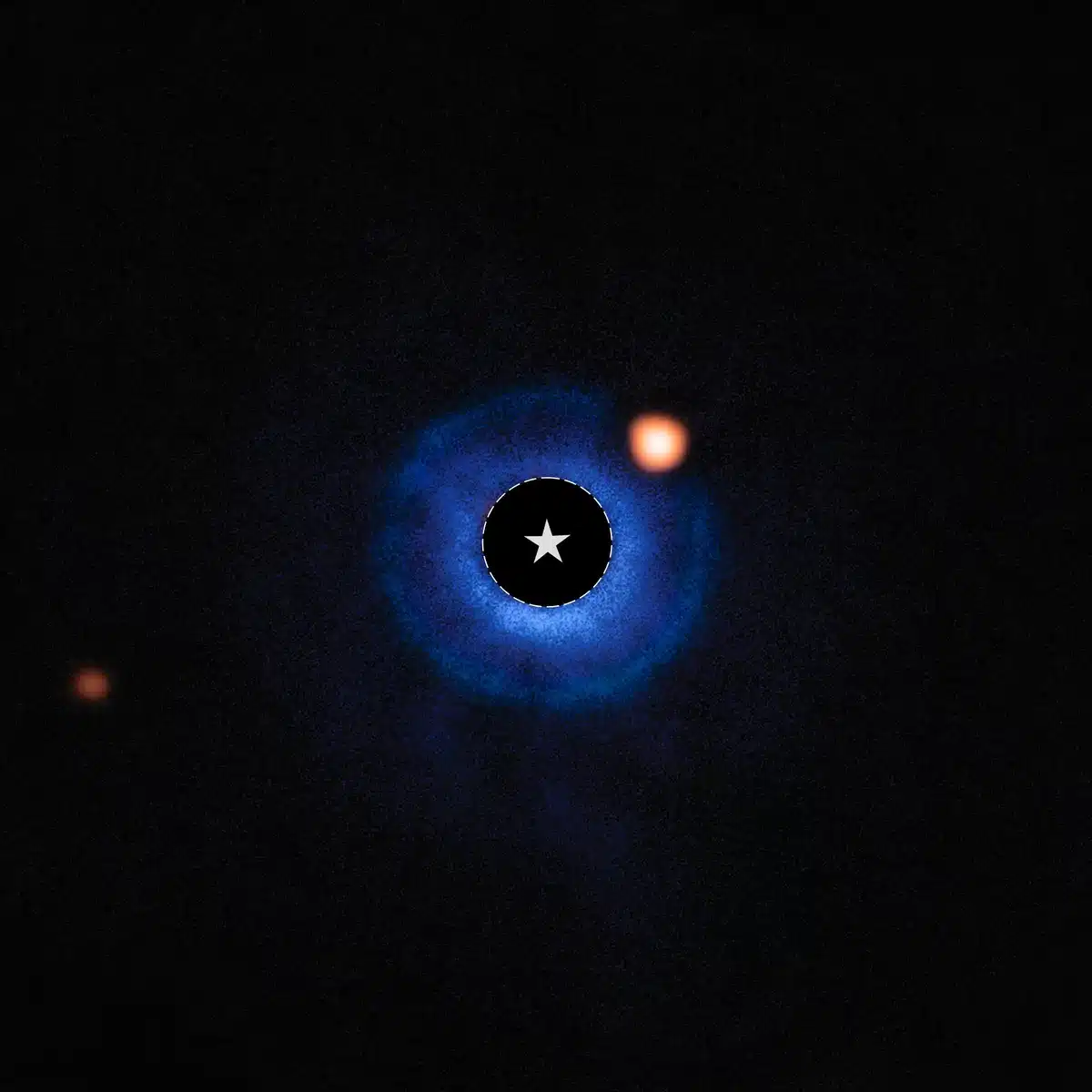
Cette image combine les données du VLT (Observatoire européen
austral) et de l’instrument MIRI (Instrument dans l’infrarouge
moyen) du JWST. La lumière de l’étoile a été bloquée et le bleu
indique l’emplacement du disque autour de l’étoile. La tache orange
représente TWA 7b à l’intérieur du disque. Crédit image : ESA,
NASA, CSA, Anne-Marie Lagrange (CNRS, UGA), Mahdi Zamani
(ESA/Webb)Une prouesse technique et
scientifique
Observer une planète aussi
petite, aussi éloignée, et aussi jeune est une prouesse rendue
possible uniquement grâce au télescope James Webb, qui révolutionne
depuis 2022 notre compréhension du cosmos. Ce type d’observation
directe, extrêmement rare, permet non seulement de confirmer
l’existence d’une planète, mais aussi d’analyser sa lumière, et
donc potentiellement sa composition atmosphérique.
Les chercheurs prévoient
d’étudier plus en détail l’atmosphère de TWA 7b, et de poursuivre
leurs recherches pour détecter d’autres planètes jeunes, froides et
peu massives, dans le même système ou ailleurs. Car le JWST
pourrait bien ouvrir une toute nouvelle fenêtre sur les premières
étapes de la formation planétaire, jusque-là largement
inaccessibles.
Un pas de plus vers la
compréhension des systèmes planétaires
Avec cette découverte, les
astronomes font un pas décisif dans l’observation directe des
jeunes systèmes stellaires. Elle apporte un éclairage précieux sur
la manière dont se forment les planètes, comment elles
interagissent avec leur disque de matière environnant, et comment
elles façonnent leur environnement dès les premières millions
d’années.
En révélant l’existence d’une
planète légère, invisible jusqu’ici, dans un anneau qu’elle semble
sculpter, James Webb confirme son rôle d’instrument
révolutionnaire. Et laisse entrevoir la promesse de découvertes
encore plus spectaculaires dans les années à venir.