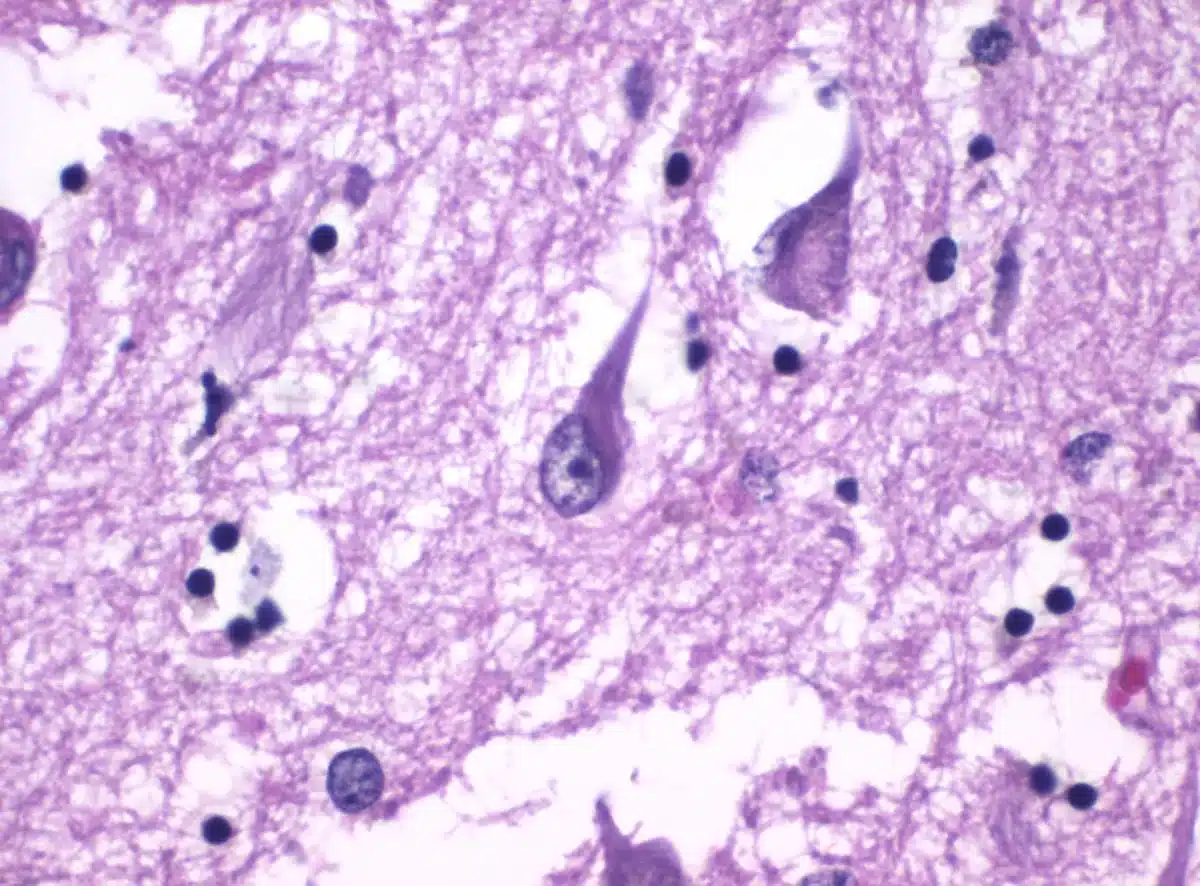Depuis des décennies,
la maladie d’Alzheimer est étroitement associée à deux protéines
clés dans le cerveau : la bêta-amyloïde, qui
forme des plaques, et la protéine tau, qui, une fois modifiée par
phosphorylation, s’agrège en enchevêtrements délétères. Cette forme
phosphorylée, dite p-tau, est largement reconnue comme un marqueur
de la neurodégénérescence caractéristique d’Alzheimer. Pourtant,
une étude récente vient remettre en question cette vision. En
effet, des chercheurs ont découvert que les nouveau-nés présentent
des niveaux de p-tau dans leur cerveau bien plus élevés que ceux
des patients atteints de la maladie. Cette observation inattendue
invite à reconsidérer le rôle de cette protéine, non plus
uniquement comme signe de maladie, mais aussi comme un composant
fondamental du développement cérébral.
Une présence élevée de p-tau chez les tout-petits :
une surprise scientifique
Les travaux menés par Fernando
Gonzalez-Ortiz et son équipe à l’Université de Göteborg, publiés
dans Brain Communications, ont débuté
presque par hasard. En analysant des échantillons de liquide
céphalorachidien (LCR) de nouveau-nés suspectés d’hémorragie
intraventriculaire, ils ont mesuré des taux de p-tau jusqu’à vingt
fois supérieurs à ceux observés chez des patients Alzheimer. Cette
première observation soulevait cependant des doutes : ces bébés
étaient-ils vraiment représentatifs, ou la pathologie sous-jacente
faussait-elle les résultats ?
Pour lever cette incertitude,
l’équipe a analysé des échantillons de sang de cordon ombilical de
nouveau-nés en parfaite santé. Le constat fut le même : des taux
élevés de p-tau, dépassant nettement ceux des personnes atteintes
d’Alzheimer. Cette découverte paradoxale suggère que la
phosphorylation de tau n’est pas nécessairement toxique ou
pathologique, mais peut être physiologiquement normale, voire
essentielle, à certaines étapes de la vie.
Tau phosphorylée : toxique ou utile ? Vers une
nouvelle compréhension
Cette mise en évidence d’un
taux élevé de p-tau chez les nourrissons amène à envisager que
cette protéine puisse avoir un rôle fonctionnel dans le cerveau en
pleine croissance. Contrairement à l’image traditionnelle de la
p-tau comme agent destructeur dans la maladie d’Alzheimer, elle
pourrait favoriser le développement des connexions neuronales et la
plasticité synaptique, processus cruciaux durant les premiers mois
de vie.
La question clé qui se pose
est alors : pourquoi le cerveau des nouveau-nés tolère-t-il ces
concentrations élevées, et comment les régule-t-il ? La réponse
reste à trouver, mais il est probable que des mécanismes
spécifiques contrôlent l’équilibre entre la formation et la
dégradation de ces protéines, empêchant ainsi toute accumulation
toxique.
Implications pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer
Cette redéfinition possible du
rôle de la protéine tau a des conséquences majeures pour la
compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer. Depuis
des années, les recherches se focalisent principalement sur la
bêta-amyloïde, avec des traitements ciblant ses plaques. Ces
approches ont cependant montré des résultats mitigés, voire
décevants, dans leur capacité à freiner le déclin cognitif.
L’étude de Gonzalez-Ortiz
soutient l’idée que l’attention devrait se porter davantage sur la
protéine tau, véritable responsable du déclin neuronal observé dans
la maladie. Comprendre comment la phosphorylation de tau agit
différemment dans un cerveau en développement et dans un cerveau
malade pourrait ouvrir la voie à de nouvelles thérapies, plus
ciblées et potentiellement plus efficaces.
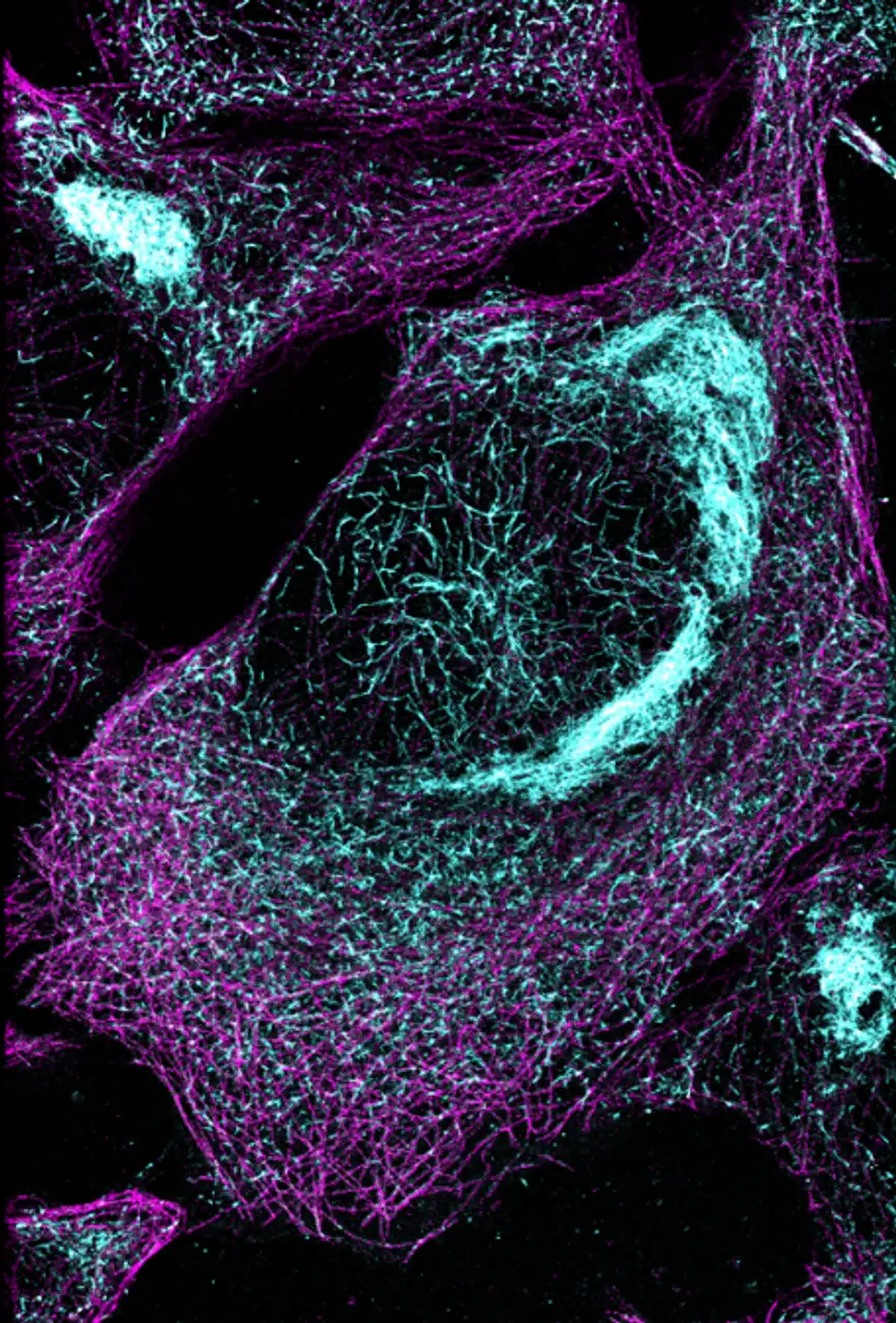
Les agrégats de protéines tau sont représentés en bleu clair à
l’intérieur des microtubules magenta dans ce modèle de pathologie
tau. Crédit image : Melina Gyparaki, laboratoire de Melike
Lakadamyali, École de médecine Perelman de l’Université de
Pennsylvanie via Flickr (domaine public)Une mise en garde : biomarqueurs et contexte
clinique
Il est essentiel de souligner
que la simple présence de p-tau ne suffit pas à diagnostiquer une
maladie neurodégénérative. Comme l’explique Gonzalez-Ortiz, ces
biomarqueurs doivent toujours être interprétés dans un contexte
clinique précis. Sans ce cadre, ils perdent leur signification et
peuvent induire en erreur.
Cela signifie qu’un taux élevé
de p-tau, comme celui observé chez les nouveau-nés, n’est pas
nécessairement un signe de pathologie. Ce point souligne la
complexité de l’utilisation des biomarqueurs dans la médecine
moderne et l’importance de ne pas isoler les données biologiques de
leur contexte global.
Perspectives et questions ouvertes
Cette découverte soulève de
nombreuses questions encore sans réponse. Par exemple, quel est le
moment exact où les niveaux de p-tau diminuent après la naissance ?
Existe-t-il des périodes ultérieures dans la vie où ces taux
peuvent remonter, en lien avec des phases de neuroplasticité ?
Une autre interrogation
concerne la possibilité de prédire à partir de ces taux précoces le
risque de développer Alzheimer ou d’autres troubles neurologiques.
Le projet de Gonzalez-Ortiz prévoit d’étendre ses recherches en
recrutant davantage de participants pour analyser ces liens
potentiels.
Conclusion : Le paradoxe tau, entre construction et
déclin du cerveau
L’étude des taux élevés de
protéine tau phosphorylée chez les nouveau-nés bouleverse la
compréhension actuelle de cette molécule longtemps associée
uniquement à la dégénérescence cérébrale. Elle invite à repenser le
rôle complexe de p-tau, à la fois acteur du développement cérébral
et marqueur d’une maladie dévastatrice.
Cette double facette, à la
fois « alpha et oméga » de la vie cérébrale, ouvre de nouvelles
voies passionnantes pour la recherche. Elle pourrait à terme
conduire à des innovations thérapeutiques en exploitant une
meilleure compréhension du cerveau, de la naissance à la
vieillesse.