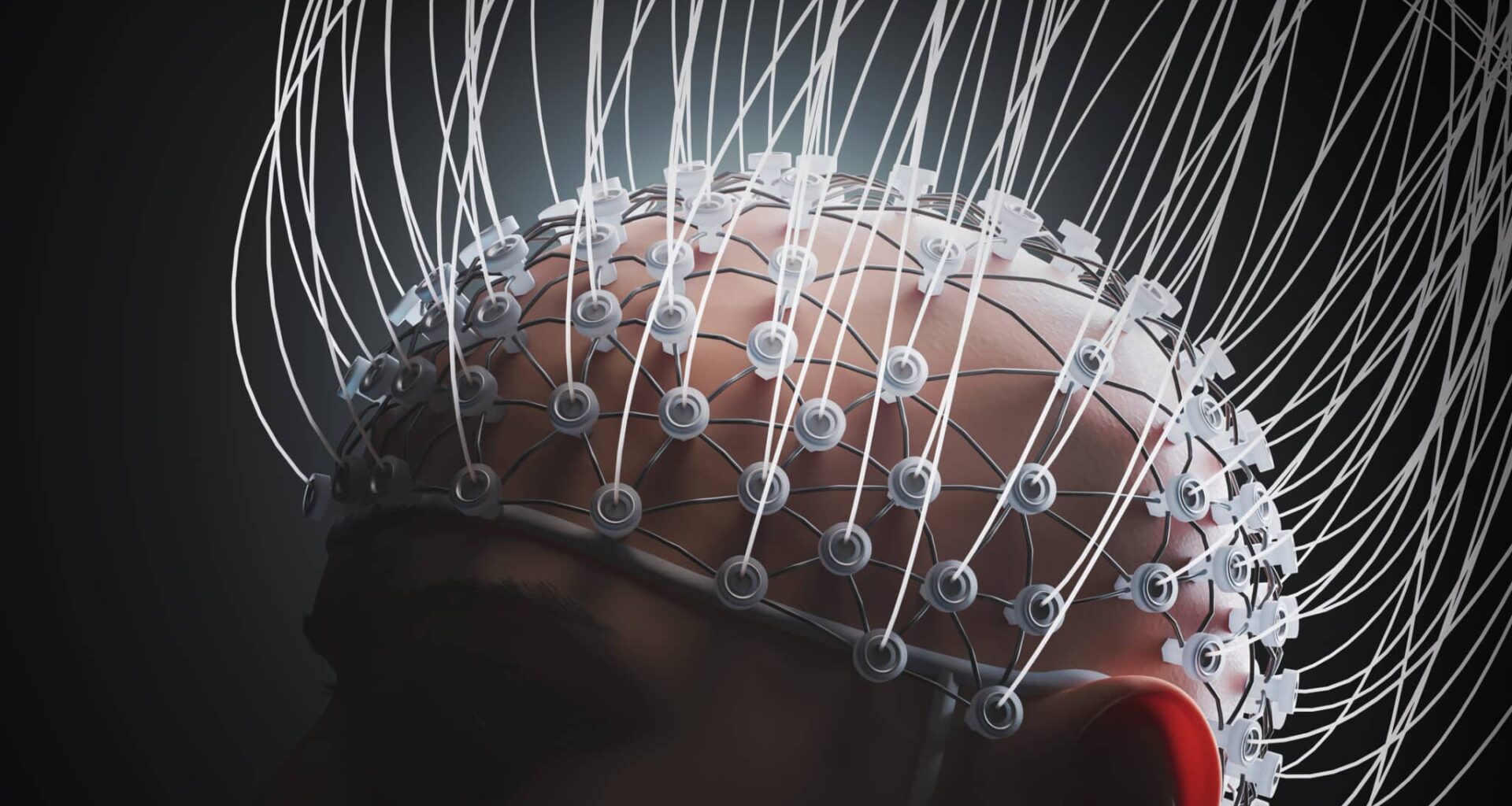Pendant des années, les
enseignants, chercheurs en pédagogie et gouvernements ont tenté de
résoudre un problème persistant : pourquoi certains élèves ont-ils
autant de mal avec les mathématiques, malgré tous les
efforts déployés pour améliorer l’enseignement ? Une nouvelle étude
venue du Royaume-Uni pourrait bien changer notre regard sur cette
difficulté, en suggérant une réponse là où on ne l’attendait pas :
dans le cerveau lui-même.
Des chercheurs de l’Université
de Surrey ont récemment montré qu’une stimulation cérébrale douce,
indolore et non invasive pouvait améliorer les performances en
mathématiques de certains étudiants. Oui, vous avez bien lu. Et
non, il ne s’agit pas de science-fiction.
L’éducation : une affaire de
cerveau autant que d’environnement ?
Pendant longtemps, les
réformes éducatives ont surtout ciblé les enseignants, les manuels
ou encore les méthodes pédagogiques. Mais selon le professeur Roi
Cohen Kadosh, directeur de l’École de psychologie de l’Université
de Surrey, ces efforts pourraient être incomplets s’ils ignorent un
facteur fondamental : la neurobiologie de l’apprenant.
« Un nombre croissant de
recherches montrent que les différences biologiques dans le cerveau
expliquent parfois mieux les écarts de performance en maths que les
facteurs sociaux ou environnementaux », explique-t-il.
Autrement dit, notre capacité
à apprendre les mathématiques ne dépend pas uniquement de l’école
ou du contexte familial, mais aussi de notre câblage cérébral. Et
bonne nouvelle : ce câblage n’est pas figé.
Le principe : envoyer un
léger bruit électrique dans le cerveau
Pour leur étude, les
chercheurs ont recruté 72 jeunes adultes et les ont répartis en
trois groupes. Tous ont passé des tests de mathématiques avant
l’expérience, afin d’établir une base de départ.
Les participants ont ensuite
porté des électrodes placées sur le cuir chevelu, qui diffusaient
de très faibles courants électriques dans des régions précises du
cerveau. La méthode utilisée s’appelle la stimulation
transcrânienne par bruit aléatoire (tRNS), et elle est totalement indolore et sans risque,
selon les chercheurs.
Deux zones du cerveau ont été
ciblées :
-
Le cortex préfrontal
dorsolatéral (dlPFC), connu pour son rôle dans l’apprentissage, la
mémoire de travail et la résolution de problèmes. -
Le cortex pariétal postérieur
(PPC), impliqué dans le traitement des quantités et du raisonnement
mathématique.
Chaque jour pendant cinq
jours, les participants recevaient 30 minutes de stimulation
pendant qu’ils résolvaient des exercices mathématiques.
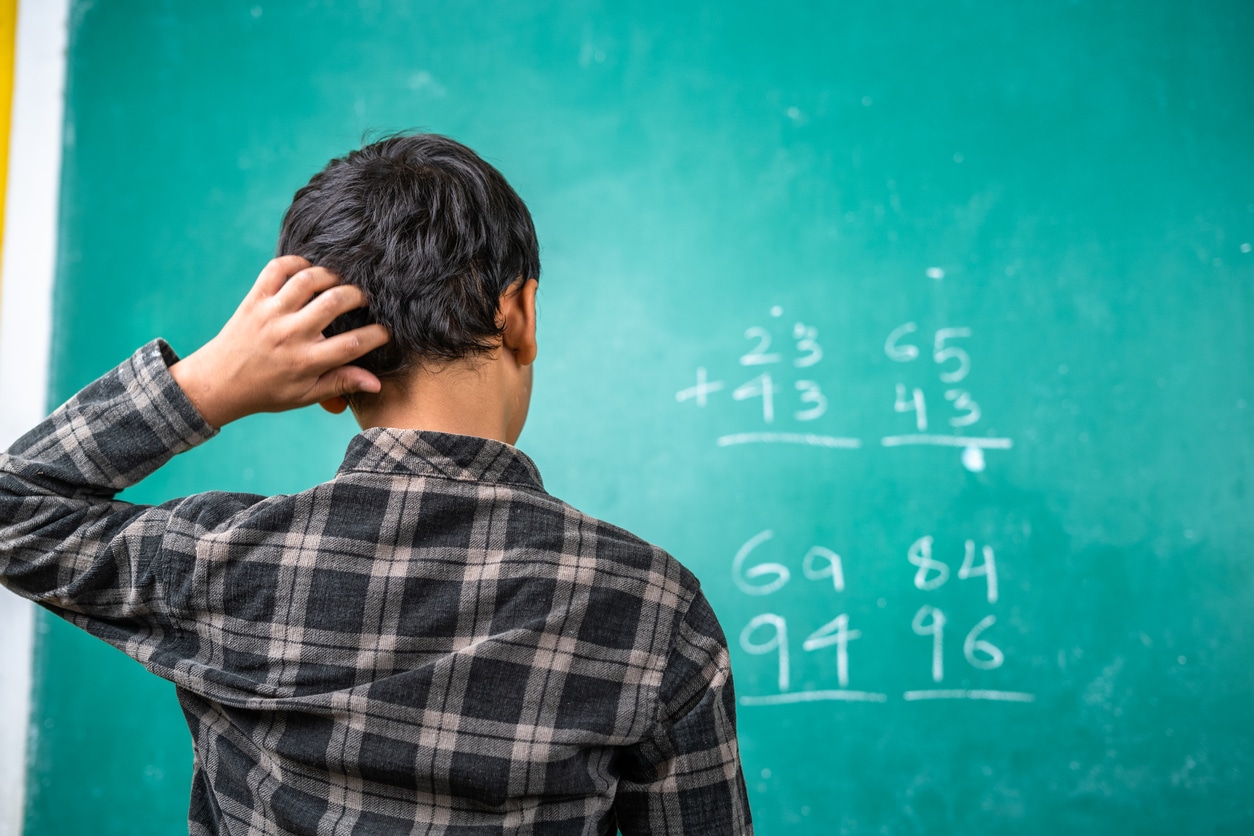
©Lakshmiprasad S/iStockDes résultats bluffants pour
les cerveaux « déconnectés »
Mais l’étude, publiée dans
PLoS
Biology, ne s’est pas arrêtée là. Avant les tests,
les chercheurs avaient aussi évalué la connectivité cérébrale
naturelle des participants, c’est-à-dire la manière dont les zones
du cerveau « communiquent » entre elles.
Et c’est là que les résultats
deviennent fascinants :
- Chez les participants ayant
une connectivité faible entre le dlPFC et le PPC – un profil
souvent associé à des difficultés d’apprentissage –, la stimulation
a eu l’effet le plus spectaculaire. - Leur capacité à résoudre des
problèmes mathématiques s’est nettement améliorée, bien plus que
chez les autres groupes.
Selon les chercheurs, la tRNS
aiderait à augmenter légèrement l’activité des neurones
« fatigués » ou peu actifs, les rapprochant du seuil
d’activation nécessaire pour apprendre efficacement. C’est un peu
comme si on donnait un petit coup de pouce électrique à un cerveau
trop timide.
Vers une éducation plus
personnalisée… et plus équitable ?
Loin de proposer une baguette
magique pour transformer tout le monde en génie des maths, cette
technologie ouvre néanmoins une nouvelle voie prometteuse pour
aider les élèves en difficulté.
« En combinant
neurosciences, psychologie et pédagogie, nous pouvons développer
des outils qui s’adaptent au cerveau de chaque apprenant. Cela
pourrait réduire les inégalités éducatives, mais aussi les écarts
futurs en matière d’emploi, de santé et de revenus », souligne
le professeur Kadosh.
Un constat d’autant plus
important que, selon les auteurs, près d’un adulte sur quatre dans
les pays développés possède des compétences en mathématiques
comparables à celles d’un enfant de sept ans. Un chiffre
préoccupant dans un monde où les carrières liées aux sciences, à la
technologie et à l’économie dépendent de plus en plus des
compétences numériques.
Et demain, un casque de
stimulation sur chaque bureau ?
Évidemment, on n’en est pas
encore à prescrire des casques à électrodes dans les salles de
classe. Mais cette étude — publiée dans la revue PLoS Biology — apporte des données
solides sur la plasticité du cerveau, et sur la manière dont des
interventions ciblées pourraient améliorer l’apprentissage.
L’idée n’est pas de remplacer
les enseignants ou les méthodes pédagogiques, mais plutôt de
compléter l’enseignement traditionnel avec des solutions
personnalisées, qui prennent en compte les spécificités biologiques
de chaque élève.
Après tout, si un simple
signal électrique peut aider certains cerveaux à mieux apprendre…
pourquoi ne pas l’explorer davantage ?