Depuis près de deux
siècles, l’ingéniosité humaine a façonné les paysages de la
planète, notamment à travers la
construction massive de barrages destinés à retenir l’eau pour
l’irrigation, la production d’énergie, ou encore
l’approvisionnement en eau potable. Pourtant, ces gigantesques
ouvrages hydrauliques, au-delà de leur rôle économique et social,
ont eu un impact insoupçonné sur la Terre elle-même : ils ont
modifié la position des pôles terrestres. Une découverte récente
issue d’une étude publiée dans Geophysical Research
Letters révèle comment la redistribution de l’eau à
travers le globe provoque un léger mais réel déplacement de l’axe
de rotation de notre planète.
Une masse d’eau qui fait bouger
la Terre
Le phénomène à l’origine de
cette dérive polaire réside dans la redistribution des masses à la
surface de la Terre. En effet, la planète est composée de plusieurs
couches, dont la croûte solide sur laquelle nous vivons, reposant
sur un manteau visqueux et malléable. Lorsqu’une grande quantité
d’eau est retenue par un barrage, elle exerce une pression
considérable sur la croûte terrestre, modifiant localement la
répartition des masses. Cette nouvelle répartition entraîne alors
un léger glissement de la croûte par rapport au manteau, ce qui se
traduit par une modification de la position des pôles.
Ce processus est appelé la «
véritable dérive polaire » : il s’agit d’un déplacement de l’axe de
rotation de la Terre par rapport à sa surface. Bien que ce
mouvement soit relativement faible à l’échelle humaine, il reste
mesurable et a des implications importantes pour la géophysique, la
navigation et la compréhension du climat.
Un mouvement insoupçonné
depuis 1835
Les scientifiques savaient
déjà que les activités humaines peuvent influencer la dérive
polaire. Par exemple, des études antérieures ont montré que
l’extraction massive d’eau souterraine ou la fonte accélérée des
glaces polaires en raison du changement climatique contribuent à
déplacer l’axe de la Terre. Cependant, la nouvelle étude s’est
concentrée sur un facteur souvent négligé : l’impact des barrages
construits à travers le monde.
Entre 1835 et 2011, plus de 6
800 barrages ont été érigés à différentes époques et dans diverses
régions. Ces infrastructures ont permis de retenir un volume d’eau
si important qu’il pourrait remplir deux fois le Grand Canyon. En
accumulant cette eau loin des océans, ces barrages ont non
seulement fait baisser le niveau mondial de la mer d’environ 23
millimètres, mais ont aussi contribué à déplacer la position des
pôles d’environ 1,1 mètre.
Cette dérive polaire s’est
déroulée en deux phases distinctes, en fonction des régions où les
barrages ont été construits. La première phase, de 1835 à 1954, est
liée à l’essor des barrages en Amérique du Nord et en Europe. Ce
phénomène a déplacé le pôle Nord d’environ 20 centimètres vers le
103e méridien est, une ligne imaginaire traversant la Russie et la
Mongolie.
La deuxième phase, de 1954 à
2011, correspond à une forte croissance des barrages en Afrique de
l’Est et en Asie. Cette nouvelle masse d’eau répartie a entraîné un
déplacement plus marqué, de 57 centimètres, cette fois vers le 117e
méridien ouest, qui traverse l’ouest de l’Amérique du Nord et le
Pacifique Sud. Ces mouvements ne suivent pas une trajectoire
linéaire, mais forment une sorte de zigzag instable autour de la
position précédente.
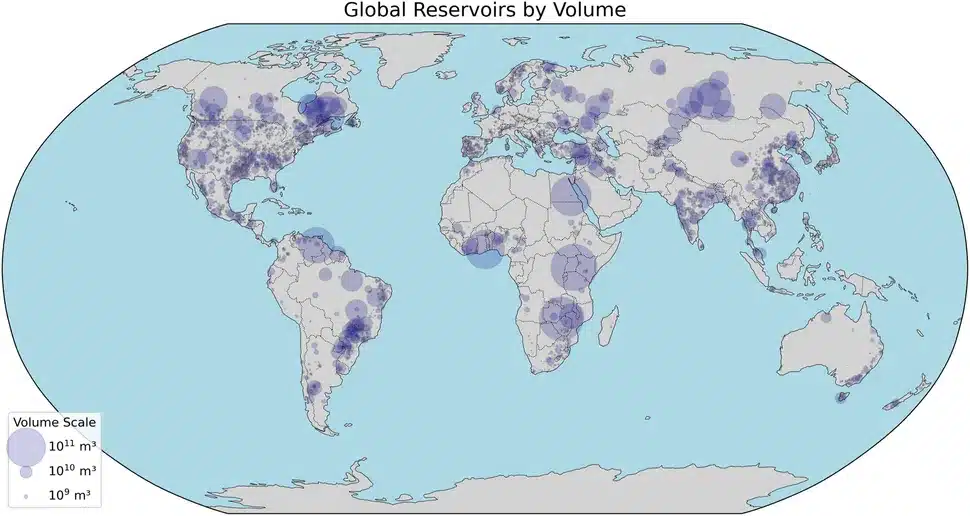
Crédit image : Valencic et al. (2025)Un impact modeste mais
significatif
À première vue, un déplacement
d’un mètre des pôles sur près de deux siècles peut paraître minime.
Et il est vrai que ce mouvement ne menace ni la stabilité de la
planète ni les conditions climatiques globales à court terme.
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il doit être pris en compte
dans plusieurs domaines scientifiques et techniques.
Par exemple, les systèmes de
navigation GPS, les relevés géodésiques et les modèles climatiques
reposent sur une connaissance précise de la position des pôles. Un
décalage, même faible, peut donc entraîner des erreurs dans ces
domaines, ce qui souligne l’importance de bien comprendre et
modéliser ces déplacements.
Par ailleurs, l’impact des
barrages sur le niveau de la mer est particulièrement crucial. La
baisse de près de 2,3 centimètres due à la retenue d’eau dans ces
infrastructures représente environ un quart de la hausse globale du
niveau des océans observée au 20e siècle, qui s’élève à 12-17
centimètres. Autrement dit, sans ces barrages, le niveau des mers
aurait augmenté encore davantage, avec des conséquences encore plus
marquées pour les zones côtières et les populations
vulnérables.
Vers une meilleure
intégration des facteurs humains dans les modèles climatiques
Cette étude invite donc la
communauté scientifique à intégrer davantage l’impact des barrages
dans ses projections sur l’évolution future des pôles terrestres et
du niveau des océans. Car la construction continue de nouvelles
infrastructures hydrauliques, notamment dans des régions comme
l’Asie et l’Afrique, pourrait encore modifier la répartition de
l’eau sur Terre, accentuant ces phénomènes.
Au-delà des implications
scientifiques, cette découverte illustre à quel point l’activité
humaine influence profondément et durablement notre planète, jusque
dans des mécanismes aussi fondamentaux que la rotation de la Terre.
Il s’agit là d’un exemple frappant de l’interconnexion entre nos
choix technologiques et l’équilibre naturel de la Terre, qui mérite
d’être mieux compris pour anticiper les défis environnementaux à
venir.
