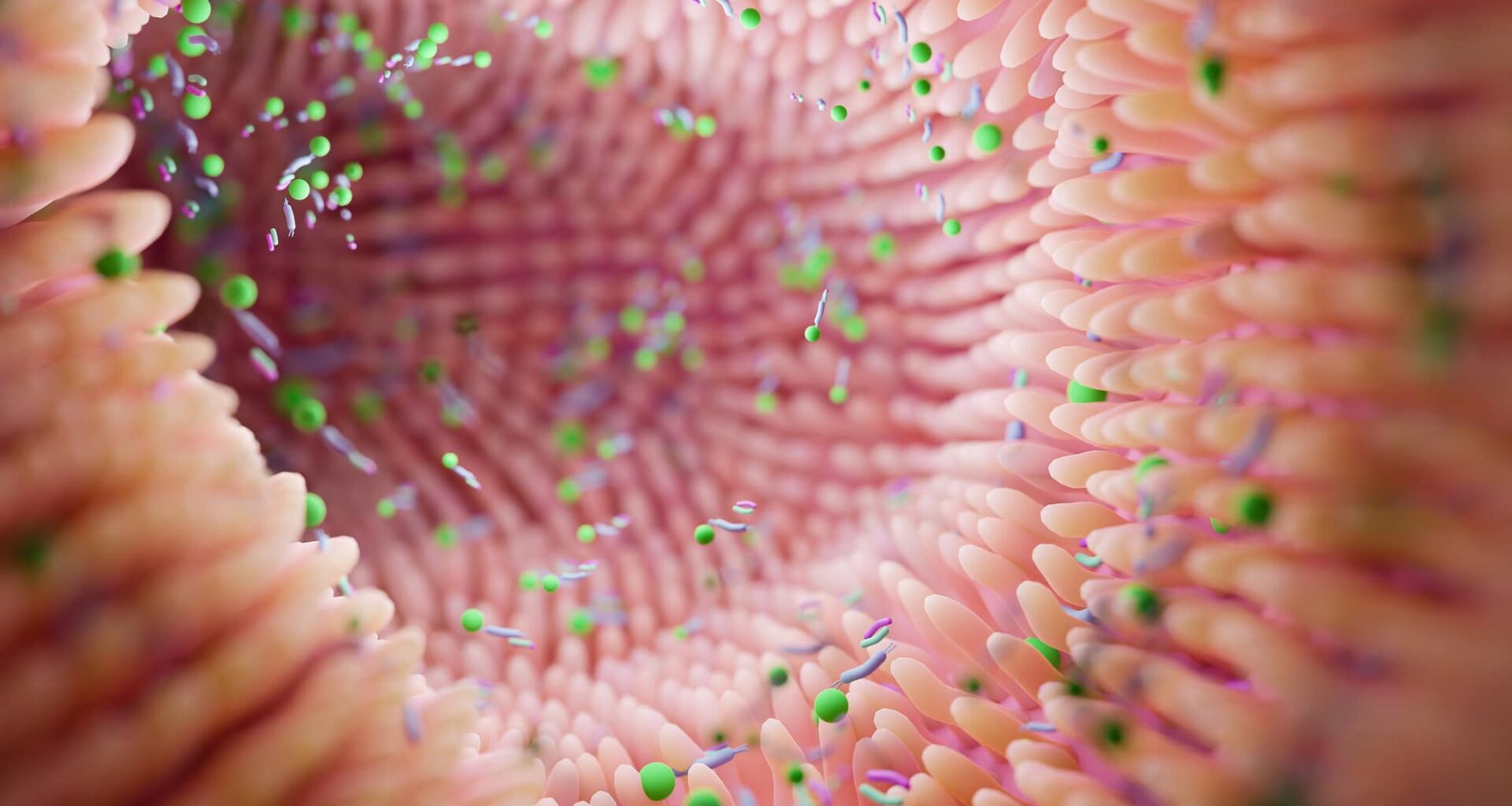Le microbiote intestinal recèle
encore bien des mystères, mais les chercheurs commencent à percer
ses secrets les plus surprenants. Dernière avancée en date :
l’identification d’une bactérie capable d’amplifier les effets des
traitements contre le cancer, en particulier ceux reposant sur
l’immunothérapie. Cette piste ouvre de nouvelles perspectives pour
renforcer l’efficacité de ces thérapies, aujourd’hui limitées à une
fraction des patients.
Une bactérie méconnue, un
effet puissant
Tout part d’une question qui
intrigue les chercheurs depuis plusieurs années : pourquoi certains
malades répondent-ils très bien aux traitements d’immunothérapie,
quand d’autres n’en tirent presque aucun bénéfice ? Ces
traitements, appelés inhibiteurs de points de contrôle immunitaire,
visent à « libérer » les défenses naturelles du patient afin que
son propre système immunitaire puisse s’attaquer aux cellules
cancéreuses. Mais malgré leur efficacité spectaculaire chez
certains, ils échouent encore chez beaucoup.
Pour comprendre ces
différences, l’équipe du Dr Hiroyoshi Nishikawa, du Centre national
du cancer de Tokyo, a eu l’idée de se pencher sur le microbiote
intestinal de patients traités. En comparant des échantillons de
selles de malades répondeurs et non-répondeurs, les chercheurs ont
transplanté ces microbiotes dans l’intestin de souris atteintes de
tumeurs. Résultat : les rongeurs ayant reçu le microbiote des
patients les plus réceptifs au traitement ont eux aussi montré une
meilleure réponse.
Le lien était établi, restait
à identifier le responsable. Après plus d’un an et demi de
recherches minutieuses, les scientifiques ont découvert le microbe
en question : Hominenteromicrobium mulieris. Jusqu’ici, cette
bactérie n’avait suscité guère d’intérêt. Présente dans l’intestin
humain, elle vit discrètement dans un environnement pauvre en
oxygène, riche en nutriments. Mais son rôle potentiel dans
l’immunothérapie change radicalement son statut.
Comment ça fonctionne ?
Chez la souris,
H. mulieris
stimule un maillon essentiel du système immunitaire : les cellules
dendritiques. Ces cellules, véritables éclaireurs, captent des
signaux de danger et migrent vers les tumeurs, où elles activent
d’autres acteurs de l’immunité, notamment les lymphocytes T. Ces
derniers sont chargés de traquer et d’éliminer les cellules
cancéreuses. Le rôle des inhibiteurs de points de contrôle est
justement de lever les freins qui entravent l’action de ces
lymphocytes. En renforçant cette activation immunitaire dès
l’amont, la bactérie démultiplie donc les effets du traitement.
D’autres microbes avaient déjà
été identifiés comme capables d’influencer l’efficacité de ces
thérapies, mais H.
mulieris semble surpasser tous ses prédécesseurs. Les
tests réalisés ont montré un effet bien plus net et plus fiable que
ceux observés avec d’autres bactéries similaires.
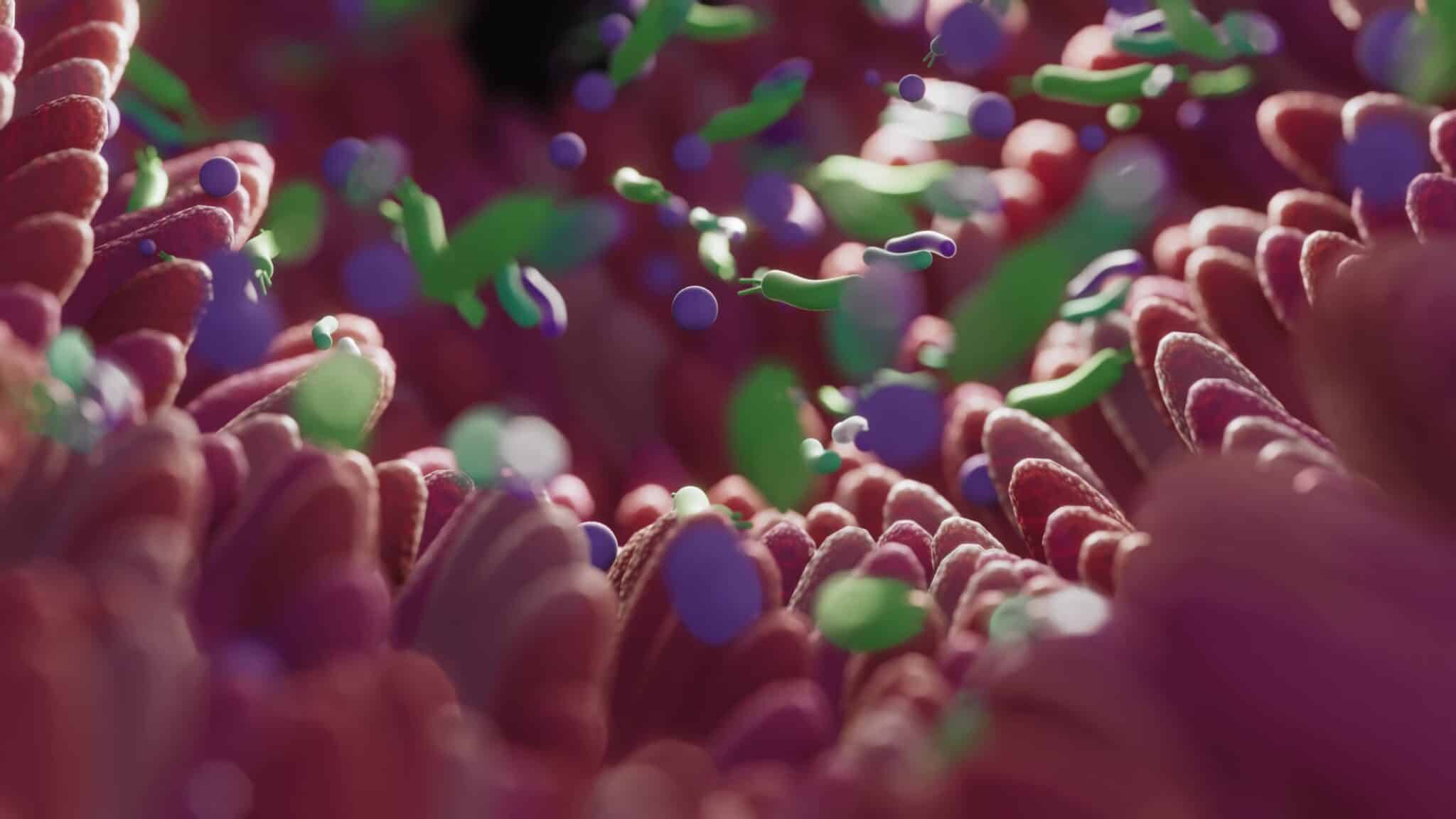
Crédit :
iStock
Une illustration du microbiote intestinal. Crédits : Oleksandra
Troian/istockDes essais cliniques en
vue
Fort de ces résultats, l’équipe de Nishikawa
s’est associée à une biotech pour préparer un essai clinique dans les prochaines
années. L’objectif : vérifier si cette bactérie peut, chez l’homme,
renforcer l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle, comme
elle le fait chez la souris. Si les résultats sont aussi
encourageants que ceux obtenus en laboratoire, cette avancée
pourrait marquer un tournant dans le traitement de certains
cancers.
Les chercheurs restent
toutefois prudents. Le microbiote humain est d’une grande
complexité, et il est peu probable qu’une seule bactérie suffise à
optimiser l’immunité de tous les patients. Mais cette découverte va
dans le sens d’une médecine plus personnalisée, où l’on pourrait un
jour administrer des cocktails sur mesure de bactéries pour
maximiser les chances de succès thérapeutique.
Cette recherche confirme en tout cas
l’importance croissante du microbiote dans la lutte contre le
cancer. L’intestin, souvent surnommé « notre deuxième cerveau »,
pourrait bien devenir, dans les années à venir, un allié stratégique
dans le combat contre la maladie.