Opinion
Livre –
Les Berges de Jussy vont l’objet d’un gros volume illustré
L’ouvrage collectif, qu’a dirigé Pauline Nerfin, raconte une entreprise genevoise d’adduction d’eau, commencée en 1865.
 Publié aujourd’hui à 13h35
Publié aujourd’hui à 13h35
Le site à l’heure actuelle, avec le nouveau bâtiment en haut à droite.
Patrimoine suisse Genève.
Abonnez-vous dès maintenant et profitez de la fonction de lecture audio.BotTalk
L’histoire tient de l’épopée. Mais une épopée à la genevoise, et donc en format réduit. En 1865, un serrurier-mécanicien de 31 ans, héritier il est vrai d’une entreprise locale fondée deux générations plus tôt, se lance dans une grosse affaire. Charles Schmiedt envisage ni plus ni moins que de capter les eaux de l’Arve au niveau de Vessy. Un pompage permettra de les distribuer aux habitants de la rive gauche qui s’abonneraient à ses services. Il faut dire que ces gens se font toujours plus nombreux. Depuis la destruction des fortifications à partir de 1850, Genève a explosé. De nouveaux quartiers se sont créés. Leur développement semble ne plus pouvoir connaître de fin. Nous sommes dans une période d’expansion économique, à laquelle la «grande crise» de 1875-1896 va mettre un sérieux frein, avant une reprise fulgurante qui durera jusqu’en 1914.
Deux petites îles
La création d’une telle usine privée ne va pas sans problème, comme le rappelle aujourd’hui l’ouvrage collectif «Les Berges de Vessy: une histoire entre nature et industrie», publié à son compte par Patrimoine suisse Genève. Il s’agit de s’implanter sur deux petites îles, apparues quelque part dans la seconde moitié du XVIIIe siècle comme en témoignent des cartes d’époque sans, puis avec elles. Il ne faut pas oublier que l’Arve reste un torrent de montagne, aux crues imprévisibles. Celle de 1778 s’est révélée ravageuse. Mais rien ne décourage le pionnier Schmiedt, qui va installer là un premier bâtiment, doté d’une mécanique d’avant-garde pour l’époque. N’imaginez pas pour autant l’homme avec le physique de Gary Cooper dans les films de la Paramount. Une rare photo, prise vers 1890, montre un monsieur tenant plutôt du gros entrepreneur ayant réussi. Car l’affaire va marcher, puis se développer en continu. Alors que la plupart des établissements de ce genre ont vite été rachetés par l’État, un peu comme les chemins de fer, la Société des Eaux de l’Arve va perdurer jusqu’en 1988 avant de se voir reprise par celle des Services industriels du canton (ou SIG). Une nouvelle vie a alors commencé pour Vessy.
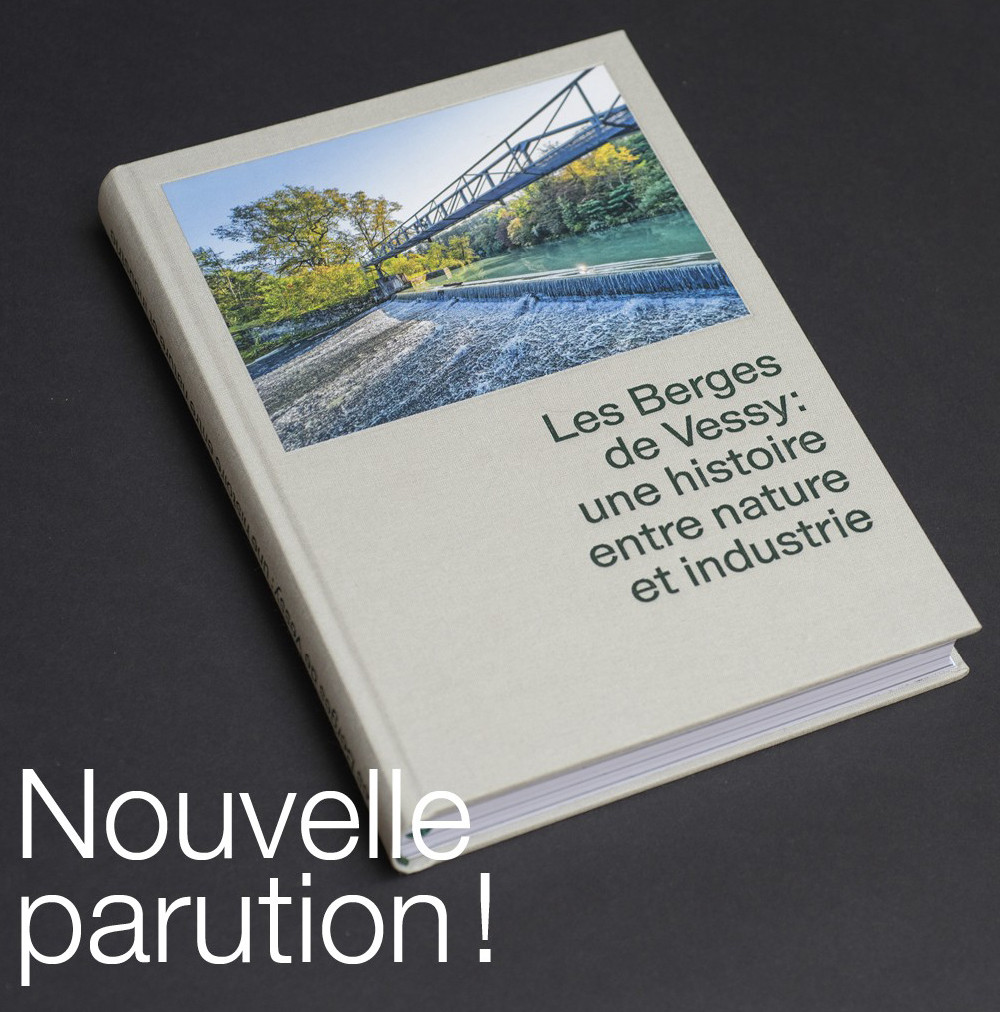
Le livre, tel qu’il se présente.
Patrimoine suisse Genève.
Il y avait donc énormément à raconter. Beaucoup à montrer aussi, dans la mesure où une impressionnante documentation s’est vue réunie. Une seule personne aurait succombé sous la tâche. Les travaux historiques collectifs se voient de plus préférés de nos jours aux marathons en solitaire. Je les soupçonne de faire plus sérieux. Une importante équipe a donc été réunie sous la houlette de Pauline Nerfin, la femme de cet aigle à deux têtes que constitue la direction de Patrimoine suisse Genève (1). Il s’agissait aussi bien d’évoquer les nappes phréatiques (car le pompage est vite allé jusque-là!) que la faune locale ou la technique. Après le grand panorama sur l’activité de Schmiedt et ses successeurs, il convenait aussi de se pencher sur la suite. Qu’allaient devenir après 1988 l’usine désaffectée et ses nombreux petits bâtiments érigés au cours du temps? Il y avait bien sûr là le projet d’un écomusée, après classement du site. C’était une idée de l’Association pour le Patrimoine industrie, ou API. Inutile de dire que les SIG ne l’entendaient pas de cette oreille. Ces nouveaux propriétaires auraient préféré installer sur les îlots une microcentrale électrique.

Les travaux d’adaptation aux nouvelles fonctions culturelles.
Site des Berges de Vessy.
On sait ce qui est advenu. Est né un projet de réhabilitation et de reconversion entre 2004 et 2006. Celui-ci ne prévoyait pas un «Ballenberg genevois», pour autant qu’on puisse rapprocher le faux village bernois, composé de maisons anciennes démontées et remontées, avec un authentique complexe industriel. Il fallait rester plus modeste. Le Musée de l’eau est… tombé à l’eau. Va ainsi se développer un simple projet de mise en valeur, avec tout de même l’adjonction d’un édifice moderne: la Maison du futur. Chaque pavillon ancien recevrait ainsi son affectation propre, avec des visées écologiques. Le livre, qui jargonne beaucoup, préfère parler de «perspectives épistémologiques». La jeune Association des Berges de Vessy va donc se vouer dès 2015 à des activités pédagogiques et culturelles, avec notamment un programme d’expositions. Un dernier chapitre de l’ouvrage se livre enfin à des projections, «Quel avenir pour le Berges de Vessy?» à l’heure d’une transition écologique semblant aujourd’hui bien compromise?

La plaque Art déco pour les concessionnaires.
DR.
Le livre forme en lui-même un bel objet. Imprimé sur un papier mat et léger, il bénéficie d’une jolie mise en page aérée de Daniel Kunzi de BLVDR, une agence de design carougeoise. L’iconographie réunie m’a impressionné. Aucun document ne semble avoir échappé à l’équipe coordonnée par Paulin Nerfin. L’impression fait bonne impression. C’est de la belle ouvrage qui répond aux critères de 2025, les goûts évoluant en la matière comme en tout. Pour ce qui est des textes, dus à huit auteurs différents, rien à dire sur les recherches archivistiques. Tout ce qui existe a visiblement été passé au crible. Les contributions se voient ainsi nourries par une chair considérable. C’est la colonne vertébrale qui leur fait hélas défaut. Perdu dans les chiffres, les dates, les noms et les détails, il y a des moments où j’ai éprouvé de la peine à comprendre ce qui se passait, comme à la lecture de certains polars.

L’équipe au travail, ver 1910.
DR, site des Berges de Jussy.
La plupart des auteurs ne se contentent en effet pas d’adopter un ton impersonnel de rapporteurs de procès-verbal, que l’on retrouve déjà parfois dans «Alerte», le bulletin de Patrimoine suisse Genève. Ils en remettent sans cesse dans ce verbiage à la mode unissant l’abstraction à la bien-pensance. J’ai parfois eu l’impression de me retrouver face à l’un de ces communiqués dont la Ville et l’État abreuvent les pauvres journalistes. Le texte de Paul Marti sur les années 2000 à 2025 constitue pour moi l’exemple même d’un de ces brouillards verbeux. Sur des mots-valises, l’auteur étale une couche d’idéologies à la mode aussi généreusement que s’il s’agissait de Nutella. Avec le même côté un peu poisseux. Dommage, car l’homme sait de quoi il parle. Il avait par conséquent des choses à dire. Je n’ai pas l’impression de les avoir entendues. Il faut parfois savoir faire simple.
(1) L’autre tête étant l’architecte Lionel Spicher.
Pratique
«Les Berges de Vessy: une histoire entre nature et industrie», ouvrage collectif sous la direction Pauline Nerfin. Edité par Patrimoine suisse Genève, 258 pages.

Travaux de maintenance. Nous sommes au jugé dans les années 1930.
DR, site des Berges de Jussy.
Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la «Tribune de Genève», en commençant par parler de cinéma. Sont ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler.Plus d’infos
Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.
