Après avoir raconté la guerre, la mine, le cancer, son enfance, le grand reporter et écrivain Sorj Chalandon tombe le masque, comme jamais, vingt ans après la publication de son premier roman, en 2005.
Deux ans après L’Enragé, un roman sur l’histoire d’un adolescent enfermé dans un centre d’éducation surveillée à Belle-Ile-en-Mer dans les années 1930, Sorj Chalandon lève le voile sur ses propres années de jeunesse, de la rue au journal Libération, en passant par son engagement à l’extrême gauche. Le Livre de Kells, roman ouvertement autobiographique, paraît aux éditions Grasset le 13 août 2025.
À l’âge de 17 ans, Sorj Chalandon quitte Lyon, sa famille, et surtout celui qu’il appelle « L’autre », ce père aux idées réactionnaires, racistes, antisémites, qui l’a maltraité pendant toute son enfance. Il quitte aussi le lycée, sa mère et « son tablier de ménagère » qui s’est montrée incapable de le protéger de la violence de « L’autre ». Il part avec, pour seule fortune, un Corneille (100 francs), volé à « L’autre » par sa mère.
Sa première escapade, en Camargue, se solde par un échec. Il rentre la queue entre les jambes à Lyon. Mais pas question de remettre les pieds chez « L’autre ». Alors, il se cache pendant quelques mois chez Jacques, son ami d’enfance, avant de faire le grand pas. Cette fois, ce sera Paris, un aller sans retour.
Ses rêves de voyage à Katmandou, qu’il partage avec des marginaux rencontrés dans la rue, se perdent dans le froid, la faim, la violence et le LSD. Dans la rue, il s’appelle Kells, un nom qu’il a emprunté au Livre de Kells, « chef-d’œuvre du catholicisme irlandais, rédigé en l’an 800 par des moines de culture », représenté sur une carte postale envoyée autrefois par Jacques, glissée dans son sac en partant.
Après presque un an de galère, une poignée de militants, « les maos », une branche de la GP (Gauche prolétarienne), le sort de la rue. Enrôlé un peu par hasard, Kells épouse vite les convictions de cette nouvelle famille, avec qui il fait l’expérience de la fraternité, de l’engagement, de la lutte, qui prend parfois des formes violentes. Le jeune homme reprend peu à peu confiance en l’humain.
Il distribue La Cause du peuple, fait de l’aide aux devoirs pour les enfants d’une famille immigrée des bidonvilles de Nanterre, colle des affiches, casse du flic, du CRS, les crânes rasés de L’Ordre nouveau, embrasse les combats féministes. Il découvre aussi, avec ses camarades, les dérapages et les tragédies. Après la mort de Pierre Overney, descendu par un vigile devant l’usine Renault de l’île Seguin, à Billancourt, le 25 février 1972, la GP « est enterrée », les copains se dispersent, et Sorj Chalandon entre à Libération.
Ce roman d’apprentissage ajoute une pierre au récit autobiographique entamé par Sorj Chalandon dès son premier roman, Le Petit Bonzi, il y a tout juste vingt ans. Un récit qu’il a distillé ensuite dans Profession du père, une version romancée du calvaire qu’il a subi de la part de son père pendant l’enfance, puis dans Enfant de salaud, dans lequel il entremêlait habilement son histoire personnelle avec le récit du procès de Klaus Barbie, en 1987.
Avec l’enthousiasme et une forme de naïveté qui caractérise la jeunesse en formation, Sorj Chalandon nous met dans la peau d’un jeune adulte, avec sa fougue, ses illusions, ses souffrances, ses interrogations, et aussi ses pudeurs. Avec lyrisme, et le sens de la formule, sa marque de fabrique, il fait de ce chemin initiatique une épopée dont il raconte par le menu toutes les péripéties.
« Je ne défendais pas une idée ni une idéologie, mais un territoire. Un bout de trottoir et une amitié. J’étais un chien fou libéré de sa laisse. »
Sorj Chalandon
« Le Livre de Kells », page 157
Ce lyrisme un peu grandiloquent, qui pourrait sonner faux, colle parfaitement au caractère enflammé de la jeunesse, à ses élans, à ses engouements, à ses détestations, à ses rêves, particulièrement à l’œuvre dans les rangs des militants révolutionnaires de la fin des années 1960, et du début des années 1970.
Car ce récit intime est aussi un voyage dans l’histoire de cette Gauche prolétarienne, de ses rêves et de ses combats, mais aussi de ses luttes intestines. Sorj Chalandon, de sa plume pleine d’enthousiasme, dessine les ondulations de ce mouvement qui, de l’Italie à l’Allemagne, en passant par Paris, a cru aux lendemains qui chantent, à l’amitié entre les peuples, à la fraternisation entre les classes sociales, entre les intellectuels et le monde ouvrier, à l’égalité, à la liberté, puis s’est cogné au désenchantement. On y croise des anonymes, on y reconnaît quelques figures de proue.
Le Livre de Kells, parfois maladroit comme l’est la jeunesse, n’est pas aussi huilé, pas aussi bien dosé que ce que Chalandon a eu l’habitude de nous donner depuis vingt ans. C’est pourtant, et peut-être même pour cette raison précisément, qu’il est sans doute son livre le plus touchant. L’écrivain relate avec sincérité, sans filet, son chemin vers l’émancipation. Creusant dans les replis les plus secrets de son intimité, le romancier remonte le fil d’une existence privée d’humanité dans l’enfance, qui se réinvente, avec ses fractures, ses failles, ses trouilles, ses maladresses, ses doutes et ses enthousiasmes, ses désirs, ses mystifications et ses fanfaronnades, aussi. Un livre bouleversant, qui dit avec pudeur la vie, simplement, sans héroïsme.
« Le Livre de Kells » de Sorj Chalandon, Éditions Grasset, 384 pages, 23 euros.
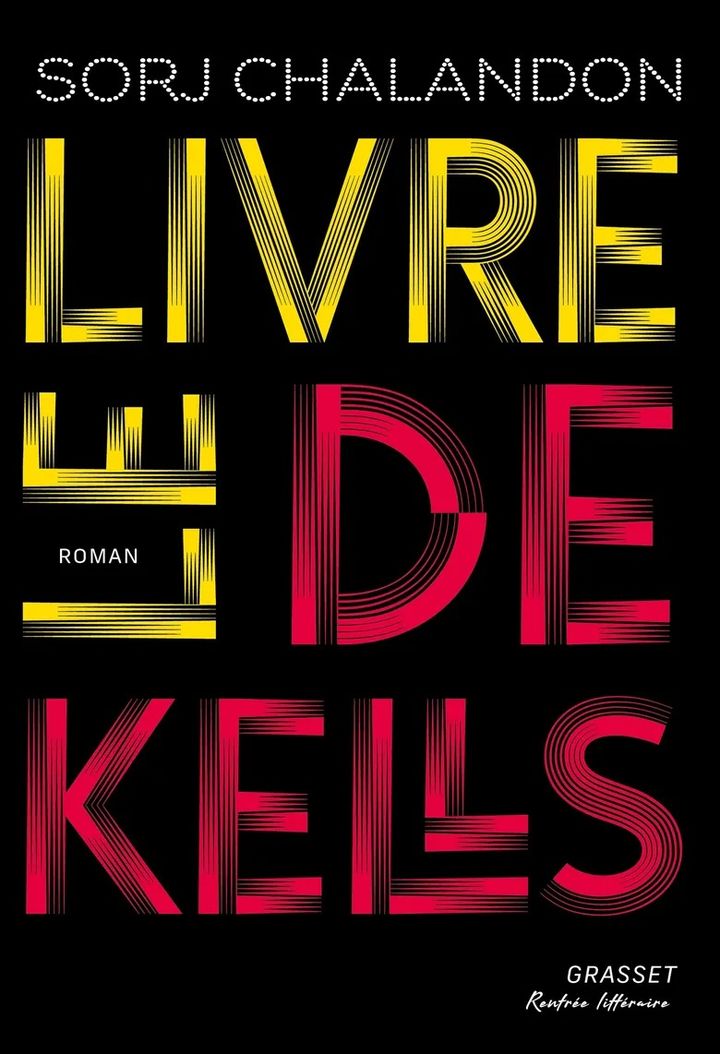
Couverture du roman « Le Livre de Kells » de Sorj Chalandon, publié le 13 août 2025. (EDITIONS GRASSET)
Extrait : « J’ai marché le jour, la nuit, sous le vent du nord et dans le froid. Je me suis réfugié au cœur du pire. Un parking gelé, une décharge à ordure, une vespasienne. Mes pieds étaient brûlés. Ma peau lacérée. Mon ventre, dévoré par le mépris de moi-même. Je n’étais plus un homme, j’étais une défaite. Jamais je n’avais imaginé que je serais aussi seul au monde. » (page 134)
