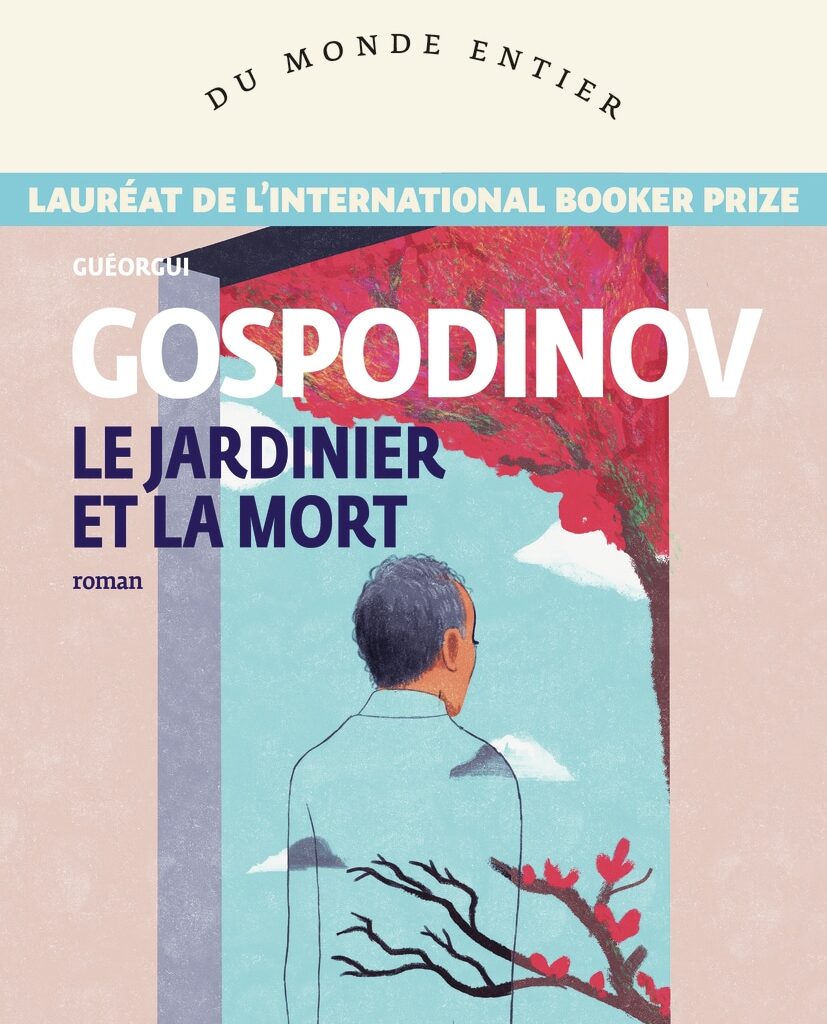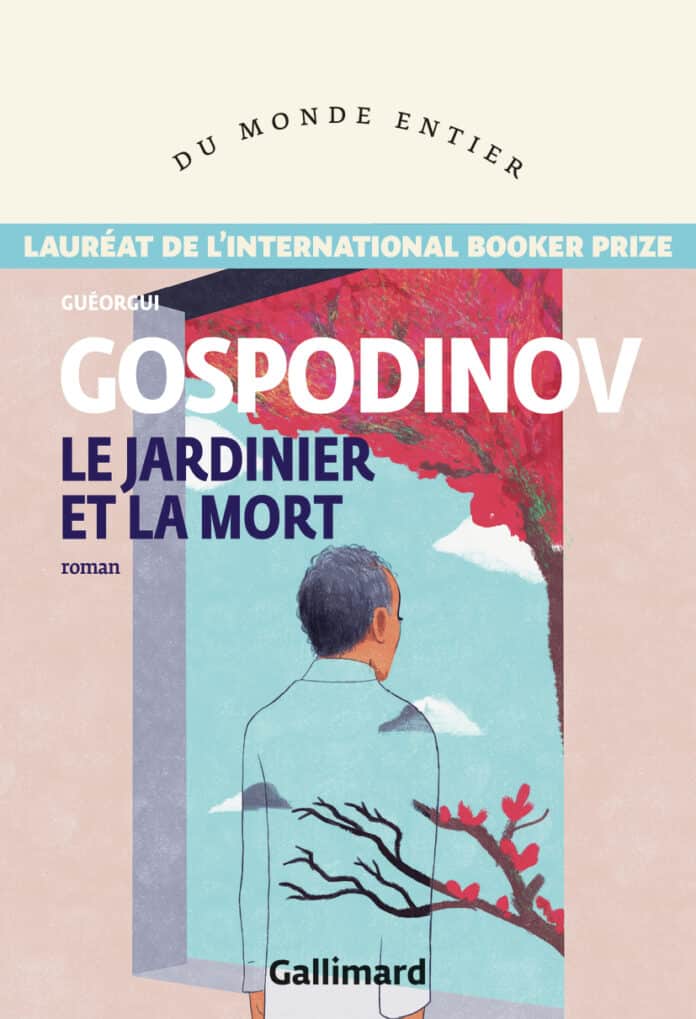
« Mon père était jardinier. Maintenant il est jardin. » Cette première phrase de Le jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov condense la vibration du livre : une méditation intime et universelle sur la mort, la mémoire et l’avenir fragile de l’Europe. Lauréat du Booker international en 2023 pour Le pays du passé, Guéorgui Gospodinov confirme ici son art de la mélancolie comme instrument de lucidité. En retraçant le dernier mois de vie de son père, il interroge la transmission filiale mais aussi la survie d’une civilisation menacée par l’oubli. Laquelle ? La nôtre.
« Du monde entier. »
« Mon père était jardinier. À présent c’est un jardin.
Je ne sais par où commencer. Que ceci soit le début. Il est question de fin, évidemment, mais où la fin commence-t-elle ?
Je crois que j’ai fait pipi, a dit mon père sur le seuil. Il se tenait dans l’embrasure de la porte d’entrée, atrocement amaigri, légèrement voûté, de cette voûture propre aux personnes de haute taille. On l’a amené tard, un soir, à la toute fin de novembre. Il avait supporté un voyage de trois cents kilomètres, allongé sur la banquette arrière pour émousser un peu la douleur. J’avais réussi à obtenir un rendez-vous le lendemain pour des examens.
J’ai fait pipi, a-t-il répété, de l’air penaud d’un petit enfant, en s’excusant et avec l’autodérision qui le caractérisait — on se ridiculise sur ses vieux jours.
Tout va bien, ai-je dit, et nous avons entrepris de changer ses vêtements dans le couloir en fermant la porte du salon.
J’ai peur, m’a dit ma fille tout bas à l’oreille à un moment donné. À présent, je me rends compte qu’elle a été la première à le sentir. Je ne savais pas encore, je ne voulais pas savoir.
Autant le dire d’emblée, à la fin de ce livre le héros meurt. Même pas à la fin, d’ailleurs, dès le milieu, mais après, il est de nouveau vivant, dans toutes les histoires avant qu’il ne s’en aille ou dans celles d’après. Car, comme le disait Gaustine, dans le passé, le temps ne s’écoule pas dans une seule direction.
Quand j’étais petit, je ne choisissais à la bibliothèque que les livres écrits à la première personne, car je savais que le héros ne mourrait pas. Bon, ce livre est écrit à la première personne bien que son véritable héros meure. Ne survivent que les conteurs d’histoires, mais eux aussi mourront un jour.
Ne survivent que les histoires.
Et le jardin que mon père avait travaillé avant de s’en aller.
C’est sûrement la raison pour laquelle nous racontons. Pour construire un couloir parallèle dans lequel le monde et tous ceux qui l’habitent sont à leur place, pour détourner le récit vers une autre plate-bande lorsque cela deviendra dangereux et que la mort arrivera, de même que le jardinier détourne l’eau vers la plate-bande suivante de son jardin.
J’aimerais qu’il y ait de la lumière, une lumière d’après-midi, douce, dans ces pages. Ce n’est pas un livre sur la mort, mais sur la tristesse de voir la vie qui s’en va. C’est différent. Tristesse à l’égard de son gâteau rempli de miel, mais aussi des alvéoles vides de ce gâteau, cette dernière encore plus vive. Tristesse à l’égard de ce gâteau dont se souviennent aussi les bougies en cire pendant qu’elles se consument dans nos mains.
Rien d’effrayant, comme il disait. »
La mort d’un père, la naissance d’un jardin
Le roman Le jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov se déploie autour de la lente agonie d’un père bulgare, vieil homme de terre et de silence, dont le fils consigne les gestes, les silences et les humiliations du corps. Après sa mort, le narrateur découvre un carnet tenu par le père, non pas journal intime mais registre de jardinier : « Chaque printemps, les oignons plantés, les arbres greffés, la pluie comptée en jours, des récoltes fragiles. Comme si le monde pouvait se sauver en restant fidèle au cycle des saisons ». Le contraste est saisissant : le père ne laisse pas de récit, mais une cartographie du vivant, un témoignage d’attention patiente aux rythmes de la nature. Ainsi s’esquisse une équation bouleversante où l’homme disparaît, mais le jardin – travail de patience, de soin, de transmission – demeure. C’est par ce détour que Gospodinov donne au deuil la forme d’un héritage. Le jardin devient mémoire et la mémoire se fait graine d’avenir.
Comme souvent chez Guéorgui Gospodinov, l’intime est inséparable du collectif. Le père appartient à cette génération d’Européens de l’Est formés sous un régime communiste qui les aura enfermés dans la dissimulation, le mensonge, la peur et le silence ; le rare espace de liberté se réduisant à un lopin de terre. Le jardin est ainsi doublement métaphore : espace d’autonomie au sein d’un régime autoritaire, mais aussi lieu où se conserve, sous la surface, un sens de la continuité.
À travers le portrait du père-jardinier, c’est toute une mémoire bulgare – et européenne – qui affleure : celle des silences, des deuils tus, des résistances modestes. Là réside le cœur du livre : la nature comme métaphore de la mort, mais aussi comme promesse de continuité. Gospodinov tisse la biographie d’un père avec l’herbier d’une civilisation : comment accepter que tout se fane ? Et que reste-t-il quand la mémoire humaine se confie aux mains d’une terre obstinée à fleurir ? En ce sens, le roman dépasse la seule expérience personnelle pour toucher à une crise civilisationnelle : que faire d’un passé marqué par la perte, sinon le cultiver comme une terre fragile ?
En ce sens, Le jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov se situe dans le prolongement de Physique de la mélancolie et du Pays du passé. Il interroge ce que nous faisons de notre passé, et comment, faute de l’assumer, nous risquons de le voir revenir sous des formes toxiques – nostalgies autoritaires, replis identitaires, mythe d’une innocence perdue. Les inquiétants retour de la peste brune et de la peste rouge.
Une constellation européenne : Jünger, Rilke, Cioran, Char, Gustafsson
Dès les premières pages du jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov, le lecteur est saisi par un style fragmentaire, lapidaire, où chaque phrase fonctionne comme un aphorisme chargé d’oracle. « Mon père était jardinier. Maintenant il est jardin » : en deux temps, la vie bascule dans la mort, et l’homme devient matière cosmique. Cette densité poétique, héritière à la fois de la liturgie orthodoxe et des écritures méditatives de l’Europe moderne installe d’emblée le roman dans une tonalité élégiaque sans pathos. Le texte de Gospodinov s’inscrit ainsi dans une filiation plurielle, comme si son jardin bulgare dialoguait avec d’autres jardins, d’autres écritures de l’Europe blessée. On peut y discerner quelques grandes parentés.
Avec Ernst Jünger, d’abord, par la métaphore du jardin comme rempart fragile contre la barbarie (la peste brune) dans Sur les falaises de marbre (1939). Le jardin n’est pas seulement un motif botanique, il est une figure récurrente de la littérature européenne comme lieu de résistance. Chez Jünger, le jardin est décrit comme un sanctuaire spirituel : « Dans nos jardins clos, les lis fleurissaient encore et les grenades luisaient au soleil tandis que déjà au loin montait la fumée des incendies ». Ce contraste entre le calme ordonné du hortus conclusus et l’avancée du Grand Forestier, figure de la barbarie totalitaire de Hitler, en fait un bastion de civilisation. Mais cette enclave est menacée de destruction, et sa fragilité incarne le destin d’une Europe classique sur le point de basculer.
À près d’un siècle de distance, Guéorgui Gospodinov réinvente cette symbolique dans le communisme (la peste rouge). Là où Ernst Jünger imaginait un jardin aristocratique, fragile citadelle assiégée par la violence, Gospodinov offre un jardin modeste, populaire, fruit des gestes d’un père anonyme. Non pas forteresse héroïque, mais parcelle obstinée : « Mon père cultivait comme on prie – non pour repousser la mort, mais pour l’apprivoiser ».. La portée civilisationnelle est sans ambigüité : l’Europe ne se sauvera pas par des forteresses des coups des nouveaux barbares mais par des gestes de soin et de transmission. Le jardin incarne la possibilité, toujours menacée, d’un héritage vivant. Et donc de son futur.
Avec Emil Cioran, l’affinité se joue du côté de la lucidité mélancolique. Comme Cioran, Gospodinov sait que la perte est la vérité fondamentale de l’existence européenne. Mais là où Cioran s’enferme dans la stérilité d’une méditation sans consolation, Gospodinov refuse le nihilisme pur : il oppose à l’évidence de la désagrégation une patience, une fidélité au cycle de la nature.
Enfin, avec René Char, l’écho résonne dans l’usage du fragment et dans la conviction que la poésie doit sauver l’essentiel face au désastre. « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », affirmait Char : le carnet du père, dérisoire et essentiel, en devient pourtant un, à travers ses notes de jardinier. Char sauvait par l’éclair aphoristique, Gospodinov par la semence obstinée : deux formes d’une même survie poétique.
Avec Rainer Maria Rilke, ensuite, dont les Élégies de Duino ont donné à la mort un statut d’élément constitutif de la vie : « la beauté n’est rien d’autre que le commencement du terrible ». Dans les deux cas, l’expérience de la perte n’est pas déniée mais reconnue comme partie intégrante de l’existence. Le fragment, l’éclat, la notation brève dans le roman de Guéorgui Gospodinov jouent le rôle des visions fulgurantes dans les Élégies : saisir un instant du visible en sachant qu’il est voué à disparaître. Et comme l’ange rilkéen qui unit le monde des vivants et celui des morts, le père-jardinier devient ici figure médiatrice, entre mémoire et oubli, finitude et continuité. Loin d’être une simple chronique du deuil, Le jardinier et la mort rejoint l’élégie rilkéenne : non pas plainte mais chant de passage, méditation poétique où la fin devient graine, et où l’humus de la mémoire nourrit la possibilité d’une renaissance.
Il faut également citer Lars Gustafsson dont La mort d’un apiculteur offre peut-être le contrepoint nordique le plus proche de l’entreprise de Gospodinov. Comme l’apiculteur suédois, le père bulgare vit sa fin non pas dans le tumulte mais dans l’attention obstinée aux signes minuscules du vivant. Chez Gustafsson, l’écriture fragmentaire épouse la douleur du corps tout en cherchant la continuité du monde ; chez Gospodinov, elle traduit la mélancolie d’une Europe menacée d’oubli. Tous deux transforment la chronique d’une agonie en méditation sur la survie des formes simples — les abeilles, les fleurs, les gestes du soin — comme si la dignité du mourir résidait dans la persistance de ces minuties.
Enfin, à ce réseau de résonances, il faut ajouter la comédie universelle même de Gospodinov avec Gaustine qui n’est jamais qu’un simple personnage mais une instance de médiation, un passeur de mémoire. Dans Le Pays du passé, il était celui qui administrait la « clinique du temps » et orchestrait les retours en arrière pour des sociétés malades de nostalgie. Dans Le jardinier et la mort, sa présence est plus diffuse mais non moins essentielle. Le père-jardinier peut être lu comme une figure de Gaustine en acte — non plus l’intellectuel ironique qui manipule le passé, mais l’homme silencieux qui, dans ses gestes de terre, sauve la mémoire par l’attention au vivant. Il y a l’astuce intellectuelle et la patience du jardinier.
Ainsi se dessine une constellation de penseurs et de poètes qui, chacun à leur manière, ont cherché à conjurer la catastrophe européenne par l’écriture. Gospodinov leur succède, mais en les infléchissant : il écrit depuis l’Est post-soviétique, avec la conviction que l’avenir de l’Europe ne se joue plus dans les grandes citadelles culturelles, mais dans les jardins humbles, dans la mémoire quotidienne, dans l’humus obstiné des morts.
![]()
Une poétique spirituelle du fragment et de l’humus
Une des forces, plutôt des puissances de Guéorgui Gospodinov est d’ajouter à la gravité un humour discret, presque tendre. La pudeur du narrateur devant les humiliations physiques du père empêche le récit de sombrer dans le pathétique, comme si l’ironie légère était le dernier rempart contre l’écrasement de la douleur. La voix oscille entre l’enfant qui se souvient du père comme d’un « héros de l’enfance » et l’adulte qui constate l’agonie, produisant une polyphonie temporelle où chaque fragment condense mémoire et perte.
À cette polyphonie s’ajoute une dimension organique : les images de racines, de terre, de pluie font du texte une véritable éco-poétique du deuil, où écrire revient à cultiver, à enfouir la mémoire dans l’humus pour qu’elle refleurisse. Carnet du père et livre du fils se répondent : l’un écrit la terre, l’autre écrit la mort. Le roman devient alors une double archive, où l’écriture, comme le jardin, n’est pas seulement geste de conservation mais acte de transmission, liturgie laïque où l’humus de la mémoire nourrit l’avenir.
Ainsi, entre les notations du carnet paternel, les réminiscences du fils et les résonances antiques qui traversent le texte — figures d’Orphée et sa descente aux enfers, souvenirs d’Ithaque, échos de la sagesse d’Épicure — se dessine une polyphonie qui dépasse de loin le cadre d’une élégie personnelle. Le roman prend alors l’allure d’une liturgie laïque, méditation partagée sur la finitude et la mémoire. Mais cette liturgie, si elle se veut séculière, demeure traversée de correspondances religieuses. Les lecteurs issus de la tradition chrétienne, orthodoxe et romaine, reconnaîtront dans l’évocation du père-jardinier une silhouette discrètement christique. La figure double du Christ Jardinier et Médecin des âmes qui soigne en silence la nature des hommes et dont la mort devient passage, métamorphose et fécondité.
Ainsi Le jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov n’est pas seulement un roman funèbre, c’est un memento mori pour l’Europe ainsi qu’un memento nasci. Il s’agit d’accepter la mort comme partie intégrante de la vie afin de redonner sens à la mémoire, à l’héritage et à la fragilité. Cultiver ou disparaître. Construire une véritable et ambitieuse politique culturelle européenne qui sache cultiver ses racines s’avère alors un moyen essentiel de redonner un sens historique et spirituel à la construction de l’Europe. Et alors on reverra fleurir les oliviers.

Noli me tangere ou Le Christ en jardinier apparaissant à la Madeleine est un tableau réalisé entre 1548 et 1560 par le peintre flamand Lambert Sustris. Il est conservé au palais des Beaux-Arts de Lille
Biographie de Guéorgui Gospodinov
Né en 1968 à Yambol, en Bulgarie, Guéorgui Gospodinov est aujourd’hui l’un des écrivains européens les plus traduits et les plus reconnus. Poète, nouvelliste et romancier, il a acquis une réputation internationale avec Physique de la mélancolie (2011, trad. française chez Intervalles), où il revisitait le mythe du Minotaure à travers la mémoire collective de l’Europe de l’Est. En 2023, il remporte le Booker International Prize pour Le Pays du passé (Gallimard), roman d’anticipation sur la manipulation politique de la nostalgie. Son œuvre, traduite dans plus de 25 langues, explore les thèmes de la mémoire, du deuil, de l’Histoire et de la fragilité humaine. Récompensé également par le prix Jan Michalski et par de nombreuses distinctions en Europe, Gospodinov est devenu une voix centrale de la littérature contemporaine, oscillant entre mélancolie, ironie et lucidité politique.
Fiche technique
- Titre : Le jardinier et la mort
- Auteur : Guéorgui Gospodinov
- Titre original : The Gardener and Death (Садовникът и смъртта)
- Traductrice : Marie Vrinat-Nikolov
- Éditeur français : Gallimard, coll. « Du monde entier »
- Date de parution en France : août 2025
- Langue originale : bulgare
- Pagination : 272 pages (env.)
- Prix indicatif : 23 €
Bibliographie sélective
Œuvres de Guéorgui Gospodinov
- Gospodinov, G. (2011). Physique de la mélancolie. Paris : Intervalles.
- Gospodinov, G. (2020). Time Shelter (Le Pays du passé). Paris : Gallimard.
- Gospodinov, G. (2025). Le jardinier et la mort. Paris : Gallimard.
Œuvres d’Ernst Jünger
- Jünger, E. (1939). Sur les falaises de marbre. Trad. Henri Plard. Paris : Gallimard.
- Jünger, E. (1949). La Paix. Trad. H. Thomas. Paris : Gallimard.
Œuvres de Rainer Maria Rilke
- Rilke, R. M. (1923). Élégies de Duino. Trad. Philippe Jaccottet. Paris : Seuil (Points Poésie).
- Rilke, R. M. (1922). Les Sonnets à Orphée. Trad. Claude Vigée. Paris : Gallimard (Poésie).
Œuvres d’Emil Cioran
- Cioran, E. (1949). Précis de décomposition. Paris : Gallimard.
- Cioran, E. (1973). De l’inconvénient d’être né. Paris : Gallimard.
- Cioran, E. (1986). Aveux et anathèmes. Paris : Gallimard.
Œuvres de René Char
- Char, R. (1946). Feuillets d’Hypnos. Paris : Gallimard (Poésie).
- Char, R. (1962). Recherche de la base et du sommet. Paris : Gallimard.
- Char, R. (1983). Œuvres complètes. Paris : Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
Œuvres de Lars Gustafsson
- Gustafsson, L. (1978). La mort d’un apiculteur. Trad. L. et E. Duthuit. Paris : Gallimard.
- Gustafsson, L. (1981). L’histoire d’un chien. Trad. A. Ségol. Paris : Gallimard.
- Gustafsson, L. (1996). Les endormis de Västmanland. Trad. F. Asso. Paris : Actes Sud.
Études critiques
- Calasso, R. (2015). La littérature et les dieux. Paris : Gallimard (réflexion sur le rôle des mythes et de la mémoire en littérature).
- Escoubas, É. (2003). Jardins de mémoire, jardins de mort : l’imaginaire européen du végétal. Revue des sciences humaines, 269(1), 45-62.
- Mertens, P. (2012). La mémoire européenne : histoire et mélancolie. Bruxelles : Complexe.
- Minois, G. (2019). Histoire de la mort en Occident, de l’Antiquité à nos jours. Paris : Fayard.
- Schenker, D. (2021). « Les jardins de Jünger : culture et barbarie dans Sur les falaises de marbre ». Revue d’histoire intellectuelle européenne, 13(2), 117-134.